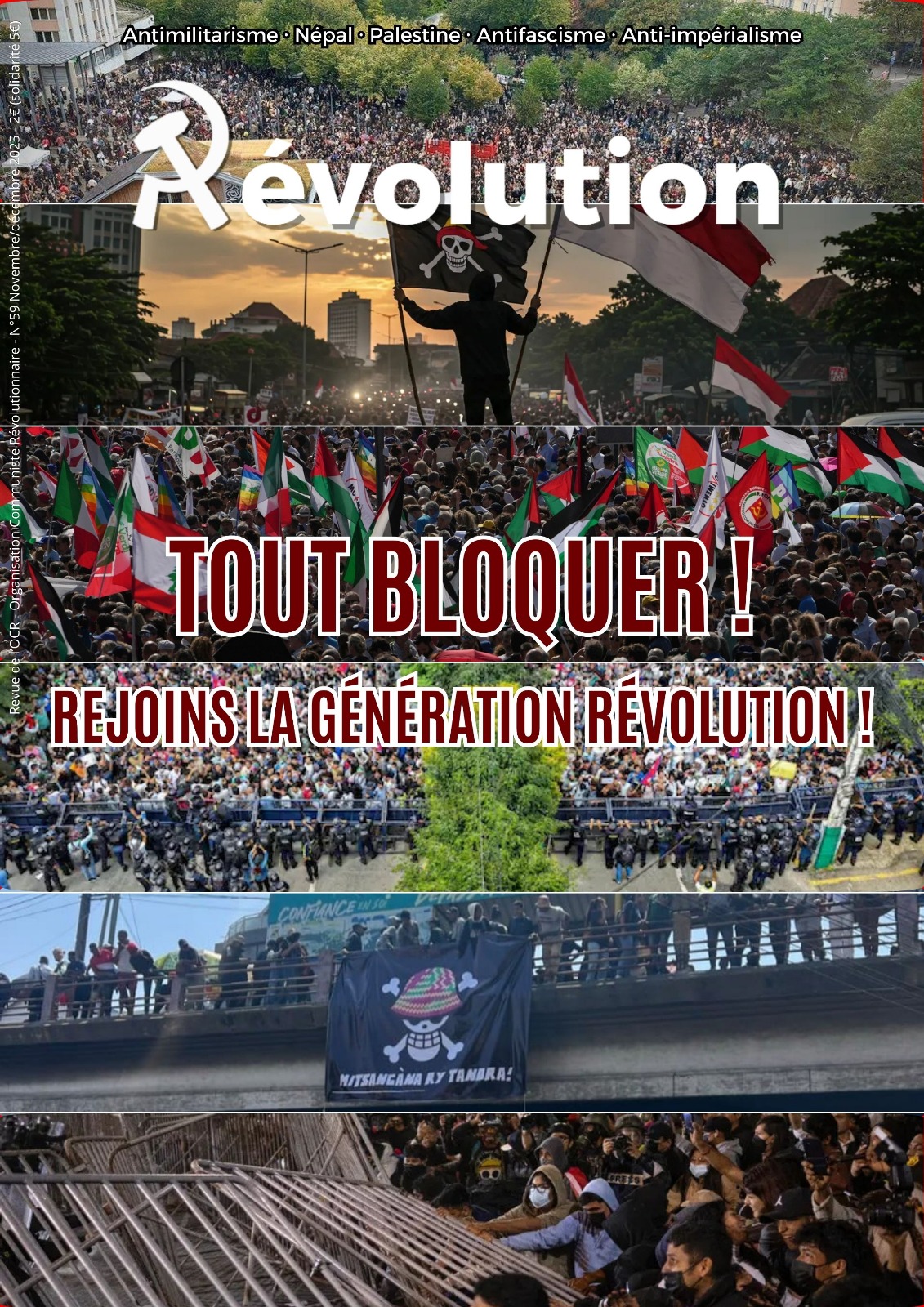Dans la dernière partie de son étude sur l’émergence de l’économie de partage, Adam Booth analyse le nouveau livre de Paul Mason, PostCapitalism, qui traite des effets des technologies de l’information et de leurs apports contradictoires au sein d’un système capitaliste en proie aux crises. Quelle est la route qui permettra à la société d’utiliser l’abondance de technologies et de richesses que nous voyons aujourd’hui autour de nous ?
Les « cycles longs » du capitalisme
Le monde moderne semble être un système incompréhensible, complexe, chaotique et contradictoire. D’un côté, nous vivons au milieu d’une abondance de richesses ainsi que des plus incroyables avancées scientifiques et technologiques. D’un autre côté, nous observons une croissance des inégalités et une crise économique sans fin.
Ce sont ces contradictions que Paul Mason, rédacteur en chef du service économique de la chaîneChanel 4 News, essaye de disséquer dans son nouveau livre PostCapitalism. Comme le titre l’indique, ce livre est une analyse incisive qui s’attache à comprendre comment les forces motrices du capitalisme dans son âge d’or – compétition, propriété privée, poursuite du profit — sont désormais devenues d’énormes entraves au progrès social et scientifique, posant ainsi la question vitale du système qui est désormais nécessaire pour faire avancer la société et l’humanité.
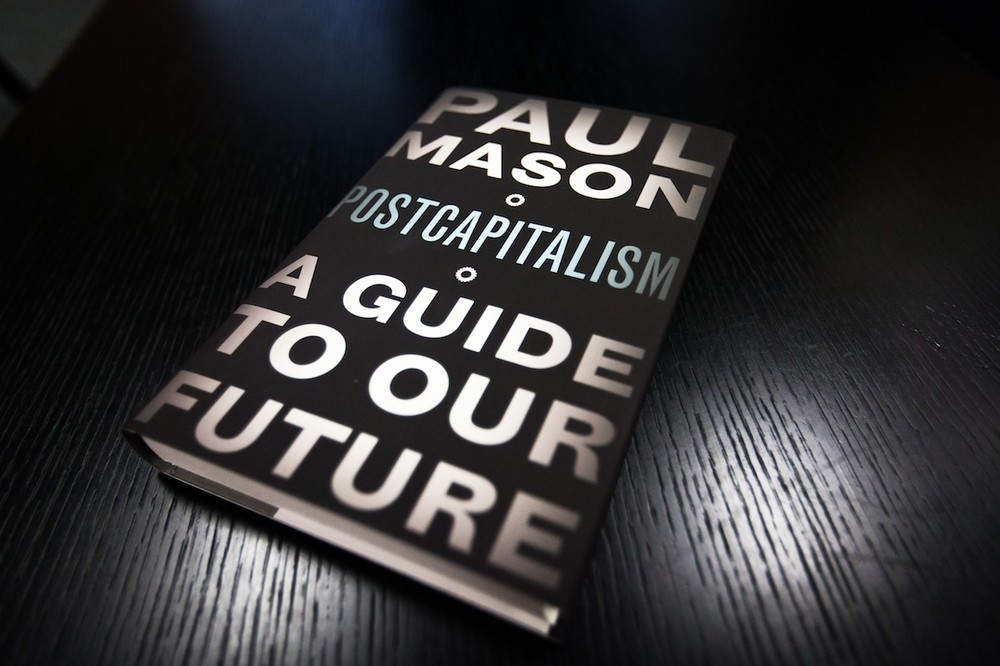 De façon magistrale, Mason tisse les différents fils de la très riche tapisserie du capitalisme du XXIe siècle pour expliquer comment interagissent technologie, économie et lutte des classes. En se basant sur la théorie des « cycles longs » du développement capitaliste, élaborée par l’économiste Kondratiev, Mason avance que des cycles plus longs recouvrent les hauts et bas fréquemment subis par le capitalisme, des « ondes » marquées par l’invention et la diffusion de certaines technologies clefs : les machines à vapeur et les canaux ; les chemins de fer et le télégraphe ; l’électricité, le téléphone, les techniques de gestion de la production ; l’automatisation, le plastique, les aéroplanes, les semi-conducteurs, et l’énergie nucléaire ; et maintenant, internet et les technologies de l’information.
De façon magistrale, Mason tisse les différents fils de la très riche tapisserie du capitalisme du XXIe siècle pour expliquer comment interagissent technologie, économie et lutte des classes. En se basant sur la théorie des « cycles longs » du développement capitaliste, élaborée par l’économiste Kondratiev, Mason avance que des cycles plus longs recouvrent les hauts et bas fréquemment subis par le capitalisme, des « ondes » marquées par l’invention et la diffusion de certaines technologies clefs : les machines à vapeur et les canaux ; les chemins de fer et le télégraphe ; l’électricité, le téléphone, les techniques de gestion de la production ; l’automatisation, le plastique, les aéroplanes, les semi-conducteurs, et l’énergie nucléaire ; et maintenant, internet et les technologies de l’information.
Bien que Mason campe sur une vision de l’Histoire quelque peu schématique, décrivant le capitalisme comme une série d’époques déterminées par des cycles, son explication des points de rupture des cycles longs se distingue de celle de Kondratiev et apporte une analyse plus matérialiste.
Alors que Kondratiev présentait sa théorie des cycles d’une manière extrêmement mécaniste et déterministe — d’ailleurs philosophiquement idéaliste —, voyant les conjonctures capitalistes comme technologiques avant tout, à travers des innovations qui transforment qualitativement la production, Mason fait un pas de plus et pose la question suivante : quelles conditions ont permis l’implantation de ces technologies dans la société ?
Comme nous l’avons évoqué auparavant, la technologie n’est pas un deus ex machina au milieu du système capitaliste, qui surgirait aléatoirement d’on ne sait où. Certaines conditions matérielles sont nécessaires pour que la science et la technologie puissent progresser. Bien que le succès de tel inventeur ou de telle innovation puisse comporter une part d’arbitraire, ces accidents sont toutefois le reflet d’une nécessité sous-jacente : au sein du capitalisme, le besoin de développer la productivité et l’appât du profit.
Pour Mason, la clef pour comprendre le développement de ces technologies historiquement révolutionnaires se trouve dans la question de la lutte des classes. Selon lui, ce qui précède tous ces points de basculement, dans les deux premiers siècles du capitalisme, sont les luttes militantes de la classe ouvrière se battant contre les tentatives des capitalistes d’abaisser les salaires et d’attaquer les conditions de vie. C’est cette résistance massive qui pousse les capitalistes à investir largement dans de nouvelles technologies, afin de pouvoir augmenter la productivité et donc leurs profits, tout en acceptant des niveaux de salaire plus élevés.
Selon Mason :
« Si la classe ouvrière peut résister aux coupes salariales et aux attaques contre la protection sociale, les innovateurs sont obligés de rechercher d’autres technologies et d’autres modèles de développement d’entreprise qui puissent restaurer un certain dynamisme sur la base de salaires plus élevés — par l’innovation et une hausse de la productivité, pas par l’exploitation…
… la résistance de la classe ouvrière peut être technologiquement progressiste, forçant l’émergence d’un nouveau paradigme sur des bases supérieures de productivité et de consommation. Cela contraint les “nouveaux hommes et femmes” de la prochaine ère à trouver un moyen de fournir une forme de capitalisme qui soit plus productive et qui puisse élever les salaires réels.
Les cycles longs ne sont pas provoqués simplement par la technologie et l’économie. Le troisième moteur est la lutte des classes. C’est dans ce cadre que la théorie de Marx sur les crises fournit une meilleure explication que la théorie de l’investissement épuisé de Kondratiev. » (Paul Mason,PostCapitalism, publié par Allen Lane publishers, 2015 hardback edition, p76)
Où donc se trouvent les technologies de l’information et internet dans le tableau dépeint dansPostCapitalism ? Selon Mason, la crise mondiale de 1970, qui a marqué la fin du boom d’après-guerre, est le point culminant de la quatrième onde longue de développement. Mais à la différence des précédentes, lors desquelles des luttes de classes massives avaient suivi les crises, la bataille qui a été engagée après la crise des années 1970 s’est soldée par des défaites. Le néolibéralisme, personnifié par Thatcher et Reagan, a vaincu. Les syndicats ont été battus ; le mur de Berlin est tombé et l’Union soviétique s’est effondrée ; le mouvement des travailleurs et la gauche se sont alors trouvés en déroute.
Les capitalistes sortirent victorieux de ces batailles et le système continua à grossir sur le dos de ceux qui avaient été battus. Les salaires dans les pays à un stade de capitalisme avancé furent bridés, la mondialisation décolla avec l’accès au marché de la Chine, de l’Europe de l’Est et de l’ancienne Union soviétique ; la croissance fut maintenue temporairement, de manière artificielle, avec la financiarisation et le développement massif du crédit.
La différence majeure à ce moment a été que la classe ouvrière n’est pas parvenue à résister aux attaques de la classe dirigeante et que les salaires n’ont pu être maintenus par la lutte. Il en résulta une économie qui, plutôt que d’investir dans la technologie et la productivité, devint de plus en plus parasitaire, avec une croissance basée sur du capital fictif, des bulles, de la spéculation et l’exploitation de millions de travailleurs à faible revenu dans les anciens pays coloniaux.
Mason dit que nous sommes actuellement au début d’un nouveau cinquième cycle du capitalisme, qui se produit au milieu de cette quatrième vague sclérosée. Mais ce cinquième cycle s’est déjà bloqué. La raison se trouve, selon Mason, dans la nature des forces technologiques motrices de cette dernière onde : l’information.
Les contradictions d’une économie basée sur l’information
Pour expliquer le blocage de cette cinquième onde, Mason nous embarque dans un rapide tour d’horizon de la théorie marxiste, examen de la théorie de la valeur et aperçu de l’analyse de Marx des crises capitalistes compris. Mason avance en effet qu’il est essentiel de reconnaître que le travail est à l’origine de toute valeur réelle pour comprendre les contradictions extrêmes de l’ère de l’information.
Tout au long de l’existence du capitalisme, les capitalistes ont, poussés par la compétition, réinvesti leurs profits dans de nouvelles technologies et techniques pour augmenter la productivité et diminuer les coûts, produisant plus avec moins. En diminuant leurs propres coûts de production sous les prix du marché, les capitalistes les plus productifs et les plus avancés peuvent dégager des profits élevés et éliminer leurs concurrents des marchés concernés. De telles innovations et méthodes ont cependant été rapidement généralisées à toute l’économie, ce qui a mené à la mise en œuvre d’une nouvelle valeur « socialement nécessaire ».
La tendance au sein du capitalisme est donc à une augmentation de la productivité et à une diminution du temps de travail requis pour la réalisation des biens nécessaires à la société. Des technologies telles que celles évoquées plus haut ont été révolutionnaires en ce sens qu’elles ont permis une stimulation qualitative de la productivité.
Mais dans une économie de l’information, cette tendance a atteint son extrême limite, soulignant ainsi les contradictions du capitalisme et son incapacité à utiliser le potentiel technologique existant. Par exemple, de nombreux biens que nous achetons aujourd’hui sont soit digitaux (musiques, vidéos, autres médias…), soit peuvent être massivement produits sur la base de l’information, par exemple les plans informatiques pour des produits imprimés en 3D. Dans le même temps, les moyens de production et l’infrastructure de production sont eux-mêmes maintenant digitaux (logiciels pour ordinateur, sites internet HTML…).
La montée en puissance d’une économie basée sur l’information a des implications révolutionnaires. La caractéristique unique de l’information digitale est de permettre la reproduction infinie et à coût quasi nul d’un produit de départ (fabriqué ou codé). La valeur (et donc le prix) de tels biens digitaux devrait donc tendre vers zéro, si un marché libre et en situation de parfaite compétition existait. Et dans les faits, des millions de personnes obtiennent gratuitement ces biens, que ce soit par téléchargement illégal ou à travers des logiciels « open source » tels que le navigateur Firefox ou la suite de logiciels Open Office.
Sous le capitalisme, en revanche, cela introduit une contradiction énorme. Les entreprises capitalistes ne produisent pas pour satisfaire des besoins, mais pour le profit. Mais comme les profits sont dérivés de la valeur produite par le travail, si le temps de travail socialement nécessaire (et donc la valeur) présent dans les biens est réduit à zéro, alors les profits tendent également vers zéro. D’où la difficulté que rencontrent de nombreuses compagnies des technologies de l’information pour monétariser leurs produits et services, comme nous l’avons vu précédemment.
Il en résulte que, pour nombres de ces compagnies, la principale source de revenus est la publicité, notamment à travers la vente très lucrative à des publicitaires des fichiers de données sur les utilisateurs, qui ont été préalablement collectées gratuitement.
L’autre alternative pour les entreprises des technologies de l’information, celle que l’on rencontre le plus souvent, est d’abolir le lien entre la valeur d’un bien et son prix, en renforçant une position de monopole et donc en écartant de l’équation les forces du marché. Comme Marx l’expliquait, à ce sujet, la loi de la valeur n’est vraiment qu’une tendance : là où il y a des monopoles ou des restrictions à l’approvisionnement en certains biens, les prix peuvent diverger radicalement des valeurs réelles.
Comme évoquée plus haut, la domination des monopoles dans le secteur des technologies de l’information est claire : Apple, Amazon, Facebook, Google… — toutes ces entreprises géantes basées sur l’information, dans leur quête de profits, font tout ce qui est en leur pouvoir pour empêcher la société de développer son potentiel de surabondance digitale. Mason l’explique ainsi :
« Quand vous pouvez copier-coller quelque chose, il peut être reproduit gratuitement. En termes économiques, cette opération a un coût marginal nul…
Ceci a des conséquences majeures sur le marché : quand l’économie est faite de biens d’information partageables, la concurrence imparfaite devient la norme.
L’état d’équilibre d’une économie basée sur les technologies de l’information est une situation dans laquelle les monopoles dominent et où les gens ont un accès inégal à l’information dont ils ont besoin pour prendre des décisions d’achat rationnelles. En bref, les technologies de l’information détruisent les mécanismes classiques de prix, selon lesquels la compétition entraîne la baisse des prix vers les coûts de production…
Avec le capitalisme de l’information, le monopole n’est pas simplement une tactique intelligente pour maximiser les profits : c’est la seule façon de faire tourner l’industrie. Le faible nombre de compagnies maîtrisant chaque secteur est frappant. La déclaration de principes d’Apple, pour l’exprimer clairement, est d’empêcher l’abondance de la musique. » (Postcapitalim, p.117-119)
Par leur nature même, par conséquent, les technologies de l’information ont mis en évidence la contradiction majeure au cœur du système capitaliste : celle entre valeur d’échange et valeur d’usage. Une abondance en valeurs d’usage (i.e la richesse) dans la société est totalement possible. Mais aussi longtemps que règnent propriété privée et profit, il est impossible de dépasser cette contradiction : au lieu de la surabondance, nous vivons le manque.
Cette contradiction mise en pleine lumière par les technologies de l’information apparaissait déjà pour d’autres de nos besoins plus tangibles, de l’alimentation (avec des supermarchés allant jusqu’à des mesures incroyables pour empêcher les gens de prendre les restes dans leurs bennes), aux médicaments (avec des compagnies pharmaceutiques géantes qui attaquent devant les tribunaux des producteurs de médicaments des pays en développement, pour avoir voulu réaliser des copies « génériques » de médicaments sous brevet).
En d’autres termes, les contradictions apparues avec les technologies de l’information ne sont pas nouvelles ou spécifiques ; elles sont simplement une forme aigüe de cette contradiction entre valeur d’échange et valeur d’usage ou, selon les mots de Mason, « entre les “forces productives” et les “rapports sociaux” ». Pour le dire autrement, nous avons la capacité productive de créer un état de surabondance et de pouvoir subvenir à une très large palette de besoins à l’échelle mondiale ; mais les « rapports de production » — la façon dont la production est possédée, contrôlée et organisée, ainsi que les lois et la logique du système qui en découlent — nous en empêchent.
Les technologies modernes de l’information ainsi que l’automatisation ont ouvert un monde regorgeant de possibilités jusqu’alors inimaginables. L’horreur et l’injustice résident dans le fossé séparant ce futur hypothétique – mais réalisable — et le futur (voire le présent) dystopique qu’offre le capitalisme :
« D’un point de vue technologique, nous allons vers des biens à coût nul, un travail impossible à mesurer, une croissance exponentielle de la productivité et un développement de l’automatisation des processus physiques. Socialement, nous sommes coincés dans un monde de monopoles, d’inefficience, au milieu des ruines du libre marché dominé par la finance et d’une prolifération de “jobs pourris”.
Aujourd’hui, la principale contradiction du capitalisme moderne oppose la possibilité de produire socialement des biens gratuits, en abondance, et un système de monopoles, de banques, de gouvernements qui se battent pour le contrôle du pouvoir et de l’information. »(PostCapitalism, p144, mis en gras dans le texte original).
« … le danger réel de la robotisation dépasse largement le chômage de masse : c’est l’épuisement de 250 ans de capitalisme et la création de nouveaux marchés dans lesquels les précédents sont totalement obsolètes.
… Nous devrions vivre une troisième révolution industrielle, mais le processus a calé. Ceux qui pointent du doigt des politiques faibles, des stratégies d’investissement insuffisantes et un monde de la finance arrogant se trompent de symptôme. Ceux qui essayent constamment de coiffer le marché de normes collaboratives se fourvoient tout autant.
Une économie basée sur l’information, qui tend vers des produits à coût nul et de faibles droits de propriété, ne peut pas être une économie capitaliste. » (PostCapitalism, p175, mis en gras dans le texte original).
Quelle voie suivre : postcapitalisme ou socialisme ?
Pour les marxistes, la résolution de cette contradiction est claire : nous avons besoin d’une révolution dans la façon dont la production est détenue, contrôlée, organisée ; d’une révolution dans le fonctionnement même de la société. Nous avons besoin d’abolir les lois et la logique du système capitaliste et de les remplacer par un nouvel ensemble de lois économiques, fondées sur la propriété collective, sur un plan rationnel de production, sur le contrôle et la gestion démocratiques. En d’autres mots : le socialisme ou la barbarie.
Pour Mason, toutefois, les perspectives et les solutions ne sont toutefois pas si évidentes. En évoquant une future « stagnation séculaire » et la catastrophe climatique imminente, Mason reconnaît que, sans un changement radical de société, l’humanité sera très certainement confrontée à la barbarie. Mais selon lui, l’alternative est le « postcapitalisme », pas le socialisme.
La description qu’il donne de ce postcapitalisme hypothétique rappellerait à beaucoup le socialisme : contrôle démocratique et public des banques et principaux monopoles ; investissements dans les technologies et l’automatisation pour réduire la valeur des biens ainsi que les heures de travail hebdomadaire à un strict minimum (et éventuellement à zéro) ; revenu de base universel, le besoin d’un salaire et d’argent disparaissant peu à peu avec l’avènement d’une économie fondée sur un plan de production commun, socialisé et démocratique.
Pourquoi donc ne pas appeler un chat un chat ? Pourquoi ce terme de « postcapitalisme » ? Une partie de cette question sémantique vient de la conception propre à Mason du socialisme, qui est assimilé tout au long du livre au régime bureaucratique stalinien du XXe siècle. En réalité, de telles sociétés n’avaient rien de socialiste ; elles n’en étaient que des caricatures difformes. Attaquer le socialisme à travers cet exemple, c’est attaquer un épouvantail.
Néanmoins, il y a bien une différence majeure entre Marx et Mason, d’ailleurs admise par ce dernier ; elle réside dans l’identification de l’agent qui mettra en œuvre cette transformation historique et radicale de la société.
Pour Marx, Engels, Lénine et Trotsky, l’agent révolutionnaire était la classe ouvrière consciente et organisée, les « fossoyeurs » que le capitalisme avait créés. Pour Mason, il existe un « nouveau sujet historique » : les « individus connectés », c’est-à-dire les masses éduquées, maniant le smartphone et présentes sur les réseaux sociaux. Selon Mason, l’échec du mouvement ouvrier à résister aux attaques de la classe dirigeante dans les années 1980, ainsi que la spontanéité et l’absence de hiérarchie des récents mouvements de masse qui sont descendus dans les rues à travers le monde, sont la preuve qu’il faut désormais regarder vers le « réseau » plutôt que vers la classe ouvrière organisée pour mettre en marche le changement révolutionnaire aujourd’hui nécessaire.
Mais — et ce sont les principales limites du livre de Mason, excellent par ailleurs – il y a deux failles majeures dans les conclusions tirées par l’auteur. Premièrement, même s’il est vrai que les organisations de la classe ouvrière ont été déficientes dans les dernières décennies, il est faux de supposer que les mouvements spontanés et horizontaux sont l’avenir.
Tout d’abord, ce n’est pas de la faute de la classe ouvrière si leurs organisations, ou plus précisément leurs dirigeants, leur ont fait défaut à des moments clefs de la lutte des classes. Les travailleurs ont fait tout ce qu’on pouvait attendre d’eux : du Venezuela à la Grèce, ils ont manifesté, tenu des grèves et élu des représentants de gauche radicale qui leur promettaient de changer le monde, promesses que ces représentants n’ont pas respectées. La tendance vers des mouvements spontanés, du printemps arabe aux indignés espagnols, n’est que le reflet de la débâcle des soi-disant dirigeants de la classe ouvrière ainsi que du manque de véritable direction révolutionnaire.
L’attrait d’une large part de la population (les « 99 pour cent ») pour ces mouvements de masse spontanés n’est pas un signe de la destruction ou de la mort de la classe ouvrière, bien au contraire : cela atteste de l’énorme prolétarisation qui a eu lieu dans la société, avec des couches moyennes maintenant précarisées et repoussées dans les rangs de la classe ouvrière par le capitalisme. Dans la Grande-Bretagne du XXIe siècle, des fonctionnaires, professeurs d’université et même des avocats se syndiquent et lancent des actions de grève.
En outre, il faut noter qu’aucun de ces mouvements spontanés n’a atteint un de ses buts. Dans un certain sens, Mason a raison : ce qu’il reste de #Occupy ou des indignés, ce sont des réseaux. Mais ce ne sont pas simplement des expériences utopiques ou des campements dans des parcs, mais des réseaux et des mouvements politiques organisés qui se sont rassemblés autour de figures radicales comme Bernie Sanders aux États-Unis ou Pablo Iglesias de Podemos. On pourrait dire la même chose de la montée du SNP en Écosse, du référendum « OXI » en Grèce ou du mouvement de masse derrière Jeremy Corbyn au Royaume-Uni. Les mouvements spontanés d’« individus connectés » se sont transformés en organisations et mouvements politiques avec un programme pour combattre l’austérité et changer la société.
Deuxièmement, alors que Mason souligne le rôle des réseaux, une grande partie de son dernier chapitre, qui décrit la transition vers le postcapitalisme, souligne le besoin d’utiliser l’État « pour faire usage du pouvoir gouvernemental de manière radicale et déstabilisante » afin d’amener « un réformisme révolutionnaire ». En d’autres termes, malgré tous ses discours sur les contradictions du capitalisme et le pouvoir révolutionnaire des « réseaux », Mason est pour un changement graduel, réformiste, mené par l’État, vers ce qui n’est in fine qu’une autre version, un peu plus radicale, du « capitalisme responsable » invoqué par de nombreux réformistes de gauche.
Le rôle de l’État est une question clef dans toutes ces discussions. Mason nous dit par exemple que « sous le postcapitalisme, l’État doit entretenir les nouvelles formes économiques jusqu’à ce qu’elles puissent décoller et fonctionner organiquement » (p273). Plus loin, lors d’une discussion sur les changements nécessaires sur les lieux de travail, Mason commente : « Qu’est-ce qui pourrait inciter les entreprises à entreprendre une de ces mesures ? La loi et la régulation. » (p277)
Encore ailleurs, on peut lire : « sous un gouvernement postcapitaliste, l’État, le secteur des affaires et les entreprises publiques pourraient être façonnés de façon à poursuivre des fins radicalement différentes à travers des changements législatifs relativement peu coûteux, soutenus par un programme radical de diminution de la dette » (p278). Au sujet des banquiers et de la finance, « l’intention n’est pas de réduire la complexité… mais de promouvoir la forme la plus complexe de finance capitaliste compatible avec un mouvement de l’économie vers une haute automatisation, un travail faible, et des biens et services bon marché et abondants. » (p283)
Mais tout au long de cette description du postcapitalisme et de la transition qui le précède, on ne nous dit pas quelle sorte d’État va se charger de cette transition, ni quelle classe contrôlera ce processus. Tout comme l’analyse réformiste de l’État et de la transition vers le socialisme mise en avant par les sociaux-démocrates au début du XXe siècle, contre lesquels Lénine a écrit en 1917 son chef-d’œuvre L’État et la révolution, on ne trouve que flou et obscurité dans la description faite par Mason de l’État postcapitaliste.
Si cet État postcapitaliste n’est pas qu’une version bienveillante de l’État bourgeois, alors on peut supposer qu’il s’agit d’un nouvel État, qualitativement différent, construit par les masses « connectées » pour prendre le contrôle des principaux leviers de l’économie, afin de contrôler et de diriger démocratiquement l’économie et la société. Mais alors il est bien question d’un État socialiste, un véritable État des travailleurs, opposé à l’État déformé ou dégénéré du régime bureaucratique stalinien.
Cependant, avec cet appel au « réformisme révolutionnaire », il semblerait que Mason fasse en réalité référence au premier, appelant l’État capitaliste à agir contre les intérêts de la classe dirigeante, à prendre le pouvoir des principaux monopoles qui contrôlent aujourd’hui la société et à finalement opérer la transformation vers une autre forme de société qui fonctionnerait en faveur des masses actuellement opprimées et exploitées par l’État capitaliste. On se demande alors, pourquoi donc un État capitaliste agirait-il pour miner l’existence même du capitalisme ?
Comme l’a montré l’exemple récent de la capitulation de Tsipras en Grèce, il n’y a pas de voie réformiste pour sortir de la crise du capitalisme. Toute tentative dans cette direction, plutôt que d’être soutenue par la bourgeoisie et l’État capitaliste, verra la puissance de la classe dirigeante, des médias et de l’État bourgeois utilisée pour écraser toute résistance aux besoins du capital.
La présentation de Mason des idées de Marx, son analyse de l’impasse actuelle du capitalisme et sa vision d’un potentiel futur fait d’abondance, fondé sur la technologie et l’automatisation, sont instructives et inspirantes. Cependant, finalement, ses conclusions sonnent faux à cause de ce qui semble être un pessimisme quant à la possibilité d’un changement révolutionnaire réel, doublé d’un manque de croyance dans la capacité de la classe ouvrière organisée à faire venir une telle transformation.
Malgré ses limites, PostCapitalism demeure une lecture extrêmement utile à toute personne qui rechercherait une plongée éclairée dans les contradictions du capitalisme et dans leur manifestation actuelle à l’heure de l’information et d’internet.
[« Postcapitalism : A Guide to our Future » par Paul Mason, actuellement disponible aux publications Alan Lane]
La solution : boycotts, loi ou organisation ?
Pour revenir au monde de l’économie « collaborative »/à la demande, de nombreuses « solutions » ont été mises en avant pour promouvoir les aspects les plus progressistes de ces nouveaux modèles en développement, mettant ainsi de côté leurs pires excès et leurs symptômes les plus horribles.
La solution la plus simpliste est de proposer aux consommateurs et aux usagers de boycotter les compagnies profiteuses qui sont au cœur de cette économie. Mais ce genre d’actions individuelles, même si elles sont pleines de bonnes intentions et de morale, n’ont que peu d’effet sur les contradictions majeures des modèles qui sont en train de se développer. En effet, en boycottant, le caractère progressiste de ces méthodes et technologies potentiellement révolutionnaires est également perdu : on jette le bébé avec l’eau du bain.
Oui, il existe une possibilité de créer de nouvelles versions de certains services à la demande, moins douteuses moralement, et de restaurer dans l’économie de partage une éthique originelle de la réciprocité altruiste. Mais, comme toutes les expérimentations utopiques à petite échelle, de telles tentatives sont condamnées à demeurer des îlots socialistes au milieu de l’océan capitaliste, incapables de lutter contre les multinationales entièrement tournées vers le profit, avec leur accès au capital, à de bas salaires et à des économies d’échelle.
Il est important de comprendre que le boycott des pommes véreuses et la promotion des exemples vertueux ne font finalement rien pour résoudre le problème fondamental de la propriété privée et de l’anarchie du marché. C’est ceci, et pas la morale de l’un ou l’autre capitaliste, qui est à l’œuvre derrière les tentatives de pousser les travailleurs dans l’économie à la demande. Ce n’est pas l’action individuelle, mais l’action collective qui permettra aux travailleurs de riposter. Selon les mots de Marx : « l’émancipation de la classe ouvrière doit être l’œuvre des travailleurs eux-mêmes ».
Ainsi, pour résister à cette course vers le bas, accélérée par l’économie à la demande, il est question d’essayer de syndiquer et d’organiser ceux qui se retrouvent à travailler, atomisés, dans ce secteur. Des conducteurs d’Uber ont formé des syndicats dans certaines villes ; ailleurs, des « syndicats en free-lance » ont été mis en place pour essayer de protéger des pires formes d’exploitation les travailleurs de l’économie à la demande.
Pour le moment, les travailleurs indépendants qui offrent leurs services via de telles applications rivalisent sur le prix et la qualité, à travers des classements donnés aux « exécutants » (taskers) par les clients, rendant la compétition entre travailleurs absolument évidente. Il a été suggéré de résister par la syndicalisation ou la réglementation, certaines propositions incluant l’introduction d’un taux de rémunération minimum pour tous ceux qui travaillent dans cette économie à la demande. Peu importe la façon dont on prend le problème, les règles du jeu sont très clairement en faveur des capitalistes.
Comme l’indiquait au New York Times Dean Baker, économiste dans un think tank à Washington, « les gens sont poussés à l’auto-exploitation d’une façon qui est pourtant interdite par la réglementation en place ». Stanley Aronowitz, chercheur à l’université de la ville de New York, déclare dans le même article que l’« on pourrait tout aussi bien appeler cela de l’esclavage salarié dans lequel toutes les cartes sont tenues, à travers la technologie, par l’employeur, que ce soit l’entreprise intermédiaire ou le client ».
Des suggestions similaires ont été faites pour l’économie « collaborative ». À l’heure actuelle, les grandes entreprises de cette économie n’offrent aucune protection à leurs fournisseurs ou à leurs clients. Par exemple, les hôtes d’AirBnB sont responsables de tout dommage, chose qui serait normalement couverte par les structures d’un marché d’hôtellerie normal. La même chose se produit dans l’économie à la demande pour les taxis d’Uber, qui doivent assumer la maintenance et l’assurance de leur véhicule. De nouveau, ce sont les travailleurs qui couvrent tous les coûts alors que les patrons récoltent les profits. À nouveau, la solution avancée par Juliet Schor, universitaire de Boston et rédactrice pour The Great Transition [NDT : La grande Transition], consiste en organisation et régulation :
« Une alternative… consisterait à intégrer les entités partageantes dans un mouvement plus large qui viserait à redistribuer la richesse et à encourager la participation, la protection de l’environnement et le lien social. Ceci ne pourra se produire qu’à travers l’organisation ou la syndicalisation des utilisateurs. Cette question de l’organisation est maintenant clairement sur la table, bien qu’il soit trop tôt pour juger de son évolution.
AirBnb a commencé à inciter ses utilisateurs à s’organiser… L’entreprise veut que ces groupes agissent pour une régulation qui lui soit favorable. Mais ils pourraient développer leur propre agenda, avec des demandes à la compagnie elle-même telles que des prix plancher pour les offres, une prise de risque par la plate-forme, la diminution des profits des entrepreneurs et des investisseurs de capital-risque. Du côté du travail, où le besoin d’organisation est peut-être plus fort, les fournisseurs pourraient exiger la mise en place de salaires minimum. »
Toute l’histoire du capitalisme est celle, d’une part, de patrons mettant tout en œuvre pour atomiser et exploiter les travailleurs, et d’autre part celle de travailleurs non organisés, qui s’unissent pour résister collectivement.
Par exemple, au début du XXe siècle, le travail dans les docks était extrêmement précaire, avec des travailleurs obligés de venir tous les jours dans l’espoir d’être choisis pour les quelques boulots restants. Dans les années 1970, les dockers étaient cependant très bien organisés, une des parties les plus militantes de la classe ouvrière. Aujourd’hui, nous assistons à des grèves des travailleurs américains de l’industrie du fast-food, autrefois connue pour être un des secteurs les plus difficiles où s’organiser.
Dans tous les cas, c’est à travers la lutte que l’organisation émerge. Mis dos au mur par l’appétit insatiable des capitalistes, les travailleurs aujourd’hui non organisés de l’économie à la demande pourraient devenir une composante puissante du mouvement des travailleurs de demain.
Il est question aujourd’hui d’utiliser des méthodes légales pour améliorer leur condition. De nombreux cas sont en train d’être soulevés afin de clarifier le statut légal des travailleurs de l’économie à la demande. Par exemple, Über se retrouve devant les tribunaux pour ne pas avoir donné à ses conducteurs le statut d’employés, mais celui de « travailleur indépendant ». La différence est de taille : le statut d’employé assure certaines garanties et dispositions légales, ainsi qu’un transfert de responsabilité vers la compagnie.
Il faut cependant garder le sens de la mesure : alors que des cas judiciaires individuels pourraient aider les travailleurs de telle ou telle entreprise à la demande, ce ne serait que des victoires à la Pyrrhus, qui seraient remportées au milieu d’un assaut global et frontal contre la classe ouvrière, les salaires, les emplois et les droits des syndicats. Comme Juliet Schor le souligne dans son article de The Great Transition :
« Ce qui rend difficile l’analyse des effets de ces nouvelles opportunités de rémunération est qu’elles émergent pendant une période de chômage fort, avec une restructuration rapide du marché du travail. Les conditions de travail ainsi que les différents mécanismes de protection sont déjà en train d’être érodés, les salaires réels diminuent, et la part de l’emploi dans le revenu national des États-Unis a atteint un sous-sol historique. Si le marché du travail continue d’empirer, les conditions des travailleurs s’effriteront toujours davantage et ce ne sera pas en raison d’une absence de possibilités de partage. À l’inverse, si le marché du travail s’améliore, les “partageux” (sharers) seront en mesure d’exiger plus des plateformes, car ils auront de meilleures alternatives. »
En dernière analyse, même si certains groupes seront en mesure d’améliorer leur condition grâce aux tribunaux, la Loi restera une composante de l’Etat capitaliste, conçue pour protéger les droits de propriété et les profits des riches.
Face à l’attaque globale de la classe dirigeante contre les travailleurs, il faut donc une résistance générale et une contre-attaque, pas seulement destinées à remporter quelques victoires juridiques ou obtenir quelques réformes particulières ; il faut un mouvement politique de masse qui ait pour objectif l’abolition de l’État capitaliste et des relations bourgeoises de propriété ainsi que la mise en place d’un plan socialiste de production avec propriété collective et contrôle démocratique par les travailleurs.
La première étape devrait être de demander la nationalisation et la transformation en services publics des grandes entreprises qui profitent de l’économie « collaborative »/à la demande. Si Über faisait partie d’un réseau de transport public, nationalisé et contrôlé démocratiquement (avec les trains, bus et vélos de location), alors les transports publics pourraient être planifiés très efficacement et à bas coût. Les chauffeurs se verraient garantir des conditions et un salaire décents, sans ressentir le besoin d’entrer en compétition les uns contre les autres. Finalement, avec l’automatisation et les voitures sans chauffeurs, les conducteurs pourraient être remplacés et bénéficier d’une formation à un autre emploi.
Un AirBnb public, allant de pair avec la nationalisation des principales chaînes d’hôtels et un développement massif des logements sociaux, pourrait être utilisé en attendant comme manière de fournir une maison ou des vacances peu chères à tous. Combiné avec un programme de nationalisations des banques et de la finance, les investissements pourraient être redirigés vers les transports publics, les logements et de nombreux autres secteurs. D’un coup, les besoins de la société pourraient être comblés et les emplois précaires éliminés.
Le carcan capitaliste et la nécessité d’une révolution
Dans un même temps, les questions légales relatives à l’économie « collaborative » soulignent les contradictions du capitalisme et en particulier les entraves que la propriété privée impose au progrès. D’un côté, le développement de cette économie augmente clairement le potentiel d’organisation et de redistribution rationnelle, juste et efficace, des ressources de la société. D’un autre côté, sous le capitalisme, des entreprises comme AirBnB ont provoqué le dépôt de nombreuses plaintes, où des locataires sont poursuivis par leurs propriétaires pour avoir sous-loué leurs chambres. Le besoin de distribution des logements entre donc en conflit avec les lois élaborées pour protéger les droits des propriétaires (privés) et le revenu de leur rente.
De tels cas judiciaires ne font que nous renvoyer à l’argumentation de Marx dans sa Préface à la Critique de l’économie politique :
« À un certain stade de leur développement, les forces productives matérielles de la société entrent en contradiction avec les rapports de production existants ou – pour le dire en termes juridiques — avec les rapports de propriété au sein desquels elles s’étaient mues jusqu’alors. De formes de développement des forces productives qu’ils étaient, ces rapports en deviennent des entraves. » (nous soulignons)
En d’autres termes, les rapports juridiques — ie les rapports de propriété — que nous connaissons dans la société capitaliste ne sont pas compatibles avec les technologies et le potentiel scientifique que le capitalisme a créés. La présence d’une telle contradiction augure, comme l’indique Marx, l’avènement d’une « ère de révolution sociale ».
Selon Juliet Schor dans son article intitulé « Débattre de l’économie collaborative » :
« … les nouvelles technologies des activités économiques de pair à pair sont des outils potentiellement puissants pour créer un mouvement social centré sur de véritables pratiques de partage et de coopération dans la production et la consommation des biens et services. Mais la réalisation de ce potentiel nécessite la démocratisation de la propriété et de la gouvernance des plateformes[de partage].
L’économie collaborative a été propulsée par ces nouvelles technologies excitantes. La facilité avec laquelle les individus, même les étrangers, peuvent désormais se connecter, échanger, partager de l’information et coopérer peut réellement transformer les choses. C’est la promesse d’une nouvelle plateforme de partage au sujet de laquelle tout le monde s’accorde. Mais le bienfait des technologies dépend du contexte politique et social dans lequel elles sont employées. Les logiciels, le crowdsourcing [production participative] et les biens communs de l’information nous donnent de puissants outils pour construire une société sociale, solidaire, démocratique et soutenable. Notre tâche est de construire un mouvement pour canaliser ce pouvoir. » (Nous soulignons)
La professeur Schor apporte une perspective matérialiste inspirante sur la question des nouveaux modèles et technologies émergeant. Comme nous l’avons évoqué précédemment, et comme elle le souligne ici, sous le capitalisme, le potentiel de ces technologies ne restera que cela : un potentiel.
« Aucun ordre social n’est détruit avant que toutes les forces productives qu’il contenait ne soient développées, et de nouveaux rapports de production ne remplacent jamais les anciens avant que les conditions matérielles de leur existence n’aient suffisamment mûri, dans le cadre de la vieille société.
L’humanité n’aborde que des problèmes qu’elle est capable de résoudre, car une observation plus attentive montrera toujours que le problème n’arrive que quand les conditions matérielles de sa résolution existent déjà ou sont en voie de devenir. » (Marx, Préface à la Critique de l’économie politique).
Cette citation de Marx illustre parfaitement la situation actuelle. Comme Mason et d’autres l’ont souligné, il existe maintenant un vaste potentiel pour : allouer les ressources de manière efficace et équitable ; gérer démocratiquement la production et la société de manière rationnelle ; et accroître considérablement le niveau de vie tout en réduisant le temps de travail hebdomadaire. La maxime de Marx « de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins » pourrait être facilement mise en œuvre.
Mais tant que nous serons entravés dans les limites du système capitaliste, ce potentiel sera gâché. Tant que les monopoles géants – du monde des technologies de l’information, de la finance, etc. — demeureront des propriétés privées, l’anarchie du marché continuera de régner.
Toute tentative de « démocratiser » ou de « socialiser » ces nouvelles plateformes et technologies entrera en conflit avec les rapports de propriétés, sociaux et légaux qui existent actuellement – rapports conçus pour défendre la propriété privée et les profits des 1 %. Une rupture révolutionnaire d’avec le capitalisme sera nécessaire.
Nous vous invitons à nous rejoindre dans le combat pour la révolution, afin que nous puissions enfin libérer l’immense potentiel créatif et technologique qui s’offre aujourd’hui à l’humanité.