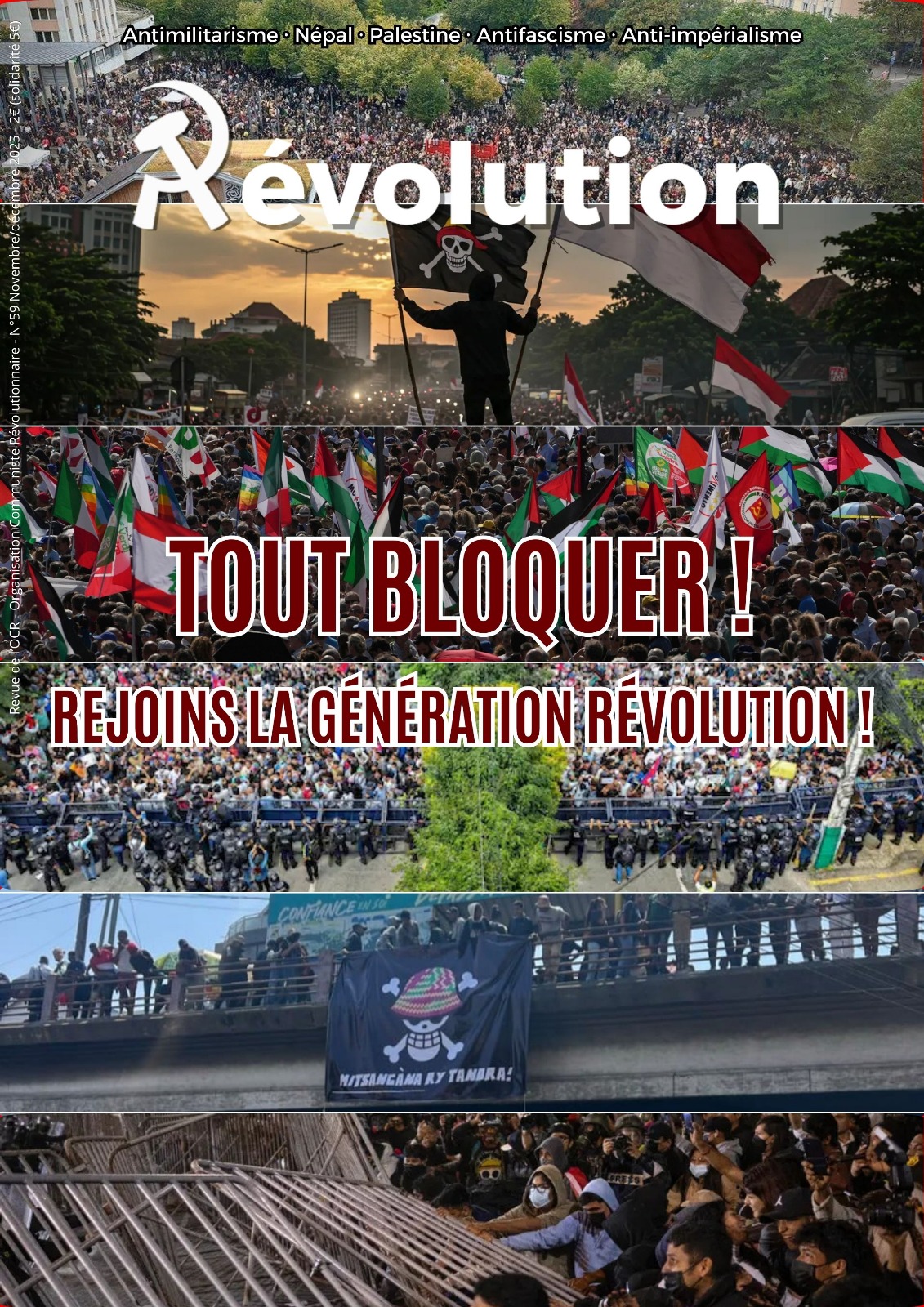Vu la grande actualité de la crise de l'UE et de la Grèce nous mettons en ligne notre brochure 'Crise, dettes et faillites - Quelle alternative à l'UE capitaliste ?'.
 La crise du capitalisme soumet les travailleurs à une pression sans précédent, avec son lot de licenciements, de coupes budgétaires et de plans d’austérité. De même, elle met à l’épreuve les idées politiques et les programmes de toutes les forces syndicales et politiques du mouvement ouvrier. Dans toute l’Europe, les partis réformistes se sont pleinement adaptés aux logiques du système et sont en première ligne pour imposer les politiques « d’assainissement » des comptes publics. Les dirigeants des principales organisations syndicales se trouvent complètement incapables d’organiser une riposte à la hauteur de la situation.
La crise du capitalisme soumet les travailleurs à une pression sans précédent, avec son lot de licenciements, de coupes budgétaires et de plans d’austérité. De même, elle met à l’épreuve les idées politiques et les programmes de toutes les forces syndicales et politiques du mouvement ouvrier. Dans toute l’Europe, les partis réformistes se sont pleinement adaptés aux logiques du système et sont en première ligne pour imposer les politiques « d’assainissement » des comptes publics. Les dirigeants des principales organisations syndicales se trouvent complètement incapables d’organiser une riposte à la hauteur de la situation.
Tout cela met à nu le vide existant à gauche. Il existe bien un débat parmi les forces de la gauche « radicale » et dans les secteurs syndicaux plus combatifs sur les alternatives possibles aux politiques dominantes, mais une position claire en capacité de rassembler la classe ouvrière peine encore à émerger.
Ici et là on se plaint que les travailleurs ne réagissent pas et qu’il y a trop de passivité dans la société. Nous pensons que ce n’est qu’une excuse de la part de groupes dirigeants. Il est vrai que la crise rend difficile l’organisation de la lutte dans les lieux de travail, mais la colère dans la société est énorme et ne cesse de croître. En ce sens la Grèce nous montre notre futur, non seulement concernant le caractère particulièrement profond de la crise, mais aussi en matière de réaction massive des travailleurs.
Le mouvement ouvrier a besoin avant tout de sentir qu’il existe au sein de ses propres groupes dirigeant une clarté d’idées, de programmes et de propositions d’action. Malheureusement, ce qui est transmis en ce moment est tout le contraire : confusion, peur et soumission aux arguments de l’adversaire.
On trouve essentiellement trois positions dans le débat politique :
La bourgeoisie dit : « la dette doit être remboursée, coûte que coûte, grâce à des décennies d’austérité ». Sur ce point, il n’y a pas de divergences fondamentales entre les grandes forces politiques, bien qu’il existe un conflit, parfois latent, parfois ouvert, entre débiteurs et créditeurs.
Une seconde position dit : « la dette doit être remboursée, mais son poids doit être distribué de manière égale entre les différentes classes sociales » ; c’est la position des directions syndicales et des dirigeants réformistes ; on l’entend également dans le Parti Démocrate italien[2], Ferrero).
Il existe un autre point de vue, dans lequel nous nous reconnaissons, selon lequel la question du remboursement de la dette ne relève pas de catégories morales ou légales (dette « juste », dette « légitime », etc.), mais doit être insérée dans une lecture globale de la crise et des tâches que celle-ci assigne au mouvement ouvrier.
Les questions fondamentales à se poser sont :
Quelle position correspond à une analyse correcte de la crise économique ?
Laquelle correspond aux intérêts des travailleurs et des classes populaires ?
Qu’est-ce que ces deux positions impliquent au niveau pratique ?
« Le droit à l’insolvabilité » : l’analyse de F. Chesnais
Parmi les diverses voix qui proposent la non-reconnaissance de la dette et son non-remboursement tout au moins partiel, nous prenons en référence un livre sorti récemment et qui résume les arguments principaux : il s’agit de Les dettes illégitimes : Quand les banques font main basse sur les politiques publiques, de François Chesnais, économiste lié à l’association Attac et au NPA, en France.
Dès le titre, il apparait que Chesnais propose une approche de type moral, qu’il résume ainsi : « L’analyse des origines de la dette de la France aidera à cerner la notion de "dette illégitime" et donc à poser la question de son annulation, non seulement d’un point de vue économique, mais comme question politique à fondement éthique ».[4]
Ce n’est pas un hasard si son analyse défend la vieille idée qui oppose l’économie « réelle » à la « finance » – et distingue même à l’intérieur de la finance une partie « légitime » et une « illégitime ». Certes, l’histoire que Chesnais propose de ces dernières décennies est grosso modo acceptable (bien qu’assez sommaire) ; ce qui est désespérément inutile, c’est l’explication qu’il en donne et les propositions qui en dérivent.
Après la grande crise de 1929-33, explique-t-il, la finance fut lourdement réduite à cause de la chute des valeurs en bourse et des faillites ; les Etats, Etats-Unis en tête, codifièrent une série de normes qui limitaient le secteur bancaire ; en général, les créditeurs étaient en position plus faible par rapport aux débiteurs. Passées les « trente glorieuses » de l’après-guerre, le processus s’est inversé : les Etats ont élargi les mailles du filet, un énorme secteur financier s’est alors reconstitué, grâce aussi à la collecte de l’épargne dans les fonds de pension, les fonds d’investissement, etc. Les vieux patrons du secteur industriel ont été remplacés par des managers qui, au lieu de penser à la production, regardaient surtout le rendement en bourse et les bilans trimestriels. Un secteur bancaire « de l’ombre » a explosé qui, en manipulant des produits financiers toujours plus ésotériques et à risque, a submergé tout le système jusqu’à la crise de 2007.
Tout cela est assez juste et c’est une histoire désormais connue, lue dans les journaux, vue dans les films et les chroniques de tous les jours. Le fond de la question est cependant ailleurs : pourquoi tout cela est-il arrivé ? S’agit-il d’une anomalie ou de mauvais choix ? Cette question n’est pas académique, puisque du bon diagnostic découlent nécessairement le pronostic et le traitement adaptés.
Chesnais fait quelques concessions verbales à la terminologie classique du marxisme, par exemple quand il rappelle que « les banques n’ont jamais été de simples intermédiaires. Depuis leur transformation en groupes financiers diversifiés, elles le sont moins que jamais. Les profits bancaires proviennent de leurs opérations de création de crédit. Leur source se trouve dans le flux de richesse (valeur et plus-value) venant des activités de production ».[6], mais que si « on continue souvent de réduire la crise économique mondiale à son aspect financier, (...) en arrière-plan il y a eu une suraccumulation de moyens de production et une surproduction de biens ».[8], comme c’est arrivé aux pays sous-développés, dont la dette a été restructurée seulement après qu’ils ont été pressés comme des citrons. « En tant que mot d’ordre de mobilisation politique de masse, celui de l’annulation ou de la dénonciation des dettes a plus de chances d’être compris que celui de restructuration ».[10] En résumé : on est au beau milieu de la plus grande crise capitaliste depuis un siècle ; la solution ? Construire des « comités » ! Misère profonde des réformateurs sociaux…
La Grèce et l’Argentine
En réalité, la faillite, c’est-à-dire l’insolubilité, ne constitue pas en soi une rupture avec le capitalisme. Sont alors en faillite les familles, les entreprises, les collectivités locales et même les Etats. Le point-clé ne relève pas de la technique économique, mais des rapports politiques.
Récemment (fin février 2012) a été signé le énième plan « d’aide » à la Grèce, c’est-à-dire aux banques créditrices, pour 130 milliards d’euros. En échange d’un nouveau plan d’austérité draconien, les créditeurs privés ont accepté une réduction de la valeur nominale de leurs propres crédits de 53,5 %, pendant que la part restante était convertie en nouveaux titres pour trente ans à un taux moyen de 3,65 %. Les banques centrales d’Europe et la BCE renoncent aux profits sur les prêts accordés jusqu’ici. L’objectif déclaré est de réduire le rapport dette/PIB à 120 % d’ici 2020, contre 160 % aujourd’hui. Qu’est-ce donc, sinon une insolubilité partielle et concordée ? La dette insolvable est mise sous tutelle ; on exige des modifications législatives et constitutionnelles qui imposent comme priorité le remboursement des intérêts, la surveillance permanente de la « troïka » (BCE, Union Européenne, FMI) et la possibilité pour les créditeurs de prendre possession de biens nationaux.
Voici l’appréciation qu’en donne le Financial Times du 26 février 2012 : « C’est un accord auquel personne ne croit, pas même ceux qui l’ont négocié. Les procédures continueront, mais d’une manière ou d’une autre la Grèce finira en faillite. » Sur les bases actuelles, le plan est irréaliste : l’austérité aggravera la récession, le PIB continuera de baisser et le tristement célèbre rapport dette/PIB ne pourra qu’augmenter. L’article signé Wolfgang Munchau se poursuit en indiquant sans demi-mesure que les alternatives sont au nombre de deux : insolubilité et retour à la drachme, ou insolubilité en restant dans l’euro : « la première est la plus probable, la seconde la plus souhaitable ». L’accord sert seulement à gagner une année pour appliquer les coupes budgétaires, inévitables dans tous les cas, et revenir à un solde primaire positif (c’est-à-dire l’actif du bilan de l’Etat net du paiement des intérêts sur la dette) qui permette d’ici un an de ne plus reconnaitre une part importante des propres dettes. L’objectif : dévaluation « à double chiffre », gel des salaires même en cas de forte inflation et relance par ce fait des exportations et du tourisme. Tout cela serait plus crédible si le problème grec était un cas isolé. Dans le contexte d’une crise de système comme actuellement, il reste encore à démontrer que cela puisse produire quelque effet positif, qui de toute façon serait construit sur des coupes – sans précédant en temps de paix – dans les salaires, les retraites, les prestations sociales, mais aussi sur la colonisation économique du pays mis en solde.
Souvent, à gauche, on cite l’exemple de l’Argentine, qui en décembre 2001 a connu la chute de ses banques, la faillite et la rupture de la parité avec le dollar – et en conséquence une dévaluation de 72 %. Aujourd’hui, dit-on, l’Argentine exporte, a un faible taux de chômage et a même renationalisé quelques entreprises. On oublie toutefois les faits suivants. Premièrement : la faillite argentine a été payée de toute manière par les travailleurs et la classe moyenne avec la destruction de l’épargne, un chômage en expansion et l’appauvrissement généralisé dans les premières années – et encore aujourd’hui les salaires et les horaires de travail restent parmi les plus bas du continent. Deuxièmement : les pertes des banques ont été largement indemnisées (35 milliards de dollars). Troisièmement : l’Argentine est un exportateur agricole qui a profité de la dévaluation pour renforcer sa balance commerciale, soutenue aussi par des politiques protectionnistes. Quatrièmement : tout de suite après la crise s’est ouvert à l’échelle mondiale un nouveau cycle d’expansion, en particulier de l’économie chinoise, avide de matières premières agricoles et industrielles, qui a ouvert des débouchés importants pour les exportations argentines.
Rien de tout cela n’est présent à ce jour. Au contraire, si des économies importantes comme l’Italie s’engageaient dans la voie des dévaluations compétitives, s’ouvriraient alors une guerre commerciale et une vague de protectionnisme à l’échelle internationale – ce qui ne ferait qu’aggraver la crise.
Quelle analyse de la crise ?
Il est donc juste donc de dire que dans nombre des propositions liées à cette idée d’une faillite on trouve une forte dose d’utopisme qui conditionne négativement les programmes et les plans d’action.
Aux racines de tout ceci se trouve une lecture erronée de la crise et de la nature même du système capitaliste. Nous estimons utile d’exposer ici de nouveau quelques points centraux de l’analyse marxiste proposée en particulier dans le IIIe livre du Capital, qui constitue encore aujourd’hui un instrument irremplaçable pour comprendre en profondeur les mécanismes de ce système économique.
Il y a deux questions fondamentales à se poser : 1) Quelle est la nature de cette crise ? 2) En particulier, quel est le rôle du secteur financier qui semble en être le centre, d’abord avec les crises boursières et bancaires – et désormais avec la crise des dettes souveraines ?
Cela a-t-il un sens de parler de crise financière en l’opposant à l’économie réelle ? Cela a-t-il un sens de tracer une distinction entre finance et industrie ou même, comme semble le proposer Chesnais (et avec lui beaucoup d’autres), une distinction entre la finance « saine » ou « normale » et la finance « spéculative » ?
On entend souvent que Marx a analysé le capitalisme du XIXe siècle, alors qu’une série de phénomènes étaient encore embryonnaires ou inconnus, en particulier le rôle de la finance et de la Bourse, ou encore les politiques monétaires. Cependant, une lecture attentive montre que Marx était parfaitement conscient du rôle spécifique du capital financier et de la relation entre ce dernier et le cycle économique. L’idée selon laquelle le Capital peut être utile pour comprendre la réalité de l’usine, mais non les dynamiques générales du système, est une falsification. L’analyse des développements que le capitalisme a connus durant le siècle suivant exige sans aucun doute des instruments spécifiques, mais de tels instruments trouvent leur fondement véritable dans l’analyse marxiste.
« Dans un système de production où tout l’édifice complexe du procès de reproduction repose sur le crédit, si le crédit cesse brusquement et que seuls aient cours les paiements en espèce, on voit bien qu’une crise doit alors se produire, une ruée sur les moyens de paiement. A première vue donc, toute la crise se présente comme une simple crise de crédit et d’argent. Et, en fait, il ne s’agit que de la convertibilité des effets de commerce en argent. Mais dans leur majorité ces traites [Marx utilise ce terme de “traites”, dans ce chapitre et dans d’autres, pour indiquer en général toute promesse de paiement] représentent des ventes et des achats réels, dont le volume dépasse les besoins de la société, ce qui est en définitive à la base de toute la crise. Mais parallèlement, une quantité énorme de ces effets ne représente que des affaires spéculatives qui, venant à la lumière du jour, y crèvent comme des bulles ; ou encore ce sont des spéculations menées avec le capital d’autrui, mais qui ont mal tourné ; enfin des capitaux-marchandises qui sont dépréciés ou même totalement invendables, ou des rentrées d’argent qui ne peuvent plus avoir lieu. Tout ce système artificiel d’extension forcée du procès de reproduction, ne saurait naturellement être remis sur pied parce qu’une banque, la Banque d’Angleterre par exemple, s’avise alors de donner à tous les spéculateurs, en papier-monnaie émis par elle, le capital qui leur manque, d’acheter à leur ancienne valeur nominale la totalité des marchandises dépréciées. Du reste, tout est ici à l’envers, car dans ce monde de papier, n’apparaissent nulle part les prix réels et ses éléments concrets : il n’est jamais question que de lingots, espèces métalliques, de billets de banque, d’effets de commerce, de titres. C’est surtout le cas dans les centres comme Londres, où se concentrent toutes les manipulations financières de la nation, que se manifeste ce renversement des notions : toute l’affaire devient incompréhensible. »[12]
« La tendance progressive à la baisse du taux de profit général est donc tout simplement une façon, propre au mode de production capitaliste, d’exprimer le progrès de la productivité sociale du travail. » [14]
Le taux de profit est directement lié à la surproduction : « Par ailleurs si le taux de mise en valeur du capital total, le taux de profit, est bien l’aiguillon de la production capitaliste (de même que la mise en valeur du capital est son unique fin), sa baisse ralentira la constitution de nouveaux capitaux autonomes et elle semble dès lors menacer le développement du procès de production capitaliste, elle favorise la surproduction, la spéculation, les crises, la constitution de capital excédentaire à côté d’une population en excédent. »[16]
« La véritable barrière de la production capitaliste, c’est le capital lui-même : le capital et sa mise en valeur apparaissent comme point de départ et point final, moteur et fin de la production. »[18]
Production et finance
Marx était bien conscient du fait que le système financier n’est pas un simple appendice juxtaposé au processus productif, mais fait partie intégrante du système capitaliste et, en un certain sens, précède son développement. Les points essentiels de son analyse sont les suivants :
1) La plus-value ne se transforme pas intégralement en profit, mais se décompose en trois parties : profit (revenu de l’industriel), rente (revenu du propriétaire terrien) et intérêt (revenu du banquier). Toutefois, quelle que soit la subdivision interne entre ces trois éléments, ils dérivent tous du travail non payé, de la plus-value générée lors du processus productif. « Cette part du profit qu’il lui paye [que l’industriel paye à qui lui a accordé un prêt] s’appelle intérêt et n’est donc rien d’autre qu’une appellation, une rubrique particulière pour une partie du profit que le capitaliste actif doit payer au propriétaire du capital, au lieu de le mettre dans sa poche. »[20]
« Ces deux formes, intérêt et profit d’entreprise, n’existent qu’opposées l’une à l’autre. Ni l’une ni l’autre ne se rapportent à la plus-value dont elles ne sont que des parties classées dans des catégories, des rubriques différentes et sous des noms divers, mais elles se rapportent l’une à l’autre. »[22]
« Dans sa tête [de capitaliste industriel] se formera nécessairement l’idée que son profit d’entreprise, loin de s’opposer de façon quelconque au travail salarié et d’être seulement du travail d’autrui non payé, s’identifie plutôt à une rémunération de travail ou de surveillance, wages of superintendence of labour ; il considère que son salaire est supérieur à celui d’un simple salarié, 1° parce que son travail est plus complexe ; 2° parce qu’il se rétribue lui-même. »[24]
3) La forme de l’intérêt, c’est-à-dire de l’argent qui se multiplie soi-même, devient la forme plus générale et poussée à l’extrême du processus de valorisation du capital. En même temps, c’en est aussi la forme la plus mystifiée, en tant qu’elle s’éloigne le plus de l’origine effective de toute croissance du capital – c’est-à-dire l’appropriation du travail d’autrui.
« D–D’ […], de l’argent créant de l’argent. C’est là la formule générale et première du capital condensée dans un raccourci dépourvu de sens […]. C’est donc dans le capital porteur d’intérêt que ce fétiche automate est clairement dégagé : valeur qui se met en valeur elle-même, argent engendrant de l’argent ; sous cette forme, il ne porte plus les marques de son origine. Le rapport social est achevé sous la forme du rapport d’un objet, l’argent, à lui-même. Au lieu de la véritable conversion d’argent en capital, c’est seulement sa forme vide de contenu que nous voyons ici. […] L’argent acquiert ainsi la propriété de créer de la valeur, de rapporter de l’intérêt, tout aussi naturellement qu’un poirier porte des poires. […]
« Mais il y a encore ceci qui apparaît à l’envers : tandis que l’intérêt n’est qu’une partie du profit, c’est-à-dire de la plus-value que le capitaliste actif extorque à l’ouvrier, l’intérêt se présente maintenant, à l’inverse, comme le fruit proprement dit du capital, comme la chose première […] – la mystification capitaliste dans sa forme la plus brutale.
« Pour les économistes vulgaires qui essaient de présenter le capital comme source indépendante de la valeur et de la création de valeur, cette forme est évidemment une aubaine puisqu’elle rend méconnaissable l’origine du profit et octroie au résultat du procès capitaliste de production – séparé du procès lui-même – une existence indépendante. »[26]
Spéculation et capital fictif
La séparation et l’opposition (dans les termes expliqués au-dessus) entre le capital financier et le capital industriel sont la base d’un mouvement indépendant du premier, que ce soit sous forme de crédit au commerce, à l’investissement, de dette publique, etc. ; il acquiert alors sa propre autonomie à l’égard de la base réelle de la production et de l’exploitation. Le crédit et la création de monnaie vont de pair, comme la multiplication de valeurs en papier qui circulent exclusivement sur la confiance.
« Crédit et capital fictif. Tout comme ces avances réciproques entre producteurs et commerçants constituent la base véritable du crédit, leur instrument de circulation, la traite [sous le nom de “traite”, Marx regroupe ici toutes les formes de promesses de paiement – ndlr], constitue la base de la monnaie de crédit proprement dite, billets de banque, etc. Ces derniers ne reposent pas sur la circulation d’argent, qu’il s’agisse d’argent métallique ou de papier-monnaie d’Etat, mais sur la circulation des traites. »[28]
Pour soutenir l’édifice spéculatif (mais également l’élargissement effectif de la reproduction du capital), tout revenu monétaire est ratissé et conduit vers le marché des capitaux.
« On appelle capitalisation la constitution du capital fictif. On capitalise n’importe quelle recette se répétant régulièrement en calculant, sur la base du taux d’intérêt moyen, le capital qui, prêté à ce taux, rapporterait cette somme. […] Ainsi, il ne reste absolument plus trace d’un rapport quelconque avec le procès réel de mise en valeur du capital et l’idée d’un capital considéré comme un automate capable de créer de la valeur par lui-même s’en trouve renforcée. »[30]
Le keynésianisme et le mouvement ouvrier
Si nous considérons le développement du capitalisme au cours des dernières décennies à la lumière de ces catégories, une analyse est possible qui ne s’arrête pas aux banalités des « économistes vulgaires » qui non seulement existent aujourd’hui comme au temps de Marx, mais dont on peut dire que leur analyse s’est imposée comme la grille de lecture dominante dans le monde académique et dans le débat politique et économique.
De ce point de vue, malgré toute l’acuité qu’on veut bien lui reconnaître, Keynes ne fait pas exception dans le sens où sa position, synthétisée dans sa célèbre Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie (1936) repousse toute tentative de fonder ses propres analyses sur une compréhension de la nature matérielle et sociale du système capitaliste (elle est d’ailleurs complètement anhistorique).
Certes, après la grande crise de 1929-33, Keynes a réussi à mettre en discussion plusieurs fondements des écoles bourgeoises qui le précédaient. Après la chute de Wall Street, la ruine de pays entiers, l’extension du chômage de masse aux Etats-Unis et en Europe, il n’était pas difficile de comprendre que les vertus « autorégulatrices » du système devaient être mises en cause et rejetées – pour sauver le système capitaliste lui-même.
Les points que Keynes conteste à ses prédécesseurs sont au nombre de trois :
1) L’équilibre automatique entre offre et demande, c’est-à-dire la prétendue « loi de Say », qui soutient que, du moment que toute vente est aussi acquisition et vice-versa, l’offre crée d’elle-même sa propre demande. 2) Le fait que les taux d’intérêt tendent vers un équilibre qui correspond au plein emploi. Keynes souligne que cet équilibre peut – et c’est de facto ce qui se passe – se trouver en dessous d’une telle condition. 3) Keynes défend l’abandon de l’étalon-or et l’adoption d’une devise standard internationale comme moyen de paiement (mais pas comme réserve).
L’objectif qui sous-tend ces idées n’est donc pas la critique du capitalisme, mais sa correction. Keynes propose trois leviers pour intervenir : garantir l’offre de monnaie de la part d’une banque centrale publique ; augmenter la demande au moyen de la dépense publique, même en créant des déficits si nécessaire, soit par des investissements directs de l’Etat, soit par une dépense improductive (Keynes précise qu’il s’agit de créer cette demande en construisant – indifféremment – des pyramides, des armes ou des logements sociaux) ; enfin, contrôler l’inégalité excessive des revenus au moyen de la politique fiscale, Keynes considérant que les bas revenus sont ceux qui impliquent une propension majeure à la consommation.
C’est sur ces bases que le keynésianisme a été pendant des décennies le point de référence d’une grande partie des bureaucraties syndicales, des partis sociodémocrates – et a même largement influencé de nombreux partis communistes. De fait, toutes les propositions actuelles sur la « taxation de la finance », la « réforme du statut de la BCE », la « régulation de la finance », etc., s’inspirent toutes des positions de Keynes. Non seulement la gauche réformiste, mais également la gauche dite « radicale », sont complètement imprégnées de ces idées.
La critique de Keynes porte sur quelques aspects du système capitaliste, en particulier la spéculation boursière (qu’il compare à un « concours de beauté ») et l’absence d’un quelconque fondement réel au revenu du capitaliste financier, au point que Keynes s’autorise à parler d’« euthanasie du rentier ». La faiblesse de son raisonnement émerge précisément là où sa critique apparait la plus efficace, puisque l’idée de pouvoir réguler le système en éliminant quelques aspects liés à la financiarisation débridée, à la spéculation, à l’irrationalité de politiques économiques déterminées, mais sans remettre en cause le capitalisme en tant que tel, le conduit à de curieuses « utopies » : celle d’un système grosso modo stagnant – ou encore celle d’une société sans argent, mais pourtant fondée sur l’échange mercantile.
Du point de vue théorique, cette bizarrerie repose sur une théorie de la monnaie qui ne distingue pas entre marchandise, monnaie et capital – et qui décrit la monnaie successivement comme un moyen de paiement, un moyen d’échange ou un capital, sans jamais expliquer les liens inextricables entre ces diverses fonctions, et surtout sans expliquer leur fondement social. Cela découle du fait que Keynes rejette la théorie marxiste de la valeur-travail.
Le nom de Keynes a été associé, surtout à gauche, à l’époque du boom économique qui a suivi la Seconde Guerre mondiale. Puisque cette époque a coïncidé avec une phase générale de réformes sociales, on a établi l’équation suivante : politiques keynésiennes = croissance économique = vaste espace politique pour le réformisme.
Les dirigeants du mouvement ouvrier ont été (et sont encore aujourd’hui) dominés par l’idée qu’on pouvait s’allier avec le capital « productif » contre le capital « financier ». Par exemple, au sein du Parti Communiste Italien des années 60-70, l’idée circulait d’un « pacte des producteurs », c’est-à-dire d’une alliance entre travailleurs et capitalistes industriels contre « la rente ». La fin de cette histoire est bien connue : confirmant l’analyse de Marx citée ci-dessus, la « rente » et le « profit », alliés contre le travail, sont passés à l’offensive dès la fin des années 70. Et pendant 30 ans, ils ont fait la pluie et le beau temps.
Quelques vérités sur le boom d’après-guerre
A gauche, la nostalgie pour les « trente glorieuses » d’après-guerre se maintient et génère toutes sortes de reconstructions fantaisistes de l’histoire du système économique. Rappelons quelles furent les causes fondamentales du grand boom de l’économie capitaliste après la Seconde Guerre mondiale.
Avant tout, ce boom fut une conséquence de la guerre elle-même. Contrairement à ce qu’on peut lire souvent, la grande crise de 1929-33 ne fut en aucun cas surmontée par les politiques du New Deal rooseveltien ; la crise frappa de nouveau les Etats-Unis dès 1937-38. Ce fut la guerre à provoquer un tournant dans la situation. En 1960, en polémiquant avec les réformistes du Parti Travailliste britannique qui magnifiaient les politiques keynésiennes, le marxiste et révolutionnaire Ted Grant énumérait les causes fondamentales du boom :
« Quelles sont les raisons de fond du développement d’après-guerre de l’économie ?
L’échec politique des staliniens et des sociodémocrates, en Grande-Bretagne et en Europe occidentale, a créé le climat politique nécessaire pour une reprise du capitalisme.
Les effets de la guerre, avec la destruction de biens de consommation et de capitaux, ont créé un grand marché (la guerre a des effets semblables, mais plus profonds, à ceux d’une crise quant à la destruction de capital). Selon les Nations-Unies, ces effets n’ont disparu qu’en 1958.
Le Plan Marshall et d’autres aides économiques ont contribué à la reprise en Europe occidentale.
L’énorme augmentation des investissements dans l’industrie.
La naissance de nouveaux secteurs industriels : plastique, aluminium, balistique, électronique, énergie atomique – avec leurs sous-produits.
La production croissante dans les industries plus récentes : chimique, fibres artificielles, gomme synthétique, plastique ; ascension rapide des métaux légers, de l’aluminium, magnésium, électroménagers, gaz naturel, énergie électrique, construction.
L’énorme quantité de capital fictif créé par la dépense en armement, qui s’élève en Grande-Bretagne et en Amérique à 10 % du revenu national.
Les nouveaux marchés pour biens capitaux et produits mécaniques créés par l’affaiblissement de l’impérialisme dans les pays sous-développés, qui ont fourni aux bourgeoisies locales l’opportunité de développer l’industrie sur une échelle plus importante que par le passé.
Tous ces facteurs agissent les uns sur les autres. La demande croissante de matières premières, causée par le développement de l’industrie dans les pays métropolitains, à son tour a des effets sur les pays sous-développés et vice-versa.
L’augmentation du commerce, en particulier des biens capitaux et d’équipement, dans les pays capitalistes, conséquente à l’augmentation des investissements, agit à son tour comme stimulus.
Le rôle de l’intervention étatique dans la stimulation de l’économie. »[32]
Plus loin : « Les staliniens et les sociodémocrates ont dans une large mesure convaincu la classe ouvrière d’accepter le fardeau de la reconstruction aux cris de "production ! production ! ". Ce faisant, ils ont obtenu un certain succès parmi les masses. […] L’argumentation […] selon laquelle l’impérialisme américain aurait fait des prêts pour aider la reprise en Europe occidentale, mais seulement après que le prolétariat eut subi une défaite décisive, s’est d’ores et déjà avérée erronée : le prolétariat n’a pas été battu, mais les prêts ont déjà été concédés.
« L’histoire nous enseigne que le capitalisme, même à l’époque de son agonie mortelle, se relève d’une récession – malgré les possibilités révolutionnaires – si le prolétariat est paralysé ou affaibli par ses organisations et rendu incapable de prendre saisir ces opportunités. »[34]
La division du monde en blocs opposés entre Etats-Unis et URSS constitua la toile de fond de ces développements politiques, sans lesquels le « miracle économique » aurait été impossible.
De même, les évènements des trente dernières années ne peuvent être compris qu’en tenant compte d’une série de facteurs politiques. Entre la fin des années 70 et le début des années 80, le mouvement ouvrier a subi des défaites dans une série de pays décisifs. S’ouvrit alors une phase de lourdes restructurations industrielles. Dans les pays sous-développés, la vague de mouvements révolutionnaires générés par les luttes de libération s’épuisa. A cela s’ajoutaient l’ouverture de la Chine au marché (qui commence à la fin des années 70 et s’accélère énormément à partir des années 90), la chute du bloc soviétique en 1989-91 et l’affirmation de l’hégémonie planétaire des Etats-Unis.
Ces facteurs politiques ont eu une incidence directe sur le cycle économique. Le prix de nombreuses matières premières a diminué à partir du pétrole, les salaires ont été gelés et la productivité est repartie à la hausse : autant pour les profits. Ensuite, la révolution informatique et d’autres innovations dans une série de secteurs importants (transports, communications, etc.), quoique de façon moins généralisée qu’après-guerre, ont contribué à baisser aussi bien la valeur du capital constant que la valeur d’une série de marchandises qui participent à la formation de la valeur de la force de travail. Le taux de profit s’est reconstitué, comme le démontrent toutes les statistiques sur la distribution des revenus, le cours des salaires, les profits et la productivité.
Le 4 septembre 2011, le New York Times publiait une analyse synthétisant clairement le tournant opéré à la fin des années 70. En voici les chiffres principaux (pour les Etats-Unis) : entre 1949 et 1979, la productivité a crû de 119 %, les salaires horaires contractuels du secteur privé ont augmenté de 72 % et le salaire horaire total de 100 %. Entre 1979 et 2009, la productivité a crû de 80 %, mais les salaires horaires d’à peine 7 % (8 % pour la rétribution totale).
En divisant la population en cinq tranches selon les revenus perçus, l’évolution est la suivante (les tranches sont ascendantes, la première est constituée du cinquième le plus pauvre, la dernière du cinquième le plus riche) :
1949-79 1979-2009
I tranche + 122 % - 4 %
II tranche + 101 % + 7 %
III tranche + 113 % + 15 %
IV tranche + 115 % + 25 %
V tranche + 99 % + 55 %
Pour ce qui est des super-riches, 1 % des plus riches de la population américaine cumulait 23,9 % du revenu national à la veille de la crise de 1929. Ce pourcentage baissa longuement jusqu’au minimum de 8,9 % dans la seconde moitié des années 70, pour remonter jusqu’à 23,5 % juste avant la crise actuelle.
L’adoption de politiques fiscales toujours plus injustes (moins de taxes pour les riches et pour les entreprises, plus d’imposition indirecte et sur les revenus du travail) favorise ce processus, mais ne le détermine pas. La même chose vaut pour l’explosion de la finance, qui favorise ce gigantesque déplacement de richesses et le porte jusqu’aux extrémités que nous connaissons, mais n’en est pas la cause originelle. Aux racines de ce phénomène se trouve le déplacement des rapports de force entre les classes et la restructuration industrielle, qui déterminent la reconstitution du taux de profit.
Un élément décisif a été l’énorme prolétarisation survenue au sein des économies émergentes d’Asie, mais aussi d’Amérique latine, d’Afrique du Nord et d’Europe orientale, qui se sont ouvertes aux délocalisations. La pleine insertion dans le marché mondial de régions entières du monde et l’entrée contemporaine dans la production de centaines de millions de nouveaux ouvriers aux salaires bas et même très bas ont permis d’élever énormément le taux de plus-value et en conséquence le taux de profit. Si on ne tient pas compte de cet élément, on ne peut comprendre pourquoi les crises des années 90 et du début des années 2000 n’ont pas eu le même effet destructeur que la crise actuelle. C’est bien la masse de profits générée par ce nouveau cycle d’investissements qui a empêché que les crises asiatique (1997), russe et latino-américaine (1998) et même l’explosion de la bulle de la new economy (2000-2001) aient des conséquences généralisées. Les contradictions ont été renvoyées jusqu’au déclenchement de la crise actuelle.
Mais le keynésianisme est-il vraiment mort ?
Les nostalgiques d’un passé qui ne revient pas devraient réfléchir sur un point : la profonde réaction idéologique et politique que certains ont nommée « néo-libéralisme » a sûrement remis en cause le keynésianisme, mais tous les aspects des politiques keynésiennes n’ont pas disparu pour autant. Les déficits publics non seulement n’ont pas diminué, mais ils ont explosé dans de nombreux pays, à commencer par les Etats-Unis, et ce justement à partir des années 80. A l’exception du début des années 80, les politiques monétaires ont été souvent expansives, en particulier dans les années 90 et encore plus après 2001, avec des taux d’intérêt bas, voire très bas aux Etats-Unis et au Japon – et à peine plus élevés en Europe. Alan Greenspan, ex-gouverneur de la Réserve Fédérale américaine, critiquait les excès de la spéculation financière comme une « exubérance irrationnelle » ; mais il fut lui-même responsable d’avoir inondé les marchés de dollars faciles après le 11 septembre, alimentant précisément ce flux spéculatif qu’il avait précédemment critiqué.
Ce qui s’est effectivement rompu, c’est le lien entre les politiques keynésiennes et les bureaucraties réformistes.
Les réponses à la crise après 2007 confirment ce qui a été dit. Le système a été inondé de monnaie : on estime à près de 14 000 milliards de dollars l’ensemble des interventions publiques en soutien à la finance. Des banques et des compagnies d’assurance ont été nationalisées – et même des géants industriels aux Etats-Unis. Toutes les proclamations libérales ont été jetées aux orties du jour au lendemain et on a vu alors la plus gigantesque opération d’intervention publique de l’histoire du capitalisme.
On nous dit qu’aujourd’hui le problème est plus simple : il s’agirait de limiter les opérations du système financier de manière à ce que les banques centrales et les Etats, au lieu de prêter de l’argent à bas taux aux banques, qui s’en servent pour spéculer, l’emploient à soutenir les Etats et le secteur productif. On retrouve ici la conviction que face à la crise il faut mettre beaucoup de monnaie à disposition. C’est la même illusion optique que Marx met à nu dans les passages cités plus haut.
Ce qui échappe complètement à ce raisonnement, c’est que d’un point de vue capitaliste la crise rend nécessaire la dépréciation, voire l’annulation, d’une série de valeurs, qui ne sont pas seulement des valeurs de papier, mais représentent du capital sous toutes ses formes. Pour surmonter la crise, les marchandises invendues doivent être détruites ou bradées au-dessous du prix coûtant ; les sites inutilisés doivent être fermés ; les travailleurs en excès doivent être licenciés ; les valeurs (actions, titres, etc.) soldées doivent devenir du papier à jeter.
Depuis mars 2012, les banques centrales et les gouvernements luttent contre cette conclusion. Rappelons un passage déjà cité : « Tout ce système artificiel d’extension forcée du procès de reproduction ne saurait naturellement être remis sur pied parce qu’une banque, la Banque d’Angleterre par exemple, s’avise alors de donner à tous les spéculateurs, en papier-monnaie émis par elle, le capital qui leur manque, d’acheter à leur ancienne valeur nominale la totalité des marchandises dépréciées. » Qu’on substitue à l’expression « marchandises dépréciées » les mots « titres toxiques, crédits irrécouvrables » et nous aurons le cadre exact des politiques suivies au cours des trois dernières années.
Le résultat est précisément ce qu’indiquait Marx : en un sens, du fait même qu’ils sont intervenus « contre » la crise, la crise ne se termine pas.
La Réserve Fédérale, la BCE et la Banque d’Angleterre interviennent massivement depuis trois ans en injectant des liquidités sur le marché, non seulement sous forme de prêts à des taux favorables, mais aussi en acceptant des titres de valeur douteuse que les banques déposent en garantie en échange des financements concédés, ou encore en achetant de tels titres sur le marché aussi bien secondaire que primaire. En trois ans, le bilan de la BCE a doublé, de mille à deux mille milliards d’euros, alors que celui de la FED a triplé, passant de 900 à 2800 milliards de dollars. C’est la conséquence de la grande quantité de titres douteux que les banques centrales ont acceptés en garantie des prêts qu’elles fournissent aux banques privées. Le système flotte sur un « océan de liquidités », comme le souligne un éditorial du CorrierEconomia du 27 janvier 2012. Toutefois, si cette liquidité introduite artificiellement ne trouve pas un soutien dans la croissance de la production, elle ne peut que mener à de nouvelles crises ou, en alternative, être couverte en imprimant de la monnaie papier.
Il est donc ridicule de parler de « rigidité idéologique néolibérale » de la part de la BCE quand on assiste précisément à l’abandon dans la pratique des préceptes libéraux en faveur de la plus grande intervention sur les marchés jamais vue dans l’histoire du capitalisme. Le point essentiel est que l’intervention des autorités publiques (Etats et banques centrales) n’est pas un fait technique et idéologique, mais est déterminé par un choix conscient : quels intérêts défendre et quels intérêts pénaliser ? Ce n’est pas par hasard qu’on a pu parler ces dernières années de « socialisme des riches » ou de « socialisme des banquiers ».
La seule valeur qu’ils sont disposés à voir déprécier est celle du salaire, qu’il soit direct ou indirect (retraites, allocations, etc.).
Encore un mot sur la proposition d’annulation de la dette publique
Posons cette fois la question de la faillite sur le plan de l’action politique. Si le mot d’ordre de non-paiement de la dette n’est pas une phrase vide, il peut signifier seulement une chose : nous nous posons l’objectif de susciter un puissant mouvement de masse à même de contraindre le gouvernement à mettre ce mot d’ordre en pratique.
Aujourd’hui, nous sommes encore très loin de disposer de la force nécessaire ; toutefois, nous nous y employons. Eh bien, si un mouvement de cette envergure se développait en Italie, sa première conséquence serait précisément... d’aggraver énormément l’endettement de l’Etat italien. Ses créditeurs auraient en effet un raisonnement très simple : prêter de l’argent à l’Italie devient toujours plus risqué, un tel risque doit donc être payé avec des intérêts plus élevés. Ce raisonnement vaut d’ailleurs pour n’importe quel mouvement sérieux de résistance qui se développera dans la période qui s’ouvre.
L’étape suivante serait de tenter de mettre encore plus sous tutelle le gouvernement italien pour le contraindre à honorer les échéances de la dette ; encore une fois, l’exemple grec est significatif, où un gouvernement d’unité nationale a succédé au gouvernement « socialiste » précisément pour cette raison.
Arrivés à ce point du raisonnement, comment pourrions-nous répondre ? L’idée qu’on pourrait résoudre une controverse de la sorte à travers une négociation, aussi âpre soit-elle, ne tient pas debout. La bourgeoisie ne serait en aucun cas disposée à des concessions qui constitueraient un encouragement à développer des mouvements similaires dans tous les pays en crise. Pour la même raison, on peut caractériser d’utopique l’idée qu’une pression exercée par le mouvement ouvrier pourrait aboutir à une réforme radicale de la Banque centrale européenne – en lui imposant ainsi de souscrire aux dettes souveraines. Les grands créditeurs privés et leurs exécutants politiques sont disposés à discuter d’éventuelles réductions des paiements grecs à une condition précise : que le contrôle de la politique économique du gouvernement grec soit transféré en fait et en droit entre les mains de la « Troïka » : FMI, BCE, Union Européenne.
Il n’y aurait alors que deux possibilités : soit reculer, en payant un prix très lourd aussi bien en termes politiques que socio-économiques ; soit au contraire faire un pas en avant supplémentaire et poser la question d’un gouvernement qui, en se basant sur les travailleurs organisés, prendrait en main toutes les principales ressources économiques, les mettrait au service des besoins sociaux et les soustrairait au contrôle des patrons et des banquiers. Et d’ailleurs, ce n’est que dans cette voie que nous pourrions peut-être obtenir une vraie négociation sur la dette : dans cette hypothèse, même les banques, devant le risque de tout perdre, pourraient chercher à limiter les dégâts.
Les implications révolutionnaires de ces perspectives sont évidentes : c’est précisément pour cela que nous pensons qu’il est erroné de considérer « l'annulation de la dette » comme une sorte de pierre philosophale, une formule magique qui pourrait nous permettre de ne pas payer la crise tout en restant à l’intérieur des limites du système capitaliste. Au contraire, la question de la dette n’est rien d’autre qu’une des multiples facettes de la crise du système. Nous pourrions suivre le même fil de raisonnement si, à la place de la dette, nous prenions comme point de départ la défense des postes de travail dans les entreprises qui licencient et qui ferment, ou encore la défense du droit au travail, à la santé, à l’éducation ou à la retraite.
Le « non-remboursement de la dette » contient donc cette ambiguïté, que nous devons lever : considéré comme mot d’ordre en soi, ce n’est rien d’autre que prendre acte de la possible faillite des Etats et, dans le meilleur des cas, c’est une tentative d’anticipation pour en limiter les dégâts. Considéré en revanche comme partie intégrante d’une perspective de transformation révolutionnaire de la société, ce mot d’ordre prend le sens d’une revendication transitoire, c’est-à-dire qu’il part du problème urgent et immédiat du moment et le lie à un programme général.
Une faillite « négociée » est-elle possible ?
Les exemples de l’Equateur, qui a renégocié sa dette, et de l’Islande (où cependant la faillite était celle des banques et non de l’Etat) sont souvent cités pour « démontrer » que la faillite ne signifie pas la fin du monde et peut même avoir des effets positifs. Ce n’est pas sérieux. Dans ces deux cas, il s’agissait de quelques milliards d’euros ; mais l’Italie a une dette publique de plus de 1900 milliards d’euros, soit environ un quart de l’ensemble des dettes publiques de l’euro-zone. Une crise de la dette souveraine italienne ferait immédiatement et définitivement plonger la monnaie unique.
Etant donnés les rigidités et les mécanismes d’action/réaction propres à la zone euro, une insolubilité, même partielle, de l’Etat italien, aurait des conséquences incalculables, qui iraient bien au-delà des chiffres non remboursés. Ce serait l’équivalent de plusieurs fois la chute de Lehman Brothers (2008). Mais l’analogie historique la plus pertinente serait entre la faillite argentine et la plongée de l’économie allemande en 1923, qui provoqua l’hyperinflation, l’occupation militaire de la Ruhr par la France (pays créditeur car vainqueur de la guerre) et une situation révolutionnaire proche de la guerre civile.
Nous devons aussi nous prononcer clairement sur la question de l’euro. La perspective d’un non-remboursement de la dette est incompatible avec l’idée d’une réforme de la BCE, des Traités européens et des institutions qui les soutiennent. Il ne s’agit pas de s’opposer entre « européistes » et nationalistes ou d’imaginer d’improbables nouvelles monnaies communes aux pays les plus endettés (proposition de l’économiste Luciano Vasopollo[36] par exemple, nourrit ses élucubrations en nous expliquant qu’au fond, il suffit de refuser l’argent ou de battre monnaie chacun chez soi – et le tour sera joué. Formidable : pourquoi ne pas y avoir pensé plus tôt ?
Voyons. Si je ne paye pas le loyer, le propriétaire m’expulse et si je ne quitte pas l’appartement il appelle la police. Si je ne paye pas mes courses au centre commercial, je dois courir très vite si je veux éviter une inculpation pour vol. Etc. On ne peut pas « s’en aller » du marché, de l’argent ou des rapports de production : on peut simplement les subir ou les renverser. Le pire aspect, dans ces propositions, n’est pas tant leur caractère utopique, mais précisément le fait que, tout en s’ornant d’un certain radicalisme verbal, elles sont finalement ultra-modérées, du fait même qu’elles diffusent l’illusion que le vrai pouvoir qui nous opprime – celui qui provient de la propriété privée des moyens de production et de l’Etat qui défend cette même propriété – pourrait être contourné, fui, « vidé », etc. Bref, on propose tout et son contraire – du moment qu’on ne parle pas du point essentiel.
Cela ne signifie pas qu’occuper un logement ou lutter, par une action collective et organisée, à l’abaissement d’un tarif ou à la gratuité d’un service ne puissent pas être des actions utiles. Loin de là. Ce que nous contestons ici, c’est une théorie qui dit à des millions de personnes qui souffrent des conséquences d’une crise dévastatrice : « allez au centre commercial et demandez du jambon, occupez un logement social (généralement dans un sale état) et contentez-vous en parce que le pouvoir ne nous intéresse pas et ne doit pas nous intéresser ».
Sur la question de l’Euro
De même qu’il pense qu’on pourrait, sous le capitalisme, faire retourner les banques à leur « fonction originelle », Chesnais affirme que l’Euro ne doit pas être abandonné : « La solution progressiste n’est pas la sortie de l’euro. Elle est d’aider à la convergence des luttes sociales et politiques, menées aujourd'hui de façon dispersée, vers un objectif de contrôle social démocratique commun de leurs moyens de production et d’échange, donc aussi de l’Euro ».[38]. Il prétendait qu’on pouvait faire la monnaie unique – mais sans les accords qui imposaient les coupes dans les dépenses publiques ! Proposer de nouveau la même illusion aujourd’hui, dans une situation économique infiniment plus grave, c’est vivre sur une autre planète.
Posons le problème concrètement : supposons que demain, dans n’importe quel pays de l’UE, un gouvernement se forme autour d’une coalition de gauche fermement décidée à faire des politiques en faveur des travailleurs. Ce gouvernement devrait renier tous les plans de « stabilité-austérité », une grande partie des directives européennes qui encadrent les libéralisations, les politiques sur la formation, sur l’immigration, les retraites, la concurrence, les conditions de travail... Est-il imaginable que ces politiques puissent être gérées sans rompre avec ce cadre ?
Et à qui soutient que la solution réside dans un mouvement coordonné et simultané dans tous les pays de l’UE, nous répondons très simplement que si quelqu’un commence, les autres suivront. Mais si tous restent immobiles dans l’attente que quelqu’un d’autre donne le signal de départ, rien ne changera et le gouvernail restera dans les mains du capital.
Le problème que nous devons nous poser n’est pas un problème de technique économique, mais un problème de pouvoir. Mieux : c’est le problème du pouvoir. Nous devons être capables de voir, au-delà des convulsions de la crise, les brèches que celle-ci ouvre dans un front qui depuis trente ans applique les politiques libérales sur notre continent. Les contrastes entre les différents gouvernements européens, la crise des institutions qui soutiennent l’euro et l’Union européenne, les forces centrifuges qui se manifestent, constituent dans l’ensemble un fait positif qui jette également les bases pour une profonde crise au sein des partis qui se sont fait les interprètes de leurs exigences. Les partis socialistes ont connu depuis plusieurs décennies un profond glissement vers la droite et avec eux, de la même manière, les directions syndicales. Une partie de ce processus a été l’adhésion inconditionnée à la perspective de l’intégration dans l’Europe capitaliste, dont ils étaient les paladins les plus convaincus. « C’est l’Europe qui nous le demande » : telle était la réponse obsessionnelle par laquelle ils justifiaient des décennies de contre-réformes. Une alternative politique ne peut émerger que d’une crise profonde de ces forces, crise qui aujourd’hui commence à se matérialiser.
La crise de la construction européenne signifie aussi la crise de cette perspective qui était la leur – et ce n’est pas un hasard si on assiste à une reprise sur le plan électoral de forces à la gauche du Parti socialiste européen, comme en témoignent les cas de l’Espagne, de la Grèce et de la France. La crise n’est pas seulement économique : après un inévitable retard à l’allumage, elle transmet ses effets au plan syndical et politique. De ce point de vue aussi, la Grèce nous indique notre propre avenir.
La dernière ligne de défense du réformisme, de droite comme de gauche, est celle de « l’Europe politique ». On parle, on bavarde, sur plus d’intégration, plus de démocratie, plus de pouvoirs au parlement européen (par rapport à la Commission, à l’Eurogroupe ou à la BCE). Mais ce ne sont que des utopies. La tentative de concilier une crise qui impose des politiques toujours plus impopulaires avec la recherche du consensus électoral et une méthode de concertation, « raisonnable », fera exploser les forces qui se cimentent sur ce terrain. Une authentique alternative à gauche ne peut émerger que de ce processus convulsif, et pour la gauche alternative s’ouvre alors des possibilités – mais aussi d’énormes responsabilités.
En résumé
Ne pas payer la dette est donc un concept qu’il faut articuler à une perspective générale de transformation révolutionnaire de la société. Par quoi nous entendons :
que ne pas reconnaître la dette publique (exception faite évidemment de l’épargne des travailleurs, des retraités, etc.) pose immédiatement la question de nationaliser les banques et les institutions financières, avec comme objectif de prendre en main un levier décisif pour gérer l’ensemble de l’économie.
que prendre le contrôle des banques pose immédiatement la question du contrôle des grands groupes industriels et commerciaux – et de tous les moyens fondamentaux de la production et des échanges.
que ces objectifs impliquent non pas la gestion « technique » d’une faillite, mais la lutte pour le pouvoir politique des travailleurs.
Nous ne voulons pas être les simples défenseurs des intérêts des travailleurs pendant un processus de faillite. Nous voulons et nous devons être ceux qui proposent la perspective d’un autre pouvoir, d’autres rapports de propriété, d’une autre économie, d’une autre société et d’une autre vie.
[2] PRC, Parti de la Refondation Communiste, créé en 1991 par les militants refusant la liquidation de l’héritage communiste du PCI. Il demeure le principal parti de la « gauche radicale » italienne.
[4] Ibidem, p. 17.
[6] Ibidem, p. 88.
[8] Ibidem, p. 126.
[10] Ibidem, p. 128.
[12] Livre III, tome I, ch. 13, p. 226
[14] Livre III, tome I, ch. 14, p. 251
[16] Livre III, tome I, ch. 15, p. 257
[18] Livre III, tome II, ch. 30, p. 145
[20] Livre III, tome II, ch. 23, pp. 39-40
[22] Livre III, tome II, ch. 23, p. 44
[24] Livre III, tome II, ch. 23, p. 47
[26] Livre III, tome II, ch. 21, pp. 7-8
[28] Livre III, tome II, ch. 29, pp. 132-133
[30] Livre III, tome II, ch. 25, p. 64
[32] Ibidem, pp. 321-322
[34] Ibidem, p. 323-324
[36]Ancienne figure de proue de « Potere Operaio » [Pouvoir Ouvrier], un des mouvements de la gauche « extra-parlementaire et ouvriériste » qui agitaient l’Italie à la fin des années 1970 ; aujourd’hui collaborateur de journaux et sites de la gauche radicale, il est représentatif des théoriciens de la galaxie des mouvements « autonomistes » comme Toni Negri qui continuent d’influencer négativement certains secteurs du mouvement ouvrier dans leur recherche de « nouvelles idées » qui, derrière une phraséologie radicale, s’éloignent du marxisme. [ndt]
[38] Fausto Bertinotti, dirigeant historique du Parti de la Refondation Communiste de la moitié des années 90 jusqu’à la chute du deuxième gouvernement Prodi en 2008 ; cette année là, son courant de la droite du parti sortira de Refondation pour fonder ensuite le parti plus « modéré » Gauche, Ecologie et Libertés, allié au Parti Démocrate.