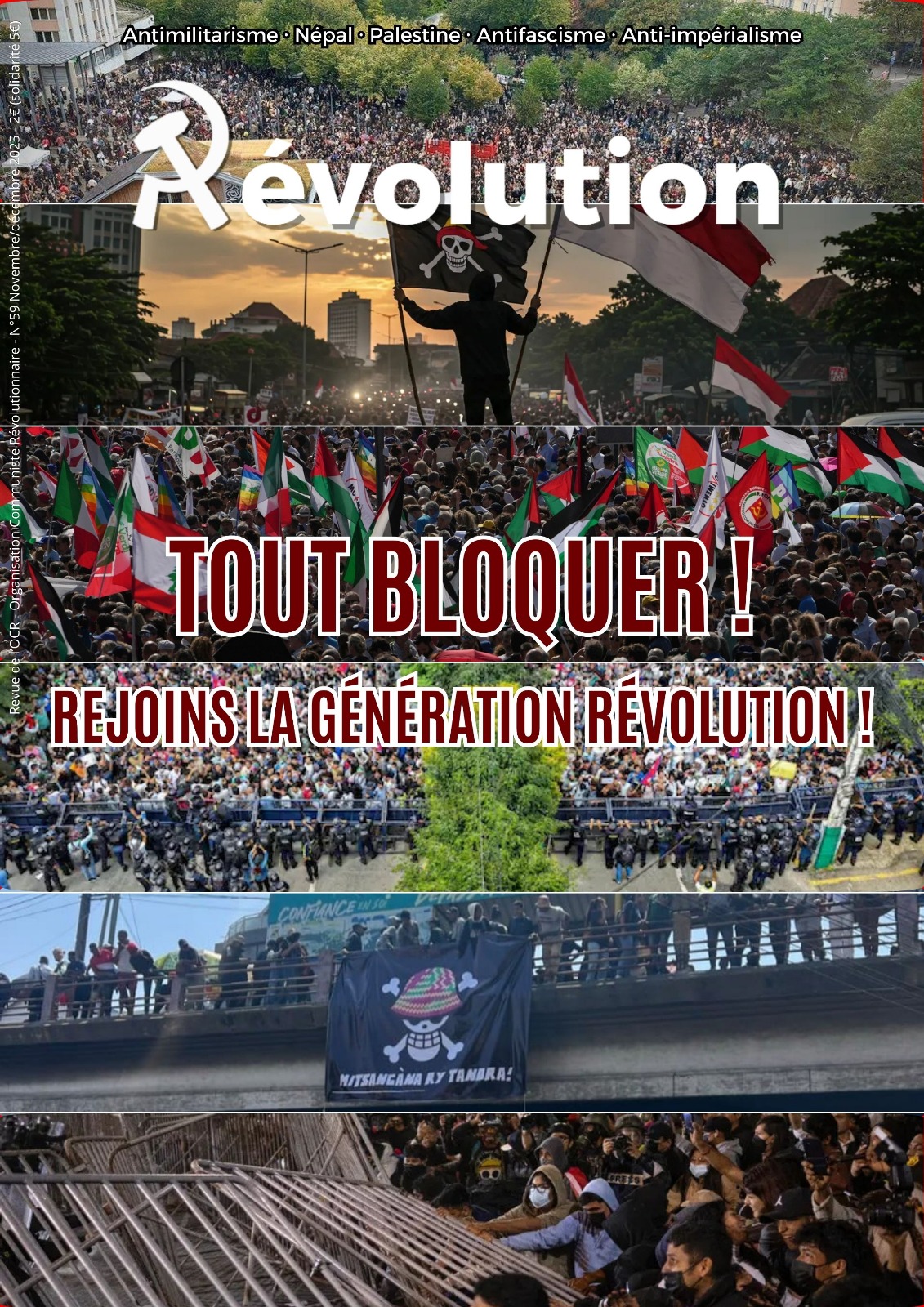Le 20 novembre marque le 50e anniversaire de la mort du dictateur Franco, l'un des personnages les plus sinistres et méprisables de l'histoire espagnole. Mais il n'était que le représentant de la caste militaire et de la classe sociale qui l'avait élevé à sa position : les grands banquiers, industriels et propriétaires terriens espagnols. Ce n'est que par une répression impitoyable, avec des centaines de milliers de morts et d'assassinés pendant la guerre civile et les 40 années de dictature qui ont suivi, que la bourgeoisie espagnole a pu écraser les aspirations révolutionnaires d'une classe ouvrière qui voyait dans la révolution socialiste le moyen de combattre le fascisme et de résoudre ses problèmes de misère, d'exploitation et de souffrance.
Aujourd'hui, tous (anciens franquistes, libéraux et politiciens professionnels de la gauche officielle) se félicitent de la « démocratie » et de la « merveilleuse » transition démocratique qui s'est opérée après la mort du dictateur. Cette « transition » fut si exemplaire qu'entre 1976 et 1982, elle a coûté la vie à 198 personnes (militants ouvriers et jeunes, militants de quartier, avocats spécialisés dans le droit du travail, militants de gauche et nationalistes basques) aux mains de la police, de la Guardia Civil, de membres de l'armée et de bandes fascistes protégées par l'appareil d'État. Cela représente un assassinat tous les 11 jours, pendant 6 années consécutives.
Il n'est pas surprenant que la gauche intégrée au régime, représentée par les directions du PSOE et du PCE, approuve ce qui s'est passé pendant la Transition, en raison de sa responsabilité directe dans celle-ci. Mais il est frappant de constater que ce sont les héritiers du franquisme, comme le Parti populaire – fondé par sept ministres franquistes – et Vox, qui apparaissent comme les principaux défenseurs de cette période de notre histoire et de la Constitution de 1978.
Il y a quelque chose qui ne colle pas dans la Transition « exemplaire » qu'on nous a racontée, lorsque ceux qui célèbrent avec le plus d'enthousiasme ce qui s'est passé pendant ces années sont ceux qui n'ont jamais condamné le soulèvement fasciste et les crimes de la dictature.
La dictature est morte dans la rue, pas dans son lit
La réalité est que, même si le dictateur est mort dans son lit, la dictature est morte dans la rue. La conquête des libertés démocratiques est le fruit unique et exclusif des luttes de la classe ouvrière en premier lieu, mais aussi des femmes, des étudiants et des revendications pour les droits démocratiques nationaux en Catalogne, au Pays basque et en Galice. Ces libertés n'ont pas été apportées par des personnalités telles que le roi Juan Carlos ou l'ancien président du gouvernement Adolfo Suárez. Il n'y a rien de plus pathétique que de présenter comme des héros de la démocratie ceux qui ont été propulsés aux plus hautes responsabilités du gouvernement depuis la dictature franquiste elle-même. Juan Carlos a été nommé successeur de Franco par le dictateur lui-même en 1969, et il a prêté serment aux principes du « glorieux » Mouvement National (la déclaration de principes fascistes qui a donné lieu au coup d'État militaire de Franco) lors de son intronisation en tant que roi le 22 novembre 1975. Adolfo Suárez, avant d'être nommé par Juan Carlos comme président du gouvernement en juillet 1976, avait été secrétaire national du Mouvement National, le parti unique du régime franquiste. À aucun moment, ni Juan Carlos ni Suárez n'ont émis la moindre plainte, la moindre critique, dans les années qui ont précédé la mort du dictateur, concernant le manque de libertés dans notre pays. Aucune protestation n'a été formulée par ces personnes contre les tortures dans les commissariats, contre les ouvriers assassinés par la police lors des grèves illégales, ni contre les condamnations à mort prononcées par les derniers gouvernements du dictateur.
Ces affirmations sont d'autant plus pathétiques et fausses aujourd'hui après la publication des Mémoires de ce scélérat et canaille appelé Juan Carlos de Bourbon et Bourbon, officiellement notre « roi émérite ». Ce débauché, qui n'a plus rien à cacher, déverse dans ces pages sa haine envers la gauche du régime qu'il accuse, pour des raisons que nous ignorons, de l'avoir exilé de facto du pays. En réalité, Juan Carlos a été exilé en raison de la haine et du mépris populaires à son égard, exprimés dans d'innombrables manifestations et sondages d'opinion. Comme ses ancêtres, son grand-père Alphonse XIII et la grand-mère de ce dernier, Isabelle II, la classe dominante lui a montré la porte de sortie pour cause de corruption et de vol, afin de sauver son système. Et dans le cas de Juan Carlos, pour sauver la monarchie elle-même. Il est vrai que l'ancien monarque jouit d'un « exil doré », payé par les contribuables espagnols, dans les démocraties « exemplaires » gouvernées par ses bons amis, les satrapes du golfe Persique. Ainsi, Juan Carlos affirme sans ambages que « si j'ai pu être roi, c'est grâce à lui [Franco] ». Et il donne son avis sur le boucher fasciste, sans rougir : « Je le respectais énormément, j'appréciais son intelligence et son sens politique ». Juan Carlos ne s'arrête pas là et déclare ouvertement : « Je n'ai jamais laissé personne le critiquer devant moi ». C'est là que se révèle le vrai visage de ce scélérat et, d'une certaine manière, la vérité sur ce qui s'est passé. Mais ces flagorneurs, à commencer par Felipe González et Santiago Carrillo, qui ont servilement flatté le Bourbon pour avoir « apporté la démocratie », et qui connaissaient la vérité, porteront à jamais sur leur front le stigmate de l'infamie.
Qui avait vraiment peur pendant la Transition ?
Il y a un aspect particulièrement irritant dans la version « officielle » de la Transition qui a imprégné les discours des dirigeants de gauche au cours de ces 50 dernières années, et qui continue d'être répété avec une intensité lancinante : « on n'a pas pu obtenir plus », « il a fallu accepter la monarchie », « il a fallu accepter l'amnistie des crimes du franquisme », « il a fallu laisser tranquilles les grands entrepreneurs qui ont soutenu la dictature », « il n'a pas été possible de purger l'appareil d'État des juges, des militaires, des tortionnaires et des collaborateurs de la dictature », « il a fallu accepter la Constitution de 1978 » parce que « la peur régnait » dans la majorité de la population, la peur « de la poursuite de la dictature et d'un coup d'État militaire de la part de l'aile dure du franquisme ».
Nous sommes en total désaccord avec ce mensonge éhonté. Si la majorité de la population « avait vraiment peur », pourquoi le camp franquiste avait-il besoin de faire des concessions démocratiques importantes ? Ne serait-il pas plus plausible de conclure que si le secteur décisif du régime franquiste a été contraint de faire des concessions démocratiques, c'est parce que la peur était en réalité de son côté ?
Nous présentons quelques données qui étayent cette position. Le fait le plus significatif de la lutte contre la dictature a été le rôle de la classe ouvrière. Dès le début des années 60, les travailleurs espagnols ont lancé un mouvement de grève sans précédent dans l'histoire sous un régime dictatorial. La courbe ascendante de la lutte gréviste nous permet de suivre leur processus de prise de conscience : au cours de la période 1964-1966, 171 000 journées de travail ont été perdues dans des conflits sociaux ; en 1967-1969, ce chiffre est passé à 345 000 ; en 1970/72 : 846 000 et en 1973/75 : 1 548 000. Par la suite, après la mort de Franco, le mouvement de grève a pris des proportions inhabituelles : de 1976 à mi-1978, pas moins de 13 240 000 journées de travail ont été perdues dans des conflits sociaux.
La principale force motrice de ces luttes était le syndicat CCOO, dirigé par le PCE. En 1975, le CCOO avait pris le contrôle, depuis l'intérieur du syndicat franquiste (appelé Sindicato Vertical), de la représentation majoritaire des travailleurs dans les grandes entreprises. Les conventions collectives du régime franquiste ont été rompues par l'action directe des travailleurs qui ont élu leurs propres représentants par le biais de ce qu'on appelait les « commissions représentatives ». Et tout cela dans une situation de dictature !
Parallèlement, entre 1975 et 1977, des centaines d'associations de quartier ont été créées dans toute l'Espagne. Il s'agissait d'organisations populaires de masse dans les quartiers ouvriers et les villages, comptant des dizaines de milliers de participants, qui luttaient contre les conditions et les infrastructures déficientes des quartiers populaires. Là encore, le PCE était la force déterminante.
Toutes les superstructures sur lesquelles reposait l'ancien régime – comme l'armée et l'Église – étaient en crise et fracturées. Un exemple en est la création clandestine, en août 1974, de l'Union militaire démocratique (UMD), formée par des dizaines d'officiers et de sous-officiers de l'armée espagnole opposés à la dictature franquiste. Au moment de sa dissolution (juillet 1975), elle comptait 200 membres, officiers et sous-officiers, avec des ramifications jusqu'au sein de la Guardia Civil. Et si tel était le climat dans certains secteurs des officiers, on peut imaginer celui qui régnait dans les troupes.
Au sein de l'Église catholique, un nombre croissant de membres du clergé de base sympathisaient avec les luttes ouvrières et les mouvements de gauche, mettant à disposition les salles paroissiales pour toutes sortes de réunions clandestines. La Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) et la Juventud Obrera Católica (JOC), créées par l'Église pour propager la religion dans les quartiers ouvriers, ont viré à gauche dans leurs propos, au point de considérer le « socialisme » comme le véritable idéal chrétien.
La vérité est que chaque fois que les secteurs « ultras » du franquisme se sont lancés dans une répression sanglante (Vitoria en mars 1976, Montejurra en mai 1976, les crimes contre les avocats du travail dans la rue Atocha à Madrid en janvier 1977, ou la Semaine pour l'amnistie au Pays basque en mai 1977), cela a provoqué une radicalisation et une réponse de type insurrectionnel parmi la classe ouvrière et la jeunesse, et c'est cela – et rien d'autre – qui a donné lieu à la lutte interne au sein de la bureaucratie franquiste, dans laquelle s'est imposé le secteur « réformiste » de celle-ci. Les syndicats ouvriers et les partis de gauche n'ont été légalisés que par la panique du gouvernement Suárez et des grands entrepreneurs face à une explosion populaire après les crimes de la rue Atocha à Madrid.
En réalité, dans l'Espagne de 1975-1977, une crise révolutionnaire similaire à celle qui s'était produite quelques années auparavant en Grèce et au Portugal était en gestation. Une tentative de coup d'État militaire à cette époque aurait provoqué une explosion révolutionnaire. Les tentatives d'une partie de l'appareil franquiste pour s'engager dans cette voie reflétaient simplement sa perte de contact avec la réalité, c'est pourquoi ses membres ont été écartés.
Le rôle des directions de la gauche
Il faut le dire clairement : ce n'est pas la force de la réaction, mais la trahison des directions de la gauche (PCE et PSOE) qui a empêché la lutte des masses contre le régime franquiste de aboutir à une transformation radicale de la société espagnole selon des lignes socialistes.
Le régime et la monarchie manquaient d'autorité. Les grands entrepreneurs, craignant une explosion révolutionnaire, ont transféré leurs capitaux et leurs devises à l'étranger, ce qui a entraîné de nombreuses fermetures d'usines et une hausse galopante du chômage. Si les dirigeants du PCE et du PSOE avaient appelé à organiser une Assemblée constituante révolutionnaire, chargée d'élire un gouvernement alternatif à celui en place, cela aurait reçu un soutien massif. Les bases pour convoquer cette Assemblée constituante étaient des organismes déjà présents : les commissions ouvrières représentatives des entreprises, les associations de quartier et les assemblées d'étudiants dans les universités et les instituts. Il fallait simplement les étendre à l'ensemble des entreprises, des villes et des villages du pays. Une Assemblée constituante composée de délégués élus au sein de ces organismes de base aurait été un million de fois plus représentative que le parlement issu des élections semi-démocratiques de juin 1977. Lors de ces élections, les jeunes âgés de 18 à 21 ans (2 millions) et les émigrants espagnols (1 million), qui constituaient une majorité de votes pour la gauche, ont été empêchés de voter, et un poids disproportionné a été accordé à la représentation des provinces les moins peuplées afin de diluer le poids des grandes villes où se concentrait la classe ouvrière. En fait, la gauche PSOE-PCE-PSP a obtenu plus de voix que la droite UCD-AP, mais ces derniers ont obtenu la majorité absolue des députés et des sénateurs ! qui ont ensuite rédigé la Constitution de 1978. La vérité doit être dite. Les dirigeants du PCE et du PSOE ont accepté de participer à des élections semi-démocratiques, au lieu d'appeler au boycott de celles-ci, car ils avaient convenu au préalable avec Suárez que ce serait l'UCD (Union du centre démocratique), le parti des anciens franquistes « convertis » à la démocratie, qui piloterait la « transition », y compris le maintien de la monarchie. Un gouvernement de gauche PCE-PSOE-PSP, qui aurait largement remporté les élections si celles-ci avaient été véritablement démocratiques, aurait été soumis à une pression insupportable venant de la base en faveur de la proclamation de la république, d'une purge radicale de l'appareil d'État et de l'application de mesures socialistes d'expropriation. Et c'était la dernière chose que Carrillo et González souhaitaient faire.
Un gouvernement de la classe ouvrière, des secteurs progressistes de la classe moyenne, de la jeunesse, des nationalités historiques, aurait été suivi par des millions de personnes. Avec la puissance démontrée par le mouvement ouvrier à l'époque, une grève générale illimitée bien préparée et organisée, inondant les rues de millions de travailleurs, aurait paralysé toute tentative de coup d'État ou de répression populaire. Les forces répressives auraient été divisées en deux, une partie décisive de la base de la police et de l'armée passant du côté des travailleurs. Une transition relativement pacifique vers le socialisme aurait pu avoir lieu, avec la nationalisation des leviers fondamentaux de l'économie par le biais d'organismes populaires démocratiques de base, et la proclamation d'une république démocratique avec les libertés maximales, y compris le droit à l'autodétermination pour les nationalités historiques, qui auraient massivement choisi de rester dans une union volontaire de républiques socialistes ibériques.
Malheureusement, les dirigeants de gauche n'avaient pas la moindre confiance dans la classe ouvrière et les autres secteurs populaires en lutte. Une responsabilité particulière incombe aux dirigeants du PCE qui, à l'époque, occupaient une position hégémonique dans le mouvement ouvrier, les associations de quartier et la jeunesse.
Le plus grave est que les dirigeants du PCE et du PSOE n'ont pas utilisé la force colossale déployée par des millions de travailleurs, de femmes, de jeunes, de professionnels, de petits propriétaires appauvris et d'intellectuels progressistes, non seulement pour garantir un régime socialiste démocratique, mais même pour parvenir à une démocratie avancée : la monarchie héritée du franquisme a été maintenue avec son drapeau honni, l'appareil franquiste avec ses centaines de fascistes, tortionnaires et assassins est resté intact, l'« unité indissoluble » de l'Espagne sous la surveillance de l'armée franquiste a été acceptée, etc. Les dirigeants ouvriers et de gauche ont également approuvé toutes sortes d'« accords sociaux » et économiques (tels que les accords de la Moncloa) qui faisaient peser tout le poids de la crise capitaliste de ces années-là sur les épaules des familles ouvrières. Tout cela a conduit à un reflux de la mobilisation sociale et à une profonde déception et démoralisation politique qui ont duré des décennies.
La Constitution de 1978 n'était pas un « contrat social » conclu à l'amiable entre deux parties de la société, mais le fruit d'une trahison politique des attentes d'un changement révolutionnaire d'une majorité sociale. Ce sont les directions de la gauche, principalement du PCE, qui ont inventé le conte du « loup qui vient » et du danger d'un coup d'État militaire si les revendications populaires allaient trop loin, qui a été utilisé pour contenir et frustrer le processus révolutionnaire qui couvait au sein de la société espagnole.
L'appareil d'État : le franquisme sans Franco
La farce et la fraude de la soi-disant « transition » s'expriment mieux que tout dans l'appareil d'État que nous avons actuellement, qui est un héritage direct et non épuré de la dictature franquiste, malgré les 50 années de « démocratie » qui se sont écoulées. Contrairement à ce qui s'est passé au Portugal et en Grèce dans les années 70, ou même en France ou en Italie à la fin de la Seconde Guerre mondiale, où il y a eu une purge importante, bien que partielle, des militaires, policiers et juges impliqués dans les dictatures militaires et fascistes, en Espagne, il n'y a pas eu une seule purge individuelle. Au contraire, la plupart d'entre eux ont été promus à des postes plus élevés pendant les années de « démocratie », y compris les tortionnaires de la police.
Ce fut le cas du policier Antonio González Pacheco, plus connu sous le nom de Billy El Niño, qui a acquis une enorme notoriété pour les tortures qu'il a infligées au sein de la Brigade politico-sociale – la branche de la police spécialisée dans la poursuite des « délits » politiques – et qui n'a jamais payé pour cela. Un autre cas célèbre est celui du tortionnaire José Sainz González, Pepe « el gordo », qui est devenu le premier directeur général de la police de la « démocratie » et a reçu de nombreuses décorations. Dans les années 80, le gouvernement de Felipe González l'a nommé délégué du ministère de l'Intérieur au Pays basque, où il a accumulé une longue série de plaintes pour torture contre des militants de gauche, des nationalistes, des syndicalistes et des manifestants sans affiliation politique. Manuel Ballesteros García, commissaire honoraire de police, célèbre pour ses représailles contre les syndicalistes, les démocrates, les communistes et les nationalistes basques, est un autre tortionnaire décoré sous la démocratie. Il en va de même pour Antonio Juan Creix, qui a conservé ses décorations et ses indemnités sous la démocratie malgré un long passé de tortures et d'assassinats à Barcelone.
Ce ne sont là que quelques exemples marquants, auxquels il faudrait en ajouter des centaines d'autres. Au sein de la Guardia Civil, un corps aux antécédents séculaires de crimes contre la classe ouvrière et les journaliers agricoles, on observe la même chose. Il suffit de dire que l'actuel chef de la Guardia Civil de Madrid, Diego Pérez de los Cobos, réintégré dans ses fonctions par décision judiciaire après avoir été destitué par le gouvernement Sánchez, était le fils d'un militant du parti fasciste Fuerza Nueva, auquel il a lui-même appartenu dans sa jeunesse.
Du côté de l'appareil judiciaire, 10 des 16 juges et plusieurs procureurs qui ont siégé au Tribunal de l'ordre public franquiste (TOP), chargé de juger les délits politiques de 1963 à 1976, ont été promus « en démocratie » à la Cour suprême et à l'Audiencia Nacional. Parmi eux, citons Timoteo Buendía, José F. Mateu, Antonio Torres-Dulce, Jaime Mariscal de Gante, Enrique Amat, José de Hijas, José Garralda, Antonio González, Luis Poyatos et Félix Hernández. Ils ont été complices jusqu'au dernier jour des tortures de la Brigade politico-sociale et n'ont jamais ouvert de procédure, même pour blessures, pendant 50 ans. De son côté, le juge Ismael Moreno, notoire droitier, qui siège actuellement à l'Audiencia Nacional, est issu de la police franquiste, qu'il a intégrée en 1974.
Du côté des hauts responsables du franquisme, la situation est similaire. Le politologue et journaliste Lluc Salellas a publié il y a quelques années un livre intitulé El franquismo que no se marcha (Le franquisme qui ne s'en va pas), à propos duquel il a déclaré : « J'ai enquêté sur la vie des 50 derniers ministres de Franco et j'ai constaté qu'aucun d'entre eux n'avait été dégradé par la démocratie. Au contraire, la moitié d'entre eux ont rejoint les conseils d'administration de grandes entreprises, l'autre moitié s'est lancée dans la politique ».
Un exemple flagrant est celui de Rodolfo Martín Villa, ancien haut responsable du franquisme depuis les années 50 et ministre de l'Intérieur en 1976, lorsque cinq travailleurs ont été assassinés à Vitoria, qui a fini par devenir conseiller chez Endesa puis président de Sogecable. Le président d'honneur de La Caixa, José Vilarasau Salat, a été nommé directeur général de Telefónica en 1966, puis a occupé plusieurs postes importants au ministère des Finances sous le franquisme.
Un autre exemple est celui d'Antonio Barrera de Irimo, premier vice-président du gouvernement franquiste qui a assassiné l'activiste anarchiste Salvador Puig Antich. Il a ensuite été conseiller chez Telefónica, ainsi que dans les banques Hispano-Americano, Hipotecario et Hispamer. Comme l'affirme Salellas : « Félix Millet le disait. Nous sommes 400 familles et nous sommes toujours les mêmes ».
Salellas cite le cas de Demetrio Carceller, phalangiste et ministre de Franco, qui a fondé l'empire brassicole Estrella Damm. Ou encore celui de la famille Urquijo, dont l'un des frères était ministre et l'autre président d'Iberdrola. D'autres figures de proue de la fin du franquisme, reconverties en démocrates, ont également très bien réussi. Le fils de Torcuato Fernández Miranda, Enrique Fernández Miranda, préside la Fondation Price Waterhouse Coopers.
Et que dire des officiers de l'armée ? Comme dans le cas de l'appareil policier et judiciaire, tous les hauts responsables militaires sont restés à leur poste et ont conservé jusqu'à aujourd'hui tous les privilèges matériels que leur avait accordés le franquisme (hôpitaux et résidences de loisirs privés, salaires élevés, etc.). Les rares officiers soupçonnés de sympathies de gauche ont été purgés sans aucune objection de la part des gouvernements socialistes en place. Ce fut le cas des membres de l'UMD qui n'ont jamais pu reprendre leur carrière militaire, tandis que plusieurs des condamnés pour la tentative de coup d'État du 23 février (au grade de lieutenant ou de capitaine) ont poursuivi la leur, avec d'importantes promotions.
Pour voir les références démocratiques, non pas des vieux dinosaures franquistes de l'armée, dont la plupart sont déjà morts, mais des dauphins qui ont atteint la maturité de leur carrière « en démocratie », rappelons-nous l'épisode qui s'est produit il y a quelques années lorsqu'au cours d'une discussion WhatsApp entre des officiers de l'armée de l'air à la retraite, l'un d'entre eux a déclaré, avec l'approbation des autres, qu'« il faudrait fusiller plus de 26 millions de fils de pute », soit 60 % de la population, pour leurs sympathies envers la gauche. Cette année encore, plus de 40 militaires à la retraite, tous ayant occupé des postes élevés dans l'armée « en démocratie », ont signé un manifeste d'apologie du franquisme, appelé Plataforma 2025, qui définit Franco comme « un soldat héroïque » et reprend le nom de « Croisade de la Libération », la guerre civile franquiste de 1936-1939.
Les appareils policier, militaire et judiciaire sont la quintessence de la réaction dans l'État espagnol, dont la fraternité de sang réside dans les privilèges matériels abusifs dont ils jouissent en pillant les caisses publiques qui se nourrissent de la sueur et de l'exploitation de la classe ouvrière espagnole. Démolir cet appareil d'État est la condition fondamentale, non seulement pour le socialisme, mais aussi pour obtenir des droits démocratiques avancés.
Conclusions
Ni le régime actuel ni sa Constitution ne sont capables d'entreprendre les transformations fondamentales nécessaires pour satisfaire les besoins sociaux et démocratiques de la majorité de la population. Nous devons souligner les tâches démocratiques inachevées qui exigent une résolution : la proclamation d'une république démocratique, la démolition à la racine d'un appareil d'État composé de juges, de militaires et de policiers hérités du franquisme sans avoir été purgés, la séparation complète de l'Église et de l'État, ainsi que le « droit de décider » des nationalités historiques.
La souveraineté populaire ne peut se limiter à une série de droits politiques énumérés sur un bout de papier ; elle doit être complétée par la propriété collective, gérée démocratiquement, des leviers fondamentaux de l'économie (les grandes propriétés industrielles, foncières, financières et commerciales) et des ressources naturelles de nos territoires, afin de les planifier démocratiquement pour les mettre au service du bien-être général et satisfaire pleinement les besoins sociaux pressants.
En définitive, nous lions la lutte pour une République démocratique et avancée des peuples ibériques, fédérés volontairement sur un pied d'égalité, à la lutte pour la transformation socialiste de la société, comme première étape vers l'établissement d'une fédération socialiste des peuples européens, prélude à un monde socialiste sans frontières.
Pour s'attaquer à cette tâche, la nouvelle génération doit se consacrer à l'étude de la lutte révolutionnaire contre le franquisme et la soi-disant « transition démocratique », afin de tirer les leçons correctes de ces processus historiques et d'éviter les erreurs du passé afin de contribuer au succès de notre lutte actuelle.