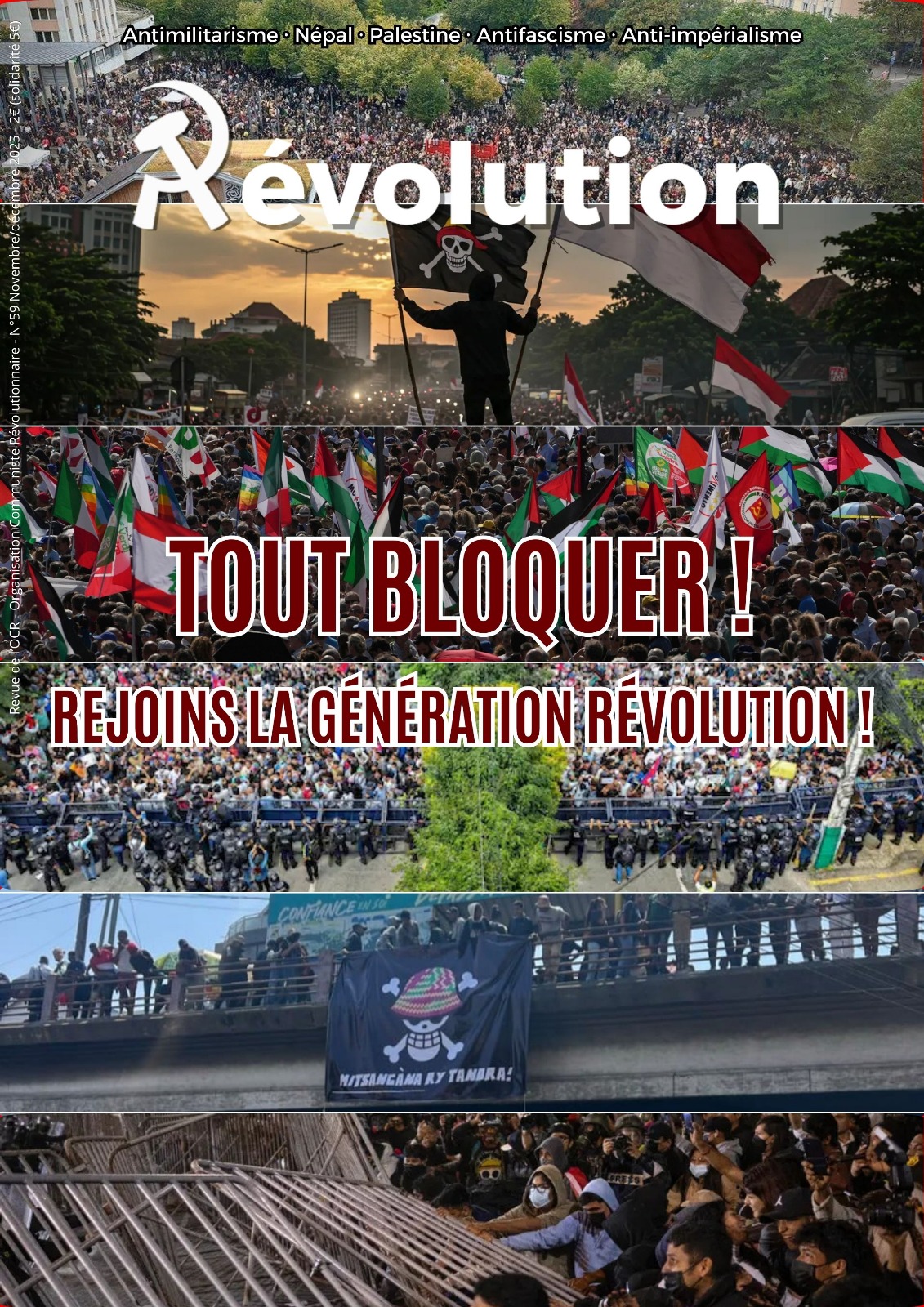Le drame grec s’intensifie de jour en jour et d’heure en heure, menaçant la stabilité de toute l’Union Européenne. Mardi, le gouvernement de Papandréou a obtenu un vote de confiance, au Parlement, pendant qu’à l’extérieur du bâtiment des dizaines de milliers de gens criaient : « Voleurs ! Voleurs ! » Leur colère n’est pas seulement dirigée contre les mesures d’austérité, mais aussi contre les politiciens en général.
Dans l’espoir d’éviter un défaut de payement, le Premier ministre s’efforce de gagner un soutien à de nouvelles coupes drastiques. Mais désormais, personne de sérieux ne croit qu’un défaut peut être évité – ni dans les rues d’Athènes, ni à Bruxelles. La question n’est pas si la Grèce fera défaut, mais quand et dans quelles conditions.
Le remaniement ministériel a été approuvé, au Parlement, par une très faible majorité : 155 voix pour, 143 contre et deux abstentions. Les députés vont maintenant devoir approuver 28 milliards d’euros de coupes budgétaires, de hausses d’impôt et de privatisations. Les dirigeants de l’Eurozone conditionnent la tranche de prêt de 12 milliards à l’adoption de ces nouvelles mesures.
Ce n’est plus une crise gouvernementale ; c’est une crise du régime lui-même. Les alarmes sonnent dans tous les gouvernements d’Europe – et au-delà.
Vote de confiance
Tous les partis politiques peuvent sentir les flammes de la révolte dans leur dos. Pour tenter une diversion, une partie de l’opposition a brièvement quitté le Parlement, lors du débat préalable au vote de confiance. Cela n’a convaincu personne – et, finalement, les mêmes ont accordé leur soutien à Papandreou. Naturellement !
Papandréou avait un joker dans sa manche. La droite ne veut pas d’élections immédiatement, car elle a peur de les gagner. Elle ne veut pas la patate chaude – pour le moment. Elle préfère que Papandreou fasse le sale boulot à sa place.
De même, la menace d’une révolte, parmi les députés du PASOK, s’est soudainement évaporée. Après avoir fait beaucoup de bruit, ils ont voté ce que la direction du parti leur demandait de voter. Cela souligne la vraie nature des « réformistes de gauche ». En dernière analyse, la gauche réformiste du parti n’a pas de position indépendante. Elle finit par s’accrocher à la droite du parti – laquelle défend le capitalisme et s’accroche donc à la classe capitaliste.
C’est le vieux dilemme des socio-démocrates, dans tous les pays. Une fois au pouvoir, ils doivent faire un choix : soit ils défendent les intérêts des travailleurs en attaquant le Capital ; soit ils défendent le Capital en attaquant les travailleurs. Ils s’engagent toujours dans la seconde voie. L’aile droite le fait sans hésiter, d’une main ferme. L’aile gauche hésite, proteste – mais finit par s’y résoudre, parce qu’elle n’a aucune alternative à proposer. Elle est organiquement incapable de maintenir une position ferme.
Papandréou a jusqu’au 28 juin pour obtenir un vote sur les 28 milliards d’euros de mesures d’austérité, faute de quoi Bruxelles renoncera à la nouvelle tranche d’« aide ». Cela revient à menacer de couper les tubes qui maintiennent en vie un patient en soins intensifs.
Les gouvernements d’Allemagne et des autres pays créditeurs sont confrontés à un sérieux problème. Dans toute l’Europe, des politiciens de droite s’exclament à l’unisson : « ne payez pas les Grecs ! » En blâmant le peuple grec, ces démagogues chauvins essayent de protéger les vrais coupables : les banques et le système capitaliste lui-même.
Depuis l’effondrement de 2008, les gouvernements ont jeté des milliards d’euros dans les coffres des banques, pour combler des trous creusés par des décennies de spéculation et d’escroqueries. Puis ils nous ont informés qu’il n’y a plus d’argent pour les hôpitaux, les écoles, les retraites – et que « tout le monde doit se serrer la ceinture » (tout le monde sauf les banquiers, naturellement).
Jusqu’à récemment, ils semblaient s’être assez bien sortis de cette gigantesque arnaque. Mais la crise grecque change la donne. Il est vrai que la Grèce est un cas extrême. Mais en réalité, tous les gouvernements européens piétinent les règles du traité de Maastricht. La Grèce n’est que le bouc émissaire de la crise du capitalisme européen. C’est le maillon le plus faible de la chaîne. Mais il y a bien d’autres maillons faibles. Tous sont liés entre eux et tomberont ensemble.
La jeunesse et les travailleurs grecs ont eu le courage de se soulever contre les parasites et les usuriers. Un travailleur grec interviewé par une chaîne de télé expliquait : « Je travaille dur pour vivre, comme tout le monde. Je ne suis pas responsable de cette crise et de ces dettes. Pourquoi est-ce que je devrais payer ? » C’est une très bonne question, que des millions de travailleurs européens peuvent se poser.
Keynes disait : si un homme doit 100 livres sterling à une banque, il a un problème ; mais s’il lui doit un million de livres, c’est la banque qui a un problème. L’UE a désormais un très gros problème. Si la Grèce ne paye pas sa dette – qui s’élève à 150 % de son PIB –, elle devra quitter la Zone Euro. Cela provoquerait des pertes massives pour les banques et les investisseurs européens qui ont prêté de l’argent à la Grèce. L’Allemagne et la France sont au premier rang des pays exposés.
Trois banques françaises ont vu leur note baisser du fait de leurs placements en Grèce. C’est un avertissement. Aussi les Allemands et autres créditeurs n’ont-ils d’autre choix que de prêter davantage à la Grèce – en retenant leur souffle. Ils savent que si la Grèce fait défaut, la contagion se propagerait rapidement au reste de l’Europe, soumettant l’euro à des pressions insoutenables. L’avenir de l’UE elle-même est sérieusement menacé.
La « contagion » ne concerne pas seulement l’économie. Cela s’applique aussi à la politique. Le mouvement en Espagne se poursuit : 250 000 personnes ont battu le pavé à Barcelone, dimanche dernier. En Grande Bretagne, les syndicats du secteur public préparent une grande vague d’actions coordonnées pour le 30 juin.
Implications révolutionnaires
Le ton des dirigeants de l’UE est de plus en plus menaçant : il faut des coupes franches et des privatisations massives – « ou sinon… ». Mais la masse de la population grecque rejette le nouveau paquet de mesures. Il n’est même pas certain qu’il pourra être approuvé au Parlement.
Tout en reconnaissant que les mesures d’austérité son sévères, Papandréou insiste sur l’idée qu’« il n’y a pas d’alternative » (ce qui est vrai, sur la base du capitalisme). Il répète qu’une élection est la dernière chose dont la Grèce a besoin. Par « Grèce », bien sûr, il entend les capitalistes et les banquiers. « Il y a une lumière au bout du tunnel », dit le Premier ministre. Mais il n’a pas précisé qu’il s’agissait des phares d’un train lancé à tout vitesse dans l’autre direction.
La Grèce ne peut pas même payer les seuls intérêts de sa dette. Et les nouvelles mesures d’austérité ne feront qu’affaiblir la demande et aggraver la récession – ce qui réduira davantage les recettes fiscales, censées payer les créditeurs. C’est une spirale descendante dont on ne voit pas la fin.
Mais la classe dirigeante a surtout peur des masses. Les manifestants sont déterminés à organiser une mobilisation exceptionnelle à l’occasion du vote du plan de rigueur. Les syndicats discutent d’une grève générale de 48 heures. La grève des électriciens montre qu’à elle seule, cette section de la classe ouvrière a les moyens de paralyser l’économie.
La situation exige une direction révolutionnaire. Et c’est précisément ce qui manque. Alexis Tsipras, dirigeant du parti Synaspismos (gauche) a dit : « On ne nous propose pas de sauver l’économie, mais de la piller avant de proclamer la faillite ». C’est correct. Mais malheureusement, Synaspismos n’offre aucune perspective au mouvement de masse. Il est à la remorque du mouvement – et non à sa tête.
La position des dirigeants du Parti Communiste Grec (KKE) est pire encore. Ils font tout ce qu’ils peuvent pour tenir les travailleurs communistes à l’écart du mouvement et le diviser. Ils se méfient de tout ce qui n’est pas sous leur contrôle bureaucratique. Au mieux, ils utilisent le mouvement de masse pour faire avancer leurs ambitions électorales. Au pire, ils le considèrent comme « réactionnaire ».
Cela montre à quel point ces dirigeants de gauche sont coupés de l’humeur réelle dans la société. Les organisations de masse de la classe ouvrière, et surtout leurs dirigeants, sont à la traîne. Il n’est pas surprenant, dès lors, que les nouvelles couches de jeunes et de travailleurs mobilisés les regardent avec méfiance, voire une franche hostilité. Ce n’est pas de l’« anarchisme », mais une réaction parfaitement justifiée au bureaucratisme réformiste, qui apparaît comme faisant partie du système et des « élites » contre lesquels les masses se rebellent.
Les mouvements en Grèce et en Espagne ont balayé toutes les calomnies sur la prétendue « passivité » de la jeunesse. Elle n’est ni passive, ni apolitique. Elle veut se battre, mais elle se méfie des partis existants et de leurs directions. Comment l’en blâmer, lorsqu’on connaît le bilan des partis en question ? S’il faut choisir entre les députés carriéristes, les bureaucrates syndicaux et les jeunes qui protestent Place Syntagma et Place de Catalogne, nous nous tenons inconditionnellement avec ces derniers.
Il est vrai que le mouvement manque d’expérience. En conséquence, il commet des erreurs. Ces erreurs peuvent être corrigées avec le temps et l’aide patiente et fraternelle des révolutionnaires marxistes. Mais la nouvelle génération ne veut pas être contrôlée par des appareils bureaucratiques ou manipulée par des sectes « marxistes » qui ont les mêmes tares bureaucratiques et la même arrogance que les vieux dirigeants réformistes ou staliniens.
L’intervention de nos camarades grecs a été un modèle sur la façon d’approcher les masses. Ils combinent la fermeté sur les principes avec une grande flexibilité tactique. Il faut intervenir dans le mouvement de masse et l’aider à vaincre. Mais il faut également souligner ses faiblesses et convaincre les meilleurs éléments de la nécessité d’une politique révolutionnaire conséquente. C’est la seule méthode correcte ! Les marxistes de toute l’Europe devraient y puiser des leçons et suivre cet exemple.
Alan Woods, le 22 juin