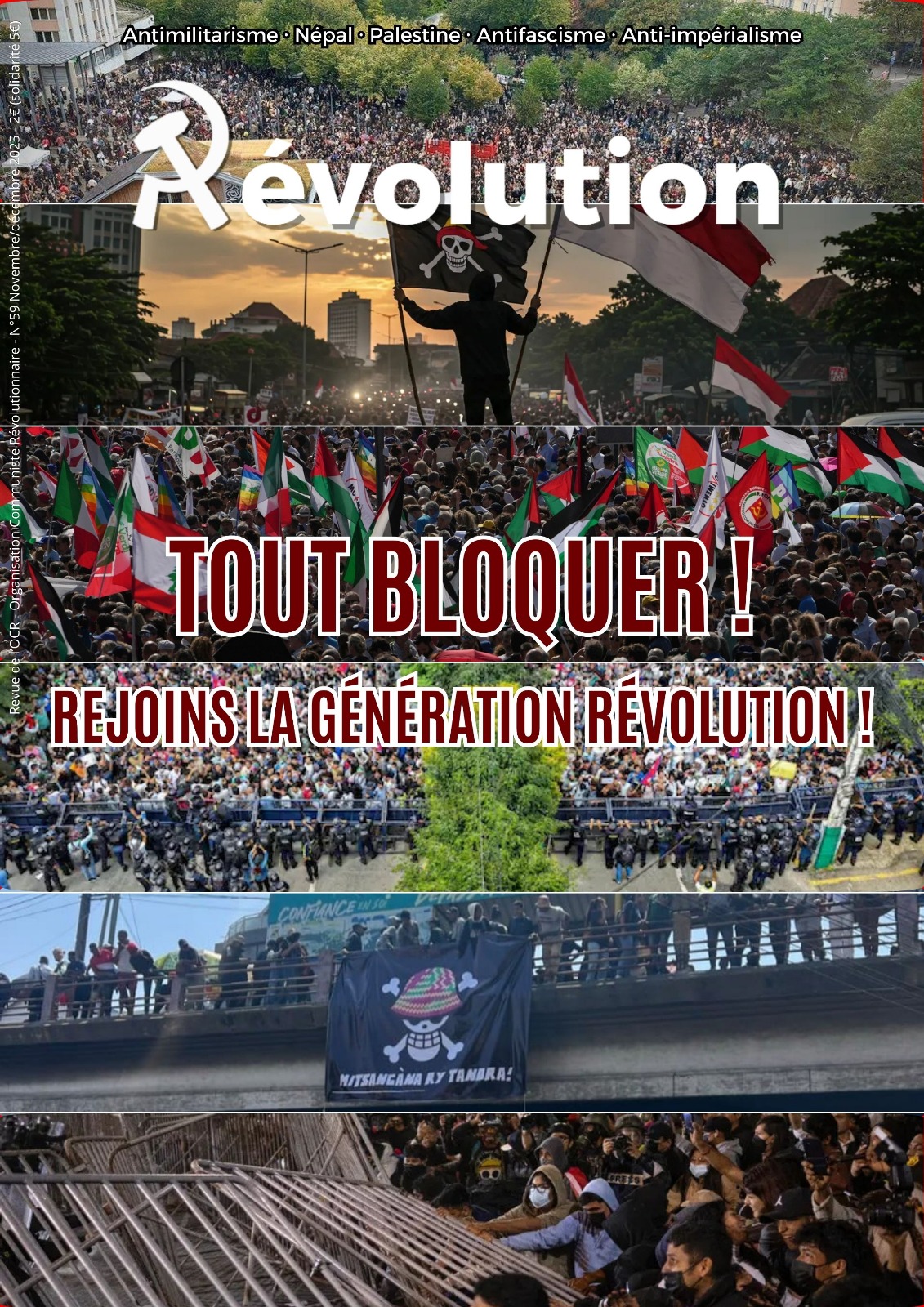En janvier 2015, après cinq années de récession et de politiques d’austérité draconiennes, le parti Syriza (« gauche radicale ») était porté au pouvoir par un puissant mouvement des masses grecques.
Elu sur un programme de réformes progressistes (augmentation des salaires et des pensions, embauche de fonctionnaires, etc.), le gouvernement d’Alexis Tsipras annonçait son intention d’appliquer son programme tout en renégociant avec la « troïka » (UE, BCE, FMI) les termes du remboursement de la dette publique grecque.
Ces illusions furent vite balayées. Le grand Capital européen – et surtout allemand – avait un objectif central : forcer Tsipras à poursuivre les politiques d’austérité de ses prédécesseurs. En juin 2015, les dirigeants européens prirent des mesures pour asphyxier le système financier grec. La main serrait la gorge non pour tuer, mais pour faire céder. Pour s’en dégager, Tsipras aurait dû rompre avec le capitalisme grec, répudier la dette et appeler tous les travailleurs d’Europe à suivre cet exemple.
Mais Tsipras céda aux exigences de la « troïka », le 13 juillet, après avoir pourtant obtenu 60 % de « non » à l’austérité lors du référendum du 5 juillet. Dans la foulée, le gouvernement de Syriza fit exactement ce qu’attendait de lui la bourgeoisie européenne : coupes budgétaires, privatisations, contre-réformes, etc.
Les élections de juillet 2019
C’est dans ce contexte qu’il faut analyser la victoire de Nouvelle Démocratie (ND, droite), lors des élections législatives du 7 juillet dernier. Est-ce que les masses grecques « virent à droite », comme l’affirment certains militants de gauche dépités ? Non. ND n’a pas rassemblé au-delà de sa base sociale traditionnelle (la bourgeoisie et la petite bourgeoisie). Elle profite du déclin du parti fasciste Aube Dorée (qui passe de 7 % à 3 %), mais elle ne réunit pas plus de voix que le « oui » au référendum du 5 juillet 2015. C’est donc une victoire de la droite par défaut, sur fond d’abstention massive (42 %) et de recul de Syriza (qui perd 500 000 voix depuis 2015).
Mais les théoriciens du « virage à droite » de la Grèce insistent : « malgré sa politique réactionnaire, depuis 2015, Syriza résiste bien (30 %). Cela prouve qu’il n’y a pas d’espace pour une politique de gauche radicale ».
Cette interprétation est très superficielle. Les 30 % de Syriza ne reposaient pas sur l’enthousiasme que suscite la politique de ce parti, mais plutôt sur la volonté de faire barrage au retour de la droite au pouvoir. Or, cette tendance au soi-disant « vote utile » était d’autant plus forte que la gauche radicale – et, notamment, le Parti Communiste grec (KKE) – n’est pas parvenue à présenter un programme et une perspective crédibles.
La stagnation du KKE
Avec 300 000 voix (5,3 %), le KKE a fait pratiquement le même score qu’aux élections de 2012. Il stagne, donc, malgré la crise du capitalisme et la capitulation de Syriza. Pourquoi ?
C’est clair : les dirigeants du KKE ont multiplié les erreurs. Entre 2010 et 2015, lorsque Syriza était en pleine ascension, ils ont adopté à son égard une attitude complètement sectaire, refusant de lui accorder un soutien critique face à la droite. La direction du KKE est allée jusqu’à appeler à l’abstention lors du référendum – pour ou contre l’austérité – du 5 juillet 2015 ! Ce sectarisme forcené a isolé le parti de larges couches de la jeunesse et du salariat.
En conséquence, lorsque Tsipras a capitulé, le 13 juillet 2015, le KKE n’était pas en bonne posture pour incarner une alternative révolutionnaire à la faillite de Syriza. Il l’était d’autant moins qu’il a eu tendance, par la suite, à mettre entre parenthèses son programme de rupture avec le capitalisme, au profit d’un discours électoraliste sur la nécessité d’une « opposition forte ». Au lieu d’expliquer systématiquement la nécessité de renverser le capitalisme et de porter les travailleurs au pouvoir, il a laissé entendre qu’un changement radical ne serait possible qu’à plus ou moins long terme.
C’est dans ce contexte précis que Syriza a réussi à apparaître comme le « moindre mal », face à une droite qui s’engage à aggraver brutalement les contre-réformes et le programme de privatisations.
Perspectives
Ceci dit, il est peu probable que Syriza joue un rôle important dans l’opposition au gouvernement de droite. Les travailleurs n’oublieront pas la trahison de Tsipras. En outre, la direction de Syriza cherche à le stabiliser comme « parti de gouvernement » (comprenez : pro-capitaliste).
Dans ce contexte, le KKE peut jouer un rôle décisif dans la période à venir, qui sera marquée par des luttes explosives. Mais pour cela, le parti devra corriger les erreurs de sa direction. Le KKE, qui compte sur des militants nombreux et dévoués, doit désormais combler le fossé qui le sépare des masses. Un large débat doit s’ouvrir, dans le parti, pour lui permettre de renouer avec les idées authentiques du marxisme révolutionnaire.