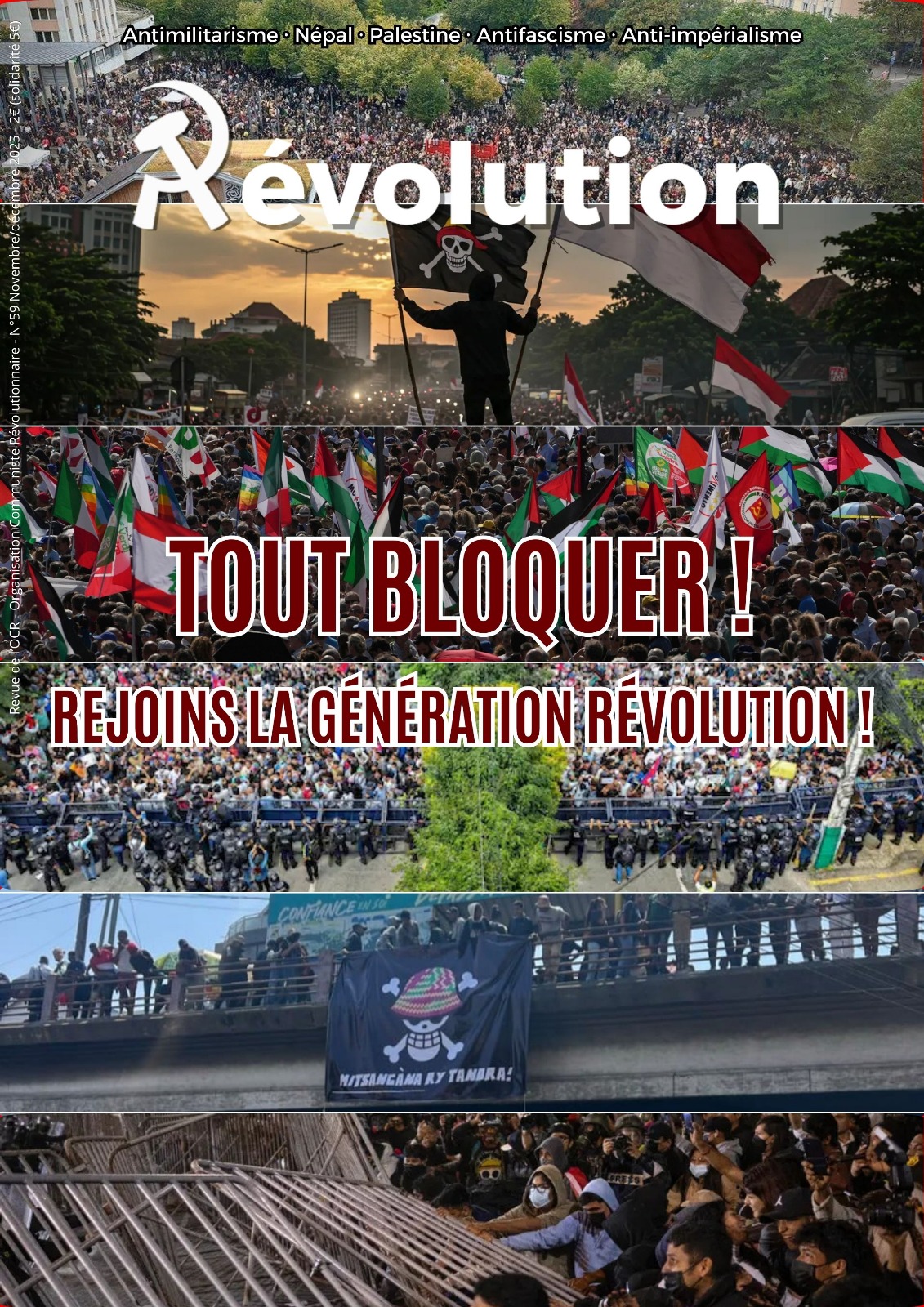L’élection présidentielle du 7 octobre prochain représente un moment décisif dans l’histoire du Venezuela. Le résultat de cette élection aura un impact majeur sur tout le continent et sur la scène internationale.
soutient activement le candidat bolivarien Hugo Chavez. Elle lutte contre toute tentative de l’oligarchie et de l’impérialisme de saboter les élections. La Tendance Marxiste Internationale soutient fermement la réélection d’Hugo Chavez. Pourquoi avons-nous pris cette position ?
La victoire de Chavez en 1998 représentait un progrès historique pour les ouvriers et les paysans du Venezuela. Selon la Commission Economique des Nations Unies sur l’Amérique latine, il y a eu une baisse de 21 % du taux de pauvreté entre 1999 et 2010. L’analphabétisme a été aboli. Pour la première fois dans le pays, les pauvres ont eu accès à des soins médicaux gratuits.
Toutes ces conquêtes sociales seraient menacées par une victoire de l’opposition. C’est le devoir élémentaire de tout révolutionnaire de les défendre. Celui qui n’est pas en mesure de défendre les conquêtes passées ne pourra jamais aller vers la victoire finale.
L’opposition prétend qu’elle ne reviendra pas sur les réformes de Chavez. Cette affirmation n’est absolument pas digne de confiance. Prenons un seul exemple : le logement. La « Mission Habitat » a permis de construire des milliers de maisons pour les pauvres. En mai, le ministre de l’Information Andrés Izarra a annoncé que le programme avait respecté son objectif en atteignant le chiffre de 200 000 logements construits depuis ses débuts en 2011. Un sondage d’Hinterlaces rapporte qu’avec un taux d’approbation de 76 %, la Mission Habitat est le programme social le plus populaire. Et pourtant, la coalition d’opposition (MUD) la surnomme « Mission de la fraude et de l’échec ». Elle reproche au gouvernement d’avoir exproprié des terrains pour construire les logements.
Lorsque Henrique Capriles Radonski – le candidat de l’opposition – a accédé au poste de gouverneur de l’Etat de Miranda, en 2008, il a mobilisé ses partisans contre les médecins cubains qui participaient aux programmes de soins gratuits mis en place par la révolution. Il a systématiquement tenté de fermer les différents programmes sociaux en les expulsant des locaux appartenant à l’Etat de Miranda. C’est uniquement la mobilisation active du peuple dans les rues qui a permis de défendre les conquêtes de la révolution.
La nouvelle législation du travail a récemment réduit la semaine de travail de 44 à 40 heures. Les congés maternité – avant et après l’accouchement – sont passés de 18 à 26 semaines. De même, lorsqu’il quitte une entreprise, quelle qu’en soit la raison, un salarié recevra désormais une indemnisation basée sur son dernier salaire mensuel multiplié par le nombre d’années d’emploi – ce qui était une revendication syndicale majeure. Au même moment, en Europe, tous les gouvernements aggravent la précarité de l’emploi.
Capriles a attaqué cette loi au motif qu’elle « n’a aucun impact sur le chômage et ne change rien pour les petits boulots occasionnels et non protégés ». Cela signifie que cette réforme serait abolie par l’opposition, si elle arrive au pouvoir.
L’opposition affirme défendre la « démocratie » contre la « dictature ». Mais c’est cette même opposition qui était derrière la tentative de coup d’Etat de 2002. S’ils avaient réussi à renverser Chavez, il n’y aurait plus eu de démocratie au Venezuela. L’exemple du Chili, après septembre 1973, montre quel sort lui aurait été réservé. Capriles lui-même, comme maire d’un arrondissement de Caracas, a participé à la tentative de prendre d’assaut l’ambassade de Cuba lors du coup d’Etat d’avril 2002.
L’opposition bourgeoise a montré son mépris pour la démocratie et les élections lorsqu’elle a décidé de boycotter les élections législatives de 2005. Aujourd’hui, les dirigeants de l’opposition se proclament « les défenseurs » de la constitution de 1999 – celle-là même qu’ils ont toujours violemment combattue, bien qu’elle fût approuvée par une écrasante majorité lors d’un referendum populaire.
Personne ne peut accorder la moindre confiance aux prétentions démocratiques de l’opposition.
Ce que représente l’opposition
L’opposition prétend représenter les classes moyennes. C’est un mensonge. L’opposition représente les intérêts de l’oligarchie – des grands propriétaires terriens, des banquiers et des capitalistes. Elle est complètement subordonnée aux impérialistes et aux grandes compagnies pétrolières qui ont dominé et pillé le Venezuela pendant des générations.
Les riches détestent Chavez car ils craignent qu’il supprime la propriété privée. Ils sont poussés par le ressentiment de leur classe envers les pauvres, qui, après avoir été ignorés pendant des décennies, ont bénéficié des programmes progressistes du gouvernement. L’opposition ne représente pas la classe moyenne ; elle l’exploite politiquement.
Capriles se présente comme un « réformateur ». Il prétend ne défendre aucune idéologie. Nous avons déjà souvent entendu cette histoire : « je n’ai pas d’idéologie – autrement dit, je suis de droite. » En fait, il suffit de jeter un coup d’œil sur le parti auquel appartient ce politicien « non-idéologique » pour comprendre immédiatement ce qu’il en est réellement.
Capriles prétend être un « progressiste ». Il dit qu’il ne répètera pas la « politique erronée » du Venezuela d’avant 1998. Mais tous les partis qui ont soutenu sa candidature sont responsables de ces politiques, qui n’étaient pas du tout des « erreurs », mais l’expression directe des intérêts de la clique des super-riches qui dirigeait le pays.
Les masses vénézuéliennes ne sont pas naïves. Elles ne se laissent pas tromper par la démagogie de Capriles. Elles voient bien que derrière son masque souriant se dissimule le visage monstrueux de l’oligarchie, qui, si elle retourne au pouvoir, les foulera aux pieds.
Capriles appartient au parti Première Justice (MPJ), un parti bourgeois qui défend « les entreprises privées » et s’oppose à l’intervention de l’Etat dans la vie économique. C’est ironique, à une époque où ce qu’on appelle la « libre entreprise » se révèle être une gigantesque fraude à l’échelle mondiale.
M. Capriles ignore-t-il que le système capitaliste est partout dans une crise profonde ? Quand les banques privées aux Etats-Unis se sont effondrées en 2008, qu’ont fait leurs patrons ? Se sont-ils contentés de chanter les louanges de « l’entreprise privée » ? Non, ils se sont précipités vers l’Etat et ont exigé que le gouvernement injecte des milliards de dollars de fonds publics dans les coffres des banques, pour les sauver.
Du fait de la faillite de « l’entreprise privée », tous les gouvernements européens sont profondément embourbés dans la dette. Ils disent qu’il n’y a pas d’argent pour les écoles, les hôpitaux et les retraites, mais curieusement, il y a beaucoup d’argent pour les banquiers.
Ces dernières semaines, un dirigeant de l’opposition a révélé un document rédigé par les conseillers économiques de campagne de Capriles. Ce document contient des détails sur les plans réels du candidat de droite. Il met en avant un paquet de mesures d’austérité classique : coupes dans les retraites, les dépenses sociales et les programmes sociaux. Il prévoit aussi l’« ouverture » de PDVSA et d’autres entreprises publiques aux investisseurs privés, et ainsi de suite. Ce programme est tellement scandaleux que quatre petits partis de la plateforme d’opposition (MUD) ont retiré leur soutien à Capriles – et qu’une foule de personnalités de l’opposition ont également pris leurs distances.
Les ouvriers et les paysans comprennent ce qui est en jeu. A chaque tournant décisif, ils se sont rassemblés pour défendre la révolution contre ses ennemis : les grands propriétaires fonciers, les banquiers, les capitalistes et les impérialistes qui se tiennent derrière eux. Ils comprennent qu’un vote pour Chavez aux prochaines élections est un vote contre le retour des années noires, de l’époque où petite poignée de riches oligarques décidaient de tout tandis que la majorité de la population, vivant dans la pauvreté, ne comptait pour rien.
En dépit des affirmations de l’opposition, qui annonce sa victoire, Chavez est en tête dans les sondages. Le sondage de Datanalisis donne à Chavez une avance comprise entre 27 et 43 % sur Capriles. Il montre aussi que 62 % des électeurs jugent positivement la politique du président, tandis que seuls 29 % d’entre eux la jugent mauvaise. Ces chiffres ont une certaine crédibilité, car le propriétaire de Datanalisis, Luis Vicente Léon, est bien connu pour être un partisan de l’opposition.
Capriles et l’impérialisme américain
Chavez est considéré comme l’ennemi public numéro un par Washington, qui voit en lui le principal instigateur de l’opposition à l’impérialisme américain en Amérique latine. Chavez a condamné énergiquement la tentative de coup d’Etat contre le Président du Paraguay Fernando Lugo. Téléguidé par ses amis du Département d’Etat américain, Capriles a critiqué Chavez pour, à l’époque, avoir rappelé son ambassadeur d’Asunción et coupé les approvisionnements en pétrole vers le Paraguay.
Capriles s’engage à rétablir des relations amicales avec les Etats-Unis, ce qui veut dire asservir le Venezuela à Washington, comme c’était le cas par le passé. Il promet une révision profonde des programmes d’aides et des alliances avec le reste de l’Amérique latine. Cela signifie une rupture avec Cuba, la Bolivie, l’Equateur et le Nicaragua, pour contenter ses « alliés » du nord du Rio Grande.
Peu de temps avant de démissionner de son poste de président de la Banque Mondiale, en juin, Robert Zoellick a déclaré : « les jours de Chavez sont comptés », de sorte qu’avec la fin des aides du gouvernement vénézuélien à l’étranger, d’autres pays comme Cuba et le Nicaragua seront « mis en difficulté ». Zoellick voit dans une victoire de Capriles « une opportunité de faire de l’hémisphère ouest le premier hémisphère démocratique », à l’opposé d’une « région de coups d’Etats, de caudillos, et de cocaïne ».
Ces mots expriment avec précision l’attitude de l’impérialisme américain face aux élections du 7 octobre. Ils les voient comme un évènement décisif. Si l’opposition l’emporte, cela signifiera un retour à la situation d’avant 1998, quand le Venezuela était dirigé par les grands monopoles américains. Mais si Chavez gagne, ce sera un coup dévastateur porté à la contre-révolution, comme s’en inquiète Michael Penfold dans Foreign Affairs : « Si Chavez gagne en octobre, la grande majorité du capital politique de l’opposition sera anéantie ; à bien des égards, ce sera le retour à la case départ ».
C’est pourquoi les impérialistes et leurs agents locaux gratifient Chavez d’un traitement spécial. Les expropriations, le renversement des mesures économiques « néolibérales », la création d’une milice populaire, le refus de se soumettre à la pression de Washington, les attaques contre le capitalisme et les appels en faveur du socialisme – tout ceci constitue un cocktail dangereux et explosif qui agit comme un puissant catalyseur des tendances révolutionnaires en Amérique latine.
Un autre objectif du programme électoral de Chavez est l’expansion du pouvoir des conseils communaux. Plusieurs centaines de « communes en construction » doivent être impliquées dans des domaines tels que la distribution de l’eau et du gaz. Chavez propose de promouvoir la création de nouvelles communes pour représenter 68 % de la population. Les communes doivent se voir accorder les mêmes prérogatives que l’Etat et les gouvernements municipaux, y compris la budgétisation, la participation à la planification étatique et, finalement, la perception des impôts. Toutes ces mesures représentent un empiétement progressif de l’Etat dans la vie économique.
Les impérialistes craignent qu’une victoire électorale de Chavez en octobre se traduise par un changement encore plus profond dans le pays. Chavez a annoncé que la période 2013-2019 verrait de nouvelles incursions de l’Etat dans le commerce et les transports, au détriment des intermédiaires. Cela se ferait à travers la création de « centres de distribution locaux pour la vente et la distribution directe de produits ». L’existence même du capitalisme au Venezuela pourrait se voir menacée par cette tendance à de nouvelles expropriations.
La véritable divergence
La division entre les deux camps est la division entre les deux classes antagonistes : d’un côté, des millions de pauvres, de travailleurs et de paysans, les citadins pauvres et les couches inférieures de la classe moyenne ; de l’autre, les grands propriétaires terriens, les banquiers, les capitalistes et les couches supérieures de la classe moyenne.
La véritable divergence porte sur la question de la propriété privée : la question de la politique économique – et en particulier des expropriations. L’écrasante majorité des partisans de Chavez viennent des couches les plus pauvres de la population, et ils défendent fermement le socialisme, l’expropriation des propriétaires terriens et des capitalistes.
La bureaucratie bolivarienne a tenté d’affaiblir le programme socialiste. Elle parle d’« économie mixte », dans laquelle des monopoles et des oligopoles seront en concurrence avec des entreprises publiques. Il s’agit de la vieille idée d’une « troisième voie » entre le capitalisme et le socialisme, idée que le Président Chavez a correctement qualifiée de farce.
Il n’est pas possible de faire la moitié d’une révolution. En dernière analyse, une classe doit gagner et l’autre perdre. Les nationalisations partielles ne marchent jamais : il est impossible de planifier ce qu’on ne contrôle pas, et il est impossible de contrôler ce qu’on ne possède pas. Une économie qui n’est que partiellement détenue par l’Etat ne peut pas être correctement planifiée.
En même temps, toute tentative de « réguler » le capitalisme dans le but d’améliorer la situation des masses – à travers le contrôle des prix, le contrôle des changes, etc. – empêche le fonctionnement normal d’une économie de marché, créant ainsi une situation chaotique avec de l’inflation, une fuite des capitaux, la chute des investissements, des fermetures d’usines, des pénuries artificiellement créées, de la thésaurisation et de la spéculation sur des produits alimentaires de base, du sabotage et un gaspillage bureaucratique.
Le secteur privé, qui contrôle encore une partie importante de l’économie, est entre les mains des ennemis de la révolution. Les capitalistes utilisent tout leur pouvoir pour saboter l’économie au moyen d’une grève du capital. Il est nécessaire d’exproprier les terres, les banques et les grandes entreprises pour mettre un terme à ce sabotage.
Capriles s’est engagé à mettre un terme à toutes les expropriations. « Je ne vais pas me disputer avec des hommes d’affaires ou qui que ce soit », dit-il. Naturellement ! Comment pourrait-il se disputer avec les personnes dont il représente les intérêts et dont il fait partie ? Capriles lui-même est issu d’une grande famille de capitalistes aux intérêts multiples (immobilier, industrie, médias). Il est également l’ancien maire de Baruta, un quartier prospère de Caracas.
Il promet de créer trois millions d’emplois au cours de sa présidence. Comment compte-t-il accomplir ce miracle ? En levant les restrictions sur les investissements étrangers, c’est-à-dire en servant le Venezuela sur un plateau d’argent aux mêmes grandes sociétés étrangères qui le pillèrent par le passé. Ce n’est pas un hasard si le MUD veut « assouplir » la loi sur le contrôle de l’Etat sur l’industrie pétrolière, « afin de promouvoir la concurrence et la participation du secteur privé dans l’industrie ».
La révolution n’est pas terminée
Une victoire de Chavez renforcera le basculement à gauche de l’Amérique latine au moment où le capitalisme est dans une profonde crise à l’échelle mondiale. Cela minera encore plus l’influence américaine alors que ses projets pour l’Irak et l’Afghanistan sont en ruines. A l’inverse, une défaite de Chavez ferait reculer le Venezuela jusqu’avant 1999. Cela porterait un coup sévère à la gauche dans le monde entier. Cuba serait complètement isolé, ce qui donnerait une puissante impulsion aux éléments pro-capitalistes sur l’île.
L’opposition a cyniquement tenté de tirer profit de la maladie de Chavez avant la campagne présidentielle. Elle a souligné la « fragilité » de Chavez, par opposition à la prétendue bonne santé de son adversaire, plein de jeunesse et d’énergie. En outre, ajoute l’opposition, les chavistes n’ont personne qui pourrait le remplacer. Sur ce point, elle a raison. Et le fait qu’ils dépendent d’un seul homme est une faiblesse incontestable du mouvement bolivarien et du PSUV.
Chavez est allé plus loin que n’importe quel autre dirigeant en Amérique latine. Il a défié l’impérialisme et le capitalisme. Il a remis le socialisme à l’ordre du jour. Cela mérite d’être reconnu. Mais il existe des contradictions profondes au sein du mouvement bolivarien, car tout le monde n’y est pas favorable au socialisme – ou opposé au capitalisme.
Quand Chavez a été élu président pour la première fois, en décembre 1998, il avait un programme assez vague qui ne mentionnait pas le socialisme. Mais la vie enseigne. Sur la base de l’expérience, il s’est prononcé en faveur du socialisme. C’est un grand pas en avant. Mais il reste encore à le mettre en œuvre. Certes, il y a eu certains progrès : il a partiellement nationalisé certains secteurs clés comme les télécommunications, le ciment et l’acier. Il a attaqué à plusieurs reprises la bourgeoisie et l’oligarchie (ce qui est la même chose) et il s’est élevé contre l’impérialisme américain.
Mais l’absence de contrôle ouvrier dans les industries lourdes appartenant à l’Etat, comme l’acier, a engendré de nombreuses difficultés et des mécontentements. Les travailleurs en veulent à la bureaucratie qui est en train de les écarter et d’usurper le contrôle du mouvement bolivarien. Toutes les tentatives des travailleurs pour introduire des éléments de gestion et de contrôle ouvriers, par exemple dans les industries lourdes de base dans l’Etat de Guyana, malgré le soutien du Président, ont rencontré une résistance farouche de la part de la bureaucratie, qui est même allée jusqu’au sabotage. C’est ce qui s’est passé dans la sidérurgie de Guyana. Profitant de la maladie du Président, ces éléments parlent ouvertement de « chavisme sans Chavez. » Ils représentent le plus grand danger pour la révolution.
Chavez a suscité chez les masses un éveil à la vie politique et à la lutte, ce qui explique le lien profond qui les unit. Mais aujourd’hui, treize ans après l’élection de Chavez, la victoire finale de la révolution n’a pas encore été accomplie. Tant que la terre, les banques et les grandes entreprises resteront entre les mains de l’oligarchie, la révolution bolivarienne ne sera pas en sécurité.
La vérité est qu’une grande partie de la bureaucratie bolivarienne n’a jamais été favorable au socialisme. Les bureaucrates bolivariens ont sans cesse conspiré pour freiner la révolution, stopper les expropriations et surtout éviter que les travailleurs ne prennent le contrôle du processus.
Le Monde Diplomatique a récemment révélé l’attitude de l’aile droite du mouvement bolivarien, qui a longtemps rêvé de « chavisme sans Chavez » : « Au cours d’une visite au Brésil, en avril 2010, un journaliste demanda à M. Chavez s’il envisageait de céder un jour la place à un autre dirigeant : "Je n’ai pas de successeur en vue", répliqua-t-il. Est-ce encore le cas aujourd’hui ? L’année dernière, il concédait à l’un de ses anciens conseillers, l’universitaire espagnol Juan Carlos Monedero, qui venait de le mettre en garde contre les dangers d’un "hyperleadership" au Venezuela : "Je dois apprendre à mieux déléguer le pouvoir. " Durant les périodes où ses traitements l’éloignaient des affaires, plusieurs responsables politiques ont comblé le vide et émergé comme de possibles successeurs.
« Notamment le ministre des Affaires étrangères actuel, M. Nicolas Maduro, un ancien dirigeant syndical qui a présidé la commission à l’origine de la nouvelle législation sur le travail et qui dispose d’appuis solides au sein des organisations de travailleurs. Ou encore le vice-président exécutif, M. Elias Jaua, très populaire auprès de la base militante du mouvement chaviste. Sans oublier le président de l’Assemblée nationale, le pragmatique Diosdado Cabello, un ancien lieutenant qui compte de puissants soutiens dans l’armée. Privés de l’omniprésente tutelle de M. Chavez, "certains d’entre nous ont pensé qu’il serait difficile de poursuivre le processus", expliquait l’ex-conseiller Monedero en mai dernier. A présent, nous n’avons plus cette crainte, puisque je vois des douzaines de personnes qui pourraient continuer le travail sans le moindre problème." »
Qu’il y ait « des douzaines de personnes » prêtes à s’emparer du contrôle du mouvement bolivarien dès que Chavez quitte la scène, nous n’en doutons pas. Mais les partisans du « chavisme sans Chavez » n’ont aucun désir de « poursuivre le processus » de la révolution. Au contraire, ils souhaitent « poursuivre le processus » du déraillement de la révolution bolivarienne, c’est-à-dire édulcorer son programme afin qu’il soit acceptable pour l’oligarchie, interrompre les expropriations et faire marche arrière sur tout le programme. En d’autres termes, ils souhaitent mettre en œuvre le programme de la Cinquième Colonne bourgeoise au sein du mouvement chaviste.
La clé du succès de la révolution, c’est le contrôle du mouvement par la base, qui doit le prendre aux bureaucrates et aux carriéristes qui ont fait tant de mal à la cause bolivarienne. Ce sont les ouvriers et les paysans qui ont été la véritable force motrice de la révolution. Ce sont eux et eux seuls qui doivent en prendre le contrôle. Les seuls qui peuvent mener la révolution à la victoire sont les travailleurs et les paysans.
A bas la contre-révolution !
Expropriation de l’oligarchie !
Le pouvoir aux ouvriers et aux paysans !
Mener la révolution à son terme !
La victoire de Chavez en 1998 représentait un progrès historique pour les ouvriers et les paysans du Venezuela. Selon la Commission Economique des Nations Unies sur l’Amérique latine, il y a eu une baisse de 21 % du taux de pauvreté entre 1999 et 2010. L’analphabétisme a été aboli. Pour la première fois dans le pays, les pauvres ont eu accès à des soins médicaux gratuits.
Toutes ces conquêtes sociales seraient menacées par une victoire de l’opposition. C’est le devoir élémentaire de tout révolutionnaire de les défendre. Celui qui n’est pas en mesure de défendre les conquêtes passées ne pourra jamais aller vers la victoire finale.
L’opposition prétend qu’elle ne reviendra pas sur les réformes de Chavez. Cette affirmation n’est absolument pas digne de confiance. Prenons un seul exemple : le logement. La « Mission Habitat » a permis de construire des milliers de maisons pour les pauvres. En mai, le ministre de l’Information Andrés Izarra a annoncé que le programme avait respecté son objectif en atteignant le chiffre de 200 000 logements construits depuis ses débuts en 2011. Un sondage d’Hinterlaces rapporte qu’avec un taux d’approbation de 76 %, la Mission Habitat est le programme social le plus populaire. Et pourtant, la coalition d’opposition (MUD) la surnomme « Mission de la fraude et de l’échec ». Elle reproche au gouvernement d’avoir exproprié des terrains pour construire les logements.
Lorsque Henrique Capriles Radonski – le candidat de l’opposition – a accédé au poste de gouverneur de l’Etat de Miranda, en 2008, il a mobilisé ses partisans contre les médecins cubains qui participaient aux programmes de soins gratuits mis en place par la révolution. Il a systématiquement tenté de fermer les différents programmes sociaux en les expulsant des locaux appartenant à l’Etat de Miranda. C’est uniquement la mobilisation active du peuple dans les rues qui a permis de défendre les conquêtes de la révolution.
La nouvelle législation du travail a récemment réduit la semaine de travail de 44 à 40 heures. Les congés maternité – avant et après l’accouchement – sont passés de 18 à 26 semaines. De même, lorsqu’il quitte une entreprise, quelle qu’en soit la raison, un salarié recevra désormais une indemnisation basée sur son dernier salaire mensuel multiplié par le nombre d’années d’emploi – ce qui était une revendication syndicale majeure. Au même moment, en Europe, tous les gouvernements aggravent la précarité de l’emploi.
Capriles a attaqué cette loi au motif qu’elle « n’a aucun impact sur le chômage et ne change rien pour les petits boulots occasionnels et non protégés ». Cela signifie que cette réforme serait abolie par l’opposition, si elle arrive au pouvoir.
L’opposition affirme défendre la « démocratie » contre la « dictature ». Mais c’est cette même opposition qui était derrière la tentative de coup d’Etat de 2002. S’ils avaient réussi à renverser Chavez, il n’y aurait plus eu de démocratie au Venezuela. L’exemple du Chili, après septembre 1973, montre quel sort lui aurait été réservé. Capriles lui-même, comme maire d’un arrondissement de Caracas, a participé à la tentative de prendre d’assaut l’ambassade de Cuba lors du coup d’Etat d’avril 2002.
L’opposition bourgeoise a montré son mépris pour la démocratie et les élections lorsqu’elle a décidé de boycotter les élections législatives de 2005. Aujourd’hui, les dirigeants de l’opposition se proclament « les défenseurs » de la constitution de 1999 – celle-là même qu’ils ont toujours violemment combattue, bien qu’elle fût approuvée par une écrasante majorité lors d’un referendum populaire.
Personne ne peut accorder la moindre confiance aux prétentions démocratiques de l’opposition.
Ce que représente l’opposition
L’opposition prétend représenter les classes moyennes. C’est un mensonge. L’opposition représente les intérêts de l’oligarchie – des grands propriétaires terriens, des banquiers et des capitalistes. Elle est complètement subordonnée aux impérialistes et aux grandes compagnies pétrolières qui ont dominé et pillé le Venezuela pendant des générations.
Les riches détestent Chavez car ils craignent qu’il supprime la propriété privée. Ils sont poussés par le ressentiment de leur classe envers les pauvres, qui, après avoir été ignorés pendant des décennies, ont bénéficié des programmes progressistes du gouvernement. L’opposition ne représente pas la classe moyenne ; elle l’exploite politiquement.
Capriles se présente comme un « réformateur ». Il prétend ne défendre aucune idéologie. Nous avons déjà souvent entendu cette histoire : « je n’ai pas d’idéologie – autrement dit, je suis de droite. » En fait, il suffit de jeter un coup d’œil sur le parti auquel appartient ce politicien « non-idéologique » pour comprendre immédiatement ce qu’il en est réellement.
Capriles prétend être un « progressiste ». Il dit qu’il ne répètera pas la « politique erronée » du Venezuela d’avant 1998. Mais tous les partis qui ont soutenu sa candidature sont responsables de ces politiques, qui n’étaient pas du tout des « erreurs », mais l’expression directe des intérêts de la clique des super-riches qui dirigeait le pays.
Les masses vénézuéliennes ne sont pas naïves. Elles ne se laissent pas tromper par la démagogie de Capriles. Elles voient bien que derrière son masque souriant se dissimule le visage monstrueux de l’oligarchie, qui, si elle retourne au pouvoir, les foulera aux pieds.
Capriles appartient au parti Première Justice (MPJ), un parti bourgeois qui défend « les entreprises privées » et s’oppose à l’intervention de l’Etat dans la vie économique. C’est ironique, à une époque où ce qu’on appelle la « libre entreprise » se révèle être une gigantesque fraude à l’échelle mondiale.
M. Capriles ignore-t-il que le système capitaliste est partout dans une crise profonde ? Quand les banques privées aux Etats-Unis se sont effondrées en 2008, qu’ont fait leurs patrons ? Se sont-ils contentés de chanter les louanges de « l’entreprise privée » ? Non, ils se sont précipités vers l’Etat et ont exigé que le gouvernement injecte des milliards de dollars de fonds publics dans les coffres des banques, pour les sauver.
Du fait de la faillite de « l’entreprise privée », tous les gouvernements européens sont profondément embourbés dans la dette. Ils disent qu’il n’y a pas d’argent pour les écoles, les hôpitaux et les retraites, mais curieusement, il y a beaucoup d’argent pour les banquiers.
Ces dernières semaines, un dirigeant de l’opposition a révélé un document rédigé par les conseillers économiques de campagne de Capriles. Ce document contient des détails sur les plans réels du candidat de droite. Il met en avant un paquet de mesures d’austérité classique : coupes dans les retraites, les dépenses sociales et les programmes sociaux. Il prévoit aussi l’« ouverture » de PDVSA et d’autres entreprises publiques aux investisseurs privés, et ainsi de suite. Ce programme est tellement scandaleux que quatre petits partis de la plateforme d’opposition (MUD) ont retiré leur soutien à Capriles – et qu’une foule de personnalités de l’opposition ont également pris leurs distances.
Les ouvriers et les paysans comprennent ce qui est en jeu. A chaque tournant décisif, ils se sont rassemblés pour défendre la révolution contre ses ennemis : les grands propriétaires fonciers, les banquiers, les capitalistes et les impérialistes qui se tiennent derrière eux. Ils comprennent qu’un vote pour Chavez aux prochaines élections est un vote contre le retour des années noires, de l’époque où petite poignée de riches oligarques décidaient de tout tandis que la majorité de la population, vivant dans la pauvreté, ne comptait pour rien.
En dépit des affirmations de l’opposition, qui annonce sa victoire, Chavez est en tête dans les sondages. Le sondage de Datanalisis donne à Chavez une avance comprise entre 27 et 43 % sur Capriles. Il montre aussi que 62 % des électeurs jugent positivement la politique du président, tandis que seuls 29 % d’entre eux la jugent mauvaise. Ces chiffres ont une certaine crédibilité, car le propriétaire de Datanalisis, Luis Vicente Léon, est bien connu pour être un partisan de l’opposition.
Capriles et l’impérialisme américain
Chavez est considéré comme l’ennemi public numéro un par Washington, qui voit en lui le principal instigateur de l’opposition à l’impérialisme américain en Amérique latine. Chavez a condamné énergiquement la tentative de coup d’Etat contre le Président du Paraguay Fernando Lugo. Téléguidé par ses amis du Département d’Etat américain, Capriles a critiqué Chavez pour, à l’époque, avoir rappelé son ambassadeur d’Asunción et coupé les approvisionnements en pétrole vers le Paraguay.
Capriles s’engage à rétablir des relations amicales avec les Etats-Unis, ce qui veut dire asservir le Venezuela à Washington, comme c’était le cas par le passé. Il promet une révision profonde des programmes d’aides et des alliances avec le reste de l’Amérique latine. Cela signifie une rupture avec Cuba, la Bolivie, l’Equateur et le Nicaragua, pour contenter ses « alliés » du nord du Rio Grande.
Peu de temps avant de démissionner de son poste de président de la Banque Mondiale, en juin, Robert Zoellick a déclaré : « les jours de Chavez sont comptés », de sorte qu’avec la fin des aides du gouvernement vénézuélien à l’étranger, d’autres pays comme Cuba et le Nicaragua seront « mis en difficulté ». Zoellick voit dans une victoire de Capriles « une opportunité de faire de l’hémisphère ouest le premier hémisphère démocratique », à l’opposé d’une « région de coups d’Etats, de caudillos, et de cocaïne ».
Ces mots expriment avec précision l’attitude de l’impérialisme américain face aux élections du 7 octobre. Ils les voient comme un évènement décisif. Si l’opposition l’emporte, cela signifiera un retour à la situation d’avant 1998, quand le Venezuela était dirigé par les grands monopoles américains. Mais si Chavez gagne, ce sera un coup dévastateur porté à la contre-révolution, comme s’en inquiète Michael Penfold dans Foreign Affairs : « Si Chavez gagne en octobre, la grande majorité du capital politique de l’opposition sera anéantie ; à bien des égards, ce sera le retour à la case départ ».
C’est pourquoi les impérialistes et leurs agents locaux gratifient Chavez d’un traitement spécial. Les expropriations, le renversement des mesures économiques « néolibérales », la création d’une milice populaire, le refus de se soumettre à la pression de Washington, les attaques contre le capitalisme et les appels en faveur du socialisme – tout ceci constitue un cocktail dangereux et explosif qui agit comme un puissant catalyseur des tendances révolutionnaires en Amérique latine.
Un autre objectif du programme électoral de Chavez est l’expansion du pouvoir des conseils communaux. Plusieurs centaines de « communes en construction » doivent être impliquées dans des domaines tels que la distribution de l’eau et du gaz. Chavez propose de promouvoir la création de nouvelles communes pour représenter 68 % de la population. Les communes doivent se voir accorder les mêmes prérogatives que l’Etat et les gouvernements municipaux, y compris la budgétisation, la participation à la planification étatique et, finalement, la perception des impôts. Toutes ces mesures représentent un empiétement progressif de l’Etat dans la vie économique.
Les impérialistes craignent qu’une victoire électorale de Chavez en octobre se traduise par un changement encore plus profond dans le pays. Chavez a annoncé que la période 2013-2019 verrait de nouvelles incursions de l’Etat dans le commerce et les transports, au détriment des intermédiaires. Cela se ferait à travers la création de « centres de distribution locaux pour la vente et la distribution directe de produits ». L’existence même du capitalisme au Venezuela pourrait se voir menacée par cette tendance à de nouvelles expropriations.
La véritable divergence
La division entre les deux camps est la division entre les deux classes antagonistes : d’un côté, des millions de pauvres, de travailleurs et de paysans, les citadins pauvres et les couches inférieures de la classe moyenne ; de l’autre, les grands propriétaires terriens, les banquiers, les capitalistes et les couches supérieures de la classe moyenne.
La véritable divergence porte sur la question de la propriété privée : la question de la politique économique – et en particulier des expropriations. L’écrasante majorité des partisans de Chavez viennent des couches les plus pauvres de la population, et ils défendent fermement le socialisme, l’expropriation des propriétaires terriens et des capitalistes.
La bureaucratie bolivarienne a tenté d’affaiblir le programme socialiste. Elle parle d’« économie mixte », dans laquelle des monopoles et des oligopoles seront en concurrence avec des entreprises publiques. Il s’agit de la vieille idée d’une « troisième voie » entre le capitalisme et le socialisme, idée que le Président Chavez a correctement qualifiée de farce.
Il n’est pas possible de faire la moitié d’une révolution. En dernière analyse, une classe doit gagner et l’autre perdre. Les nationalisations partielles ne marchent jamais : il est impossible de planifier ce qu’on ne contrôle pas, et il est impossible de contrôler ce qu’on ne possède pas. Une économie qui n’est que partiellement détenue par l’Etat ne peut pas être correctement planifiée.
En même temps, toute tentative de « réguler » le capitalisme dans le but d’améliorer la situation des masses – à travers le contrôle des prix, le contrôle des changes, etc. – empêche le fonctionnement normal d’une économie de marché, créant ainsi une situation chaotique avec de l’inflation, une fuite des capitaux, la chute des investissements, des fermetures d’usines, des pénuries artificiellement créées, de la thésaurisation et de la spéculation sur des produits alimentaires de base, du sabotage et un gaspillage bureaucratique.
Le secteur privé, qui contrôle encore une partie importante de l’économie, est entre les mains des ennemis de la révolution. Les capitalistes utilisent tout leur pouvoir pour saboter l’économie au moyen d’une grève du capital. Il est nécessaire d’exproprier les terres, les banques et les grandes entreprises pour mettre un terme à ce sabotage.
Capriles s’est engagé à mettre un terme à toutes les expropriations. « Je ne vais pas me disputer avec des hommes d’affaires ou qui que ce soit », dit-il. Naturellement ! Comment pourrait-il se disputer avec les personnes dont il représente les intérêts et dont il fait partie ? Capriles lui-même est issu d’une grande famille de capitalistes aux intérêts multiples (immobilier, industrie, médias). Il est également l’ancien maire de Baruta, un quartier prospère de Caracas.
Il promet de créer trois millions d’emplois au cours de sa présidence. Comment compte-t-il accomplir ce miracle ? En levant les restrictions sur les investissements étrangers, c’est-à-dire en servant le Venezuela sur un plateau d’argent aux mêmes grandes sociétés étrangères qui le pillèrent par le passé. Ce n’est pas un hasard si le MUD veut « assouplir » la loi sur le contrôle de l’Etat sur l’industrie pétrolière, « afin de promouvoir la concurrence et la participation du secteur privé dans l’industrie ».
La révolution n’est pas terminée
Une victoire de Chavez renforcera le basculement à gauche de l’Amérique latine au moment où le capitalisme est dans une profonde crise à l’échelle mondiale. Cela minera encore plus l’influence américaine alors que ses projets pour l’Irak et l’Afghanistan sont en ruines. A l’inverse, une défaite de Chavez ferait reculer le Venezuela jusqu’avant 1999. Cela porterait un coup sévère à la gauche dans le monde entier. Cuba serait complètement isolé, ce qui donnerait une puissante impulsion aux éléments pro-capitalistes sur l’île.
L’opposition a cyniquement tenté de tirer profit de la maladie de Chavez avant la campagne présidentielle. Elle a souligné la « fragilité » de Chavez, par opposition à la prétendue bonne santé de son adversaire, plein de jeunesse et d’énergie. En outre, ajoute l’opposition, les chavistes n’ont personne qui pourrait le remplacer. Sur ce point, elle a raison. Et le fait qu’ils dépendent d’un seul homme est une faiblesse incontestable du mouvement bolivarien et du PSUV.
Chavez est allé plus loin que n’importe quel autre dirigeant en Amérique latine. Il a défié l’impérialisme et le capitalisme. Il a remis le socialisme à l’ordre du jour. Cela mérite d’être reconnu. Mais il existe des contradictions profondes au sein du mouvement bolivarien, car tout le monde n’y est pas favorable au socialisme – ou opposé au capitalisme.
Quand Chavez a été élu président pour la première fois, en décembre 1998, il avait un programme assez vague qui ne mentionnait pas le socialisme. Mais la vie enseigne. Sur la base de l’expérience, il s’est prononcé en faveur du socialisme. C’est un grand pas en avant. Mais il reste encore à le mettre en œuvre. Certes, il y a eu certains progrès : il a partiellement nationalisé certains secteurs clés comme les télécommunications, le ciment et l’acier. Il a attaqué à plusieurs reprises la bourgeoisie et l’oligarchie (ce qui est la même chose) et il s’est élevé contre l’impérialisme américain.
Mais l’absence de contrôle ouvrier dans les industries lourdes appartenant à l’Etat, comme l’acier, a engendré de nombreuses difficultés et des mécontentements. Les travailleurs en veulent à la bureaucratie qui est en train de les écarter et d’usurper le contrôle du mouvement bolivarien. Toutes les tentatives des travailleurs pour introduire des éléments de gestion et de contrôle ouvriers, par exemple dans les industries lourdes de base dans l’Etat de Guyana, malgré le soutien du Président, ont rencontré une résistance farouche de la part de la bureaucratie, qui est même allée jusqu’au sabotage. C’est ce qui s’est passé dans la sidérurgie de Guyana. Profitant de la maladie du Président, ces éléments parlent ouvertement de « chavisme sans Chavez. » Ils représentent le plus grand danger pour la révolution.
Chavez a suscité chez les masses un éveil à la vie politique et à la lutte, ce qui explique le lien profond qui les unit. Mais aujourd’hui, treize ans après l’élection de Chavez, la victoire finale de la révolution n’a pas encore été accomplie. Tant que la terre, les banques et les grandes entreprises resteront entre les mains de l’oligarchie, la révolution bolivarienne ne sera pas en sécurité.
La vérité est qu’une grande partie de la bureaucratie bolivarienne n’a jamais été favorable au socialisme. Les bureaucrates bolivariens ont sans cesse conspiré pour freiner la révolution, stopper les expropriations et surtout éviter que les travailleurs ne prennent le contrôle du processus.
Le Monde Diplomatique a récemment révélé l’attitude de l’aile droite du mouvement bolivarien, qui a longtemps rêvé de « chavisme sans Chavez » : « Au cours d’une visite au Brésil, en avril 2010, un journaliste demanda à M. Chavez s’il envisageait de céder un jour la place à un autre dirigeant : "Je n’ai pas de successeur en vue", répliqua-t-il. Est-ce encore le cas aujourd’hui ? L’année dernière, il concédait à l’un de ses anciens conseillers, l’universitaire espagnol Juan Carlos Monedero, qui venait de le mettre en garde contre les dangers d’un "hyperleadership" au Venezuela : "Je dois apprendre à mieux déléguer le pouvoir. " Durant les périodes où ses traitements l’éloignaient des affaires, plusieurs responsables politiques ont comblé le vide et émergé comme de possibles successeurs.
« Notamment le ministre des Affaires étrangères actuel, M. Nicolas Maduro, un ancien dirigeant syndical qui a présidé la commission à l’origine de la nouvelle législation sur le travail et qui dispose d’appuis solides au sein des organisations de travailleurs. Ou encore le vice-président exécutif, M. Elias Jaua, très populaire auprès de la base militante du mouvement chaviste. Sans oublier le président de l’Assemblée nationale, le pragmatique Diosdado Cabello, un ancien lieutenant qui compte de puissants soutiens dans l’armée. Privés de l’omniprésente tutelle de M. Chavez, "certains d’entre nous ont pensé qu’il serait difficile de poursuivre le processus", expliquait l’ex-conseiller Monedero en mai dernier. A présent, nous n’avons plus cette crainte, puisque je vois des douzaines de personnes qui pourraient continuer le travail sans le moindre problème." »
Qu’il y ait « des douzaines de personnes » prêtes à s’emparer du contrôle du mouvement bolivarien dès que Chavez quitte la scène, nous n’en doutons pas. Mais les partisans du « chavisme sans Chavez » n’ont aucun désir de « poursuivre le processus » de la révolution. Au contraire, ils souhaitent « poursuivre le processus » du déraillement de la révolution bolivarienne, c’est-à-dire édulcorer son programme afin qu’il soit acceptable pour l’oligarchie, interrompre les expropriations et faire marche arrière sur tout le programme. En d’autres termes, ils souhaitent mettre en œuvre le programme de la Cinquième Colonne bourgeoise au sein du mouvement chaviste.
La clé du succès de la révolution, c’est le contrôle du mouvement par la base, qui doit le prendre aux bureaucrates et aux carriéristes qui ont fait tant de mal à la cause bolivarienne. Ce sont les ouvriers et les paysans qui ont été la véritable force motrice de la révolution. Ce sont eux et eux seuls qui doivent en prendre le contrôle. Les seuls qui peuvent mener la révolution à la victoire sont les travailleurs et les paysans.
A bas la contre-révolution !
Expropriation de l’oligarchie !
Le pouvoir aux ouvriers et aux paysans !
Mener la révolution à son terme !