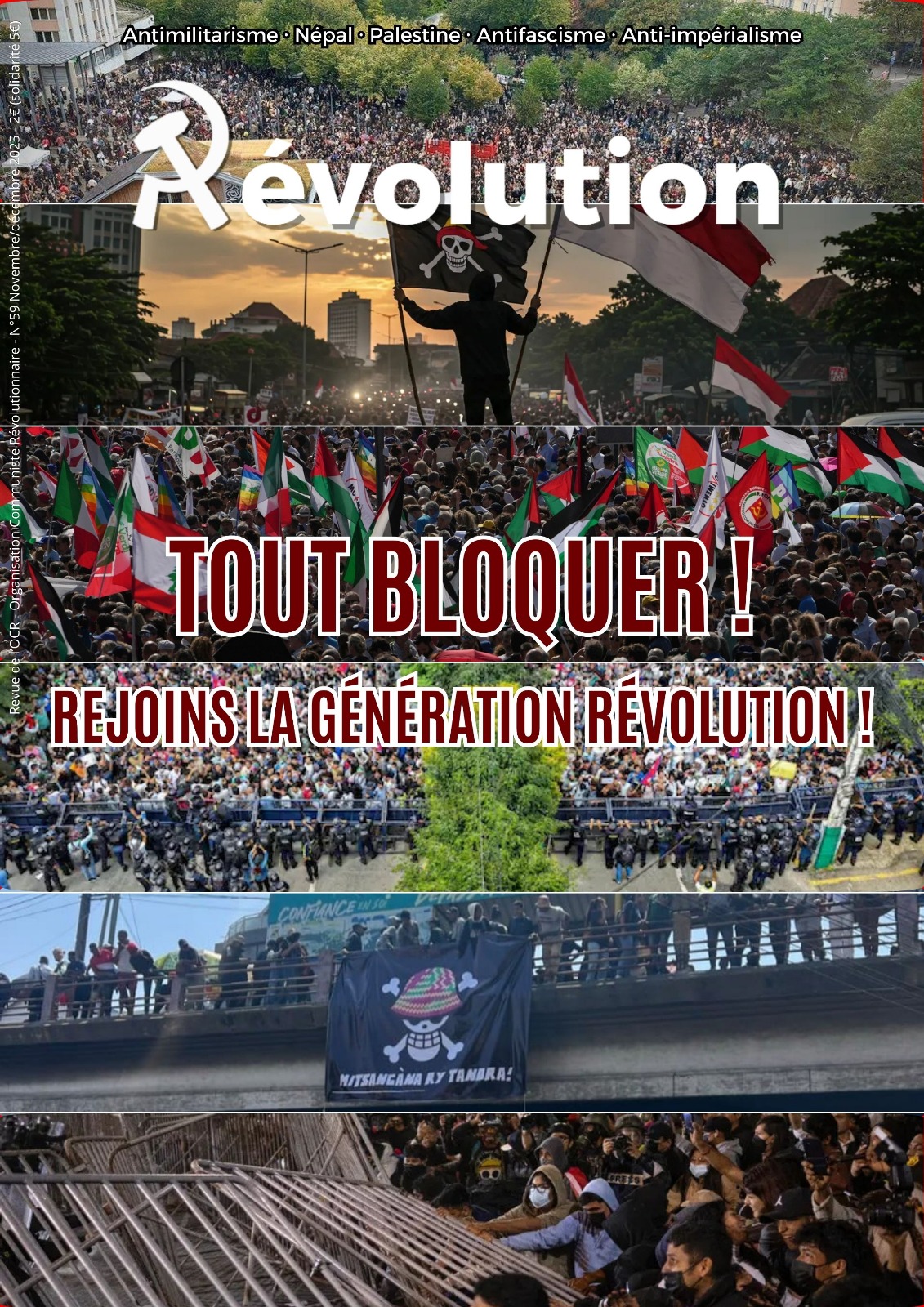Le président vénézuélien Hugo Chavez a une fois de plus gagné les élections présidentielles le dimanche 7 octobre 2012, avec une confortable avance de 54,84 % contre 44,55 % pour son adversaire Henrique Capriles.
C’est une nouvelle victoire pour la révolution bolivarienne qui devrait être utilisée afin de mener la révolution jusqu’à son terme.
Sur plus de 95 % de votes dépouillés, 7 860 982 voix sont en faveur de Chavez, et 6 386 155 voix pour le candidat de l’oligarchie et de l’impérialisme. La participation a atteint le chiffre incroyable de 81 %, battant le précédent record des élections présidentielles de 2006, qui était de 74 %. Cela montre le caractère extrêmement polarisé de cette campagne, dans laquelle les deux camps ont mobilisé l’ensemble de leurs partisans.
L’un des principaux enjeux de ces élections était précisément le taux de participation, qui se devait d’être massif. La campagne en faveur de la révolution bolivarienne avait lancé un appel à la population en demandant aux gens de se lever tôt, et d’aller voter en masse. Le but était de parvenir à une participation si massive qu’elle préviendrait toute tentative de l’opposition réactionnaire de crier à la fraude.
Un camarade du Venezuela a raconté que certaines personnes ont commencé à faire la queue devant les bureaux de vote dès la veille des élections. À 3 heures du matin, dans les quartiers pauvres de la classe ouvrière de Caracas et à travers tout le pays, retentit l’appel des chavistes pour réveiller la population. Au moment où les bureaux de vote ont ouvert leurs portes à 6 heures du matin, il y avait déjà de longues files d’attente, et durant toute la journée les gens affluaient pour voter.
A 18 heures, les bureaux de vote étaient censés fermer. Mais les règles électorales vénézuéliennes précisent que le vote est un droit démocratique, et que tant qu’une personne présente attend de pouvoir l’exercer, les bureaux de vote doivent rester ouverts. Ce fut le cas ce jour-là, où certains bureaux de vote sont restés ouverts jusqu’à 20h30, soit deux heures et demie après l’heure prévue.
C’est à ce moment-là que l’opposition contre-révolutionnaire devint clairement nerveuse. Capriles demanda la fermeture de tous les bureaux de vote à 18h01. La raison était claire : dans les quartiers bourgeois de Caracas, les bureaux étaient déserts, tandis que dans les quartiers pauvres et ouvriers, des centaines de personnes faisaient encore la queue pour voter.
Par exemple, dans le quartier d’Antímano à Caracas (une ville qui a voté à 75 % pour Chavez), un bureau de vote rapporte que bien que 75 % des inscrits aient déjà voté, 800 personnes étaient encore dans la file d’attente. D’une manière générale, la participation était 3 à 5 % supérieure dans les quartiers ouvriers où Chavez a obtenu la majorité des suffrages, par rapport aux quartiers où vit la classe moyenne aisée ou encore les quartiers bourgeois votants pour Capriles.
Avant même l’heure de clôture officielle du scrutin, l’opposition préparait déjà une campagne de déstabilisation basée sur la désinformation et la diffamation. Des rumeurs, délibérément propagées, à propos de sondages soi-disant sortis des urnes, donnaient à Capriles un avantage sur Chavez, allant même jusqu’à 10 points dans certains cas. Le but était de donner l’impression que Capriles était élu, semant ainsi le doute lors de la parution des résultats officiels affirmant la victoire de Chavez. Il est scandaleux que le journal espagnol de droite ABC ait publié un énorme titre sur son site web annonçant : « Capriles vainqueur selon les premiers sondages sortis des urnes ».
Cela n’est que la continuité de l’immense torrent de propagande de ces derniers mois. Le jour même du scrutin, le journal « libéral » El País en Espagne, le plus ardent dans son soutien à Capriles, a publié un éditorial avec pour titre : Plus qu’une élection - Les Vénézuéliens choisissent entre deux modèles sociaux antagonistes.
L’élection présidentielle est par la suite décrite comme un plébiscite pour « la continuation du régime autocratique du président [Chavez] (...), d’un modèle de gouvernement fondé sur le charisme personnel et la perversion de la démocratie ». Dans son édition du lundi 8 octobre (imprimée avant l’annonce des résultats), il continue dans la même veine : « deux projets politiques contraires sont opposés : l’hégémonie du caudillisme [1] populiste ou le retour de la démocratie libérale. Les sondages d’opinion les plus fiables montrent une égalité parfaite ».
L’élection présidentielle au Venezuela était en effet le choix entre deux modèles. Bien que la campagne de Chavez ait commencé sur une ligne très modérée (« Chavez est le cœur du Venezuela »), elle est vite devenue plus radicale avec un réel contenu de classe. Dans les dernières semaines, Chavez s’est concentré sur la dénonciation d’un document écrit par un certain nombre de conseillers économiques de la campagne de Capriles, révélant leur véritable plan. Le document consistait essentiellement en un plan d’austérité très sévère, comprenant des coupes dans les dépenses sociales, des attaques sur les retraites, des reculs dans le droit du travail, et ainsi de suite.
Chavez a correctement averti que la mise en œuvre d’un tel plan conduirait à une guerre civile (comme cela s’est produit en 1989, lorsque Carlos Andres Perez a appliqué le programme de coupes du FMI). Dans son énorme meeting de fin de campagne, qui a probablement attiré plus de deux millions de personnes, il a expliqué comment « en 1989 dans les rues de Caracas la révolution mondiale a commencé, et que maintenant elle atteint les rues de Grèce, d’Espagne, du Portugal et du reste du monde ».
Les médias capitalistes ont déformé ces propos et ont déclaré que Chavez agitait la menace d’une guerre civile s’il perdait l’élection. Mais les masses ont bien compris quel était l’enjeu. La récente vague de protestations en Grèce, au Portugal, mais surtout en Espagne a également joué un rôle dans la mobilisation des masses bolivariennes, des travailleurs, des paysans et des pauvres. Ils savaient que, au-delà de la rhétorique sur le « jeune candidat de centre gauche », Capriles représentait les mêmes attaques brutales sur les masses que Rajoy en Espagne. L’effet a même été multiplié, car au Venezuela, il y a eu des avancées concrètes grâce à la révolution : le niveau de vie de la majorité de la population a augmenté, l’accès aux soins n’est plus réservé aux riches, tout comme l’éducation et désormais le logement.
Le fait que Capriles dût cacher son véritable programme et se présenter comme un social-démocrate du type de Lula, est une indication du virage important vers la gauche qu’a emprunté l’ensemble de l’opinion publique vénézuélienne au cours de ces 14 dernières années de révolution bolivarienne. Sa seule chance était de tromper les électeurs en leur faisant croire qu’il était un partisan des programmes sociaux de la révolution. Mais le peuple n’est pas dupe.
Malgré toutes les critiques émanant des rangs bolivariens contre les bureaucrates et les opportunistes qui dominent dans les hautes sphères du mouvement – que ce soit chez les gouverneurs et leur administration ou les municipalités – les masses se sont mobilisées, encore une fois, face au risque que la contre-révolution l’emporte.
Chavez a gagné dans 21 des 23 Etats du pays, selon les chiffres du CNE. Il semble y avoir un différend à propos de qui l’emporte à Miranda, où Capriles était gouverneur. Les derniers chiffres officiels, avec 98,3 % des voix dépouillées, donnent une avance très courte à Chavez, de seulement 743 voix sur 1,5 million, ce qui voudrait dire que 49,76 % ont voté pour Chavez contre 49,71 % pour Capriles. Si cela devait se confirmer, cela signifierait que la révolution bolivarienne est en train de se relever dans les Etats importants qu’elle a perdus lors des élections à l’Assemblée nationale, à l’instar de Zulia, Carabobo et Anzoategui. L’opposition ne parvient pas à conserver les deux États andins de Tachira et de Mérida.
Chavez a reçu plus de 500 000 voix par rapport à 2006 et près de 1,5 million de plus que le PSUV n’en a obtenu aux élections législatives de 2010. Mais il convient également de noter que l’opposition a amassé plus de 2 millions de voix depuis 2006.
A l’annonce des résultats officiels par le Conseil National Electoral, le doute s’installa quant à l’attitude de l’opposition et de ce qu’elle allait faire. Durant tout ce temps, ils avaient prévu un « plan B ». Si les résultats avaient été serrés, ils auraient crié à la fraude, utilisant les sondages sortis des urnes pour semer la méfiance dans les résultats ; leurs militants seraient sortis dans les rues pour tenter d’engendrer le chaos et la violence, et donner l’impression que Chavez n’avait gagné qu’en catimini.
Les masses bolivariennes étaient mobilisées, attendant dans les rues et sur les places, prêtes à répondre à toutes provocations. Mais finalement, l’ampleur de la défaite était si grande que l’opposition a réalisé qu’elle n’avait aucune chance, et elle a dû reconnaître sa défaite. Le fait que Capriles accepte les résultats de l’élection ne représente pas une preuve de ses principes démocratiques. Au contraire, ce qu’il a compris, c’est que prendre le risque d’attaquer à ce moment précis était trop aventureux et aurait pu avoir comme résultat de provoquer l’effet inverse : il aurait radicalisé la révolution bolivarienne et mis le pouvoir et les privilèges de la classe dirigeante en danger de mort.
Les couches les plus intelligentes de la classe dirigeante ont compris tout au long de cette campagne qu’elles ne pouvaient pas gagner cette élection contre Chavez. Elles veulent maintenant capitaliser les 6 millions de voix qu’elles ont eues (leur plus haut résultat jamais obtenu) et espèrent que la maladie de Chavez l’empêche de terminer son mandat.
Elles ont également les yeux rivés sur les élections régionales de décembre. Elles savent très bien qu’il n’y a personne d’autre dans la direction bolivarienne qui n’ait le même niveau de soutien et d’autorité parmi les masses et qui puisse les mobiliser pour défendre Chavez et la révolution, que Chavez lui-même. Il ne sera pas si facile de défendre des gouverneurs « bolivariens » régionaux ou des candidats, qui dans de nombreux cas, sont considérés comme corrompus, arrivistes et étrangers à l’esprit authentique de la révolution.
Il s’agit d’une victoire exceptionnelle qui révèle l’instinct de classe et le haut développement du niveau politique des masses vénézuéliennes. La victoire elle-même, le fait d’avoir battu l’oligarchie réactionnaire une fois de plus, les remplit d’un sentiment d’enthousiasme. Sans doute, la bureaucratie « bolivarienne » et les réformistes vont maintenant dire que le pays est divisé en deux, que le président « doit se prononcer pour tous les Vénézuéliens », et vont essayer de transformer cette victoire en une défaite.
Les masses, comme en 2006, ont voté de manière claire pour le socialisme. En fait, l’un des axes centraux du programme de Chavez est précisément l’idée que la révolution doit être achevée. Dans son discours de victoire au « balcon du peuple » du palais de Miraflores, il l’a clairement déclaré : « Le Venezuela continuera sa marche vers le socialisme démocratique du 21e siècle ».
Le profond courant de mécontentement contre la bureaucratie et les réformistes au sein du mouvement bolivarien, qui a été maintenu sous contrôle pendant la campagne de peur de faire des vagues, va certainement maintenant remonter à la surface. Ce courant est représenté par des mouvements comme le Mouvement National pour le Contrôle et les Conseils Ouvriers, le Courant Bolivarien de Zamora (autour du Front paysan national d’Ezequiel et de Zamora), le Plan socialiste de Guayana, ainsi que d’autres.
Pour l’instant, le principal danger a été vaincu par les masses, mais une révolution ne peut pas rester indéfiniment à la croisée des chemins. Chavez a fait quelques incursions dans les droits de la propriété privée, mais l’économie vénézuélienne et l’appareil d’Etat restent fondamentalement capitalistes, et sont toujours dominés par les 100 familles de l’oligarchie, inextricablement liées à l’impérialisme étranger.
La seule manière de garantir sur le long terme les conquêtes de la révolution est d’exproprier les principaux leviers économiques et de les placer sous le contrôle des travailleurs, de sorte que les vastes ressources du pays puissent satisfaire les besoins de la majorité grâce à une planification démocratique de la production. Une telle décision signifierait l’abolition du capitalisme. Elle ferait face à la colère de la classe dirigeante à Caracas, Washington et Madrid, mais compterait aussi sur la sympathie de millions de travailleurs et de paysans en Amérique latine, mais aussi en Europe, qui subissent les conséquences de la crise du système capitaliste.
Les médias capitalistes ont raison sur un point : ce qui est en jeu au Venezuela, c’est la lutte entre deux systèmes sociaux opposés – d’une part le capitalisme (qui a prouvé sa faillite à des millions de personnes), et d’autre part le socialisme, c’est-à-dire la propriété collective des moyens de production et la planification démocratique de l’économie.
Il est temps d’aller de l’avant !
Socialisme ou barbarie !
Vive la révolution vénézuélienne !
Vive la révolution socialiste !
[1] De « caudillo », seigneur ou aventurier à la tête d’une armée personnelle dans l’Espagne féodale. Mot repris en Amérique latine à l’époque de l’indépendance (1811-1825) pour désigner ceux qui utilisaient leur clientèle pour conquérir le pouvoir, par la violence ou plus rarement par voie électorale, puis à nouveau en Espagne pour désigner le général Franco.
Sur plus de 95 % de votes dépouillés, 7 860 982 voix sont en faveur de Chavez, et 6 386 155 voix pour le candidat de l’oligarchie et de l’impérialisme. La participation a atteint le chiffre incroyable de 81 %, battant le précédent record des élections présidentielles de 2006, qui était de 74 %. Cela montre le caractère extrêmement polarisé de cette campagne, dans laquelle les deux camps ont mobilisé l’ensemble de leurs partisans.
L’un des principaux enjeux de ces élections était précisément le taux de participation, qui se devait d’être massif. La campagne en faveur de la révolution bolivarienne avait lancé un appel à la population en demandant aux gens de se lever tôt, et d’aller voter en masse. Le but était de parvenir à une participation si massive qu’elle préviendrait toute tentative de l’opposition réactionnaire de crier à la fraude.
Un camarade du Venezuela a raconté que certaines personnes ont commencé à faire la queue devant les bureaux de vote dès la veille des élections. À 3 heures du matin, dans les quartiers pauvres de la classe ouvrière de Caracas et à travers tout le pays, retentit l’appel des chavistes pour réveiller la population. Au moment où les bureaux de vote ont ouvert leurs portes à 6 heures du matin, il y avait déjà de longues files d’attente, et durant toute la journée les gens affluaient pour voter.
A 18 heures, les bureaux de vote étaient censés fermer. Mais les règles électorales vénézuéliennes précisent que le vote est un droit démocratique, et que tant qu’une personne présente attend de pouvoir l’exercer, les bureaux de vote doivent rester ouverts. Ce fut le cas ce jour-là, où certains bureaux de vote sont restés ouverts jusqu’à 20h30, soit deux heures et demie après l’heure prévue.
C’est à ce moment-là que l’opposition contre-révolutionnaire devint clairement nerveuse. Capriles demanda la fermeture de tous les bureaux de vote à 18h01. La raison était claire : dans les quartiers bourgeois de Caracas, les bureaux étaient déserts, tandis que dans les quartiers pauvres et ouvriers, des centaines de personnes faisaient encore la queue pour voter.
Par exemple, dans le quartier d’Antímano à Caracas (une ville qui a voté à 75 % pour Chavez), un bureau de vote rapporte que bien que 75 % des inscrits aient déjà voté, 800 personnes étaient encore dans la file d’attente. D’une manière générale, la participation était 3 à 5 % supérieure dans les quartiers ouvriers où Chavez a obtenu la majorité des suffrages, par rapport aux quartiers où vit la classe moyenne aisée ou encore les quartiers bourgeois votants pour Capriles.
Avant même l’heure de clôture officielle du scrutin, l’opposition préparait déjà une campagne de déstabilisation basée sur la désinformation et la diffamation. Des rumeurs, délibérément propagées, à propos de sondages soi-disant sortis des urnes, donnaient à Capriles un avantage sur Chavez, allant même jusqu’à 10 points dans certains cas. Le but était de donner l’impression que Capriles était élu, semant ainsi le doute lors de la parution des résultats officiels affirmant la victoire de Chavez. Il est scandaleux que le journal espagnol de droite ABC ait publié un énorme titre sur son site web annonçant : « Capriles vainqueur selon les premiers sondages sortis des urnes ».
Cela n’est que la continuité de l’immense torrent de propagande de ces derniers mois. Le jour même du scrutin, le journal « libéral » El País en Espagne, le plus ardent dans son soutien à Capriles, a publié un éditorial avec pour titre : Plus qu’une élection - Les Vénézuéliens choisissent entre deux modèles sociaux antagonistes.
L’élection présidentielle est par la suite décrite comme un plébiscite pour « la continuation du régime autocratique du président [Chavez] (...), d’un modèle de gouvernement fondé sur le charisme personnel et la perversion de la démocratie ». Dans son édition du lundi 8 octobre (imprimée avant l’annonce des résultats), il continue dans la même veine : « deux projets politiques contraires sont opposés : l’hégémonie du caudillisme [1] populiste ou le retour de la démocratie libérale. Les sondages d’opinion les plus fiables montrent une égalité parfaite ».
L’élection présidentielle au Venezuela était en effet le choix entre deux modèles. Bien que la campagne de Chavez ait commencé sur une ligne très modérée (« Chavez est le cœur du Venezuela »), elle est vite devenue plus radicale avec un réel contenu de classe. Dans les dernières semaines, Chavez s’est concentré sur la dénonciation d’un document écrit par un certain nombre de conseillers économiques de la campagne de Capriles, révélant leur véritable plan. Le document consistait essentiellement en un plan d’austérité très sévère, comprenant des coupes dans les dépenses sociales, des attaques sur les retraites, des reculs dans le droit du travail, et ainsi de suite.
Chavez a correctement averti que la mise en œuvre d’un tel plan conduirait à une guerre civile (comme cela s’est produit en 1989, lorsque Carlos Andres Perez a appliqué le programme de coupes du FMI). Dans son énorme meeting de fin de campagne, qui a probablement attiré plus de deux millions de personnes, il a expliqué comment « en 1989 dans les rues de Caracas la révolution mondiale a commencé, et que maintenant elle atteint les rues de Grèce, d’Espagne, du Portugal et du reste du monde ».
Les médias capitalistes ont déformé ces propos et ont déclaré que Chavez agitait la menace d’une guerre civile s’il perdait l’élection. Mais les masses ont bien compris quel était l’enjeu. La récente vague de protestations en Grèce, au Portugal, mais surtout en Espagne a également joué un rôle dans la mobilisation des masses bolivariennes, des travailleurs, des paysans et des pauvres. Ils savaient que, au-delà de la rhétorique sur le « jeune candidat de centre gauche », Capriles représentait les mêmes attaques brutales sur les masses que Rajoy en Espagne. L’effet a même été multiplié, car au Venezuela, il y a eu des avancées concrètes grâce à la révolution : le niveau de vie de la majorité de la population a augmenté, l’accès aux soins n’est plus réservé aux riches, tout comme l’éducation et désormais le logement.
Le fait que Capriles dût cacher son véritable programme et se présenter comme un social-démocrate du type de Lula, est une indication du virage important vers la gauche qu’a emprunté l’ensemble de l’opinion publique vénézuélienne au cours de ces 14 dernières années de révolution bolivarienne. Sa seule chance était de tromper les électeurs en leur faisant croire qu’il était un partisan des programmes sociaux de la révolution. Mais le peuple n’est pas dupe.
Malgré toutes les critiques émanant des rangs bolivariens contre les bureaucrates et les opportunistes qui dominent dans les hautes sphères du mouvement – que ce soit chez les gouverneurs et leur administration ou les municipalités – les masses se sont mobilisées, encore une fois, face au risque que la contre-révolution l’emporte.
Chavez a gagné dans 21 des 23 Etats du pays, selon les chiffres du CNE. Il semble y avoir un différend à propos de qui l’emporte à Miranda, où Capriles était gouverneur. Les derniers chiffres officiels, avec 98,3 % des voix dépouillées, donnent une avance très courte à Chavez, de seulement 743 voix sur 1,5 million, ce qui voudrait dire que 49,76 % ont voté pour Chavez contre 49,71 % pour Capriles. Si cela devait se confirmer, cela signifierait que la révolution bolivarienne est en train de se relever dans les Etats importants qu’elle a perdus lors des élections à l’Assemblée nationale, à l’instar de Zulia, Carabobo et Anzoategui. L’opposition ne parvient pas à conserver les deux États andins de Tachira et de Mérida.
Chavez a reçu plus de 500 000 voix par rapport à 2006 et près de 1,5 million de plus que le PSUV n’en a obtenu aux élections législatives de 2010. Mais il convient également de noter que l’opposition a amassé plus de 2 millions de voix depuis 2006.
A l’annonce des résultats officiels par le Conseil National Electoral, le doute s’installa quant à l’attitude de l’opposition et de ce qu’elle allait faire. Durant tout ce temps, ils avaient prévu un « plan B ». Si les résultats avaient été serrés, ils auraient crié à la fraude, utilisant les sondages sortis des urnes pour semer la méfiance dans les résultats ; leurs militants seraient sortis dans les rues pour tenter d’engendrer le chaos et la violence, et donner l’impression que Chavez n’avait gagné qu’en catimini.
Les masses bolivariennes étaient mobilisées, attendant dans les rues et sur les places, prêtes à répondre à toutes provocations. Mais finalement, l’ampleur de la défaite était si grande que l’opposition a réalisé qu’elle n’avait aucune chance, et elle a dû reconnaître sa défaite. Le fait que Capriles accepte les résultats de l’élection ne représente pas une preuve de ses principes démocratiques. Au contraire, ce qu’il a compris, c’est que prendre le risque d’attaquer à ce moment précis était trop aventureux et aurait pu avoir comme résultat de provoquer l’effet inverse : il aurait radicalisé la révolution bolivarienne et mis le pouvoir et les privilèges de la classe dirigeante en danger de mort.
Les couches les plus intelligentes de la classe dirigeante ont compris tout au long de cette campagne qu’elles ne pouvaient pas gagner cette élection contre Chavez. Elles veulent maintenant capitaliser les 6 millions de voix qu’elles ont eues (leur plus haut résultat jamais obtenu) et espèrent que la maladie de Chavez l’empêche de terminer son mandat.
Elles ont également les yeux rivés sur les élections régionales de décembre. Elles savent très bien qu’il n’y a personne d’autre dans la direction bolivarienne qui n’ait le même niveau de soutien et d’autorité parmi les masses et qui puisse les mobiliser pour défendre Chavez et la révolution, que Chavez lui-même. Il ne sera pas si facile de défendre des gouverneurs « bolivariens » régionaux ou des candidats, qui dans de nombreux cas, sont considérés comme corrompus, arrivistes et étrangers à l’esprit authentique de la révolution.
Il s’agit d’une victoire exceptionnelle qui révèle l’instinct de classe et le haut développement du niveau politique des masses vénézuéliennes. La victoire elle-même, le fait d’avoir battu l’oligarchie réactionnaire une fois de plus, les remplit d’un sentiment d’enthousiasme. Sans doute, la bureaucratie « bolivarienne » et les réformistes vont maintenant dire que le pays est divisé en deux, que le président « doit se prononcer pour tous les Vénézuéliens », et vont essayer de transformer cette victoire en une défaite.
Les masses, comme en 2006, ont voté de manière claire pour le socialisme. En fait, l’un des axes centraux du programme de Chavez est précisément l’idée que la révolution doit être achevée. Dans son discours de victoire au « balcon du peuple » du palais de Miraflores, il l’a clairement déclaré : « Le Venezuela continuera sa marche vers le socialisme démocratique du 21e siècle ».
Le profond courant de mécontentement contre la bureaucratie et les réformistes au sein du mouvement bolivarien, qui a été maintenu sous contrôle pendant la campagne de peur de faire des vagues, va certainement maintenant remonter à la surface. Ce courant est représenté par des mouvements comme le Mouvement National pour le Contrôle et les Conseils Ouvriers, le Courant Bolivarien de Zamora (autour du Front paysan national d’Ezequiel et de Zamora), le Plan socialiste de Guayana, ainsi que d’autres.
Pour l’instant, le principal danger a été vaincu par les masses, mais une révolution ne peut pas rester indéfiniment à la croisée des chemins. Chavez a fait quelques incursions dans les droits de la propriété privée, mais l’économie vénézuélienne et l’appareil d’Etat restent fondamentalement capitalistes, et sont toujours dominés par les 100 familles de l’oligarchie, inextricablement liées à l’impérialisme étranger.
La seule manière de garantir sur le long terme les conquêtes de la révolution est d’exproprier les principaux leviers économiques et de les placer sous le contrôle des travailleurs, de sorte que les vastes ressources du pays puissent satisfaire les besoins de la majorité grâce à une planification démocratique de la production. Une telle décision signifierait l’abolition du capitalisme. Elle ferait face à la colère de la classe dirigeante à Caracas, Washington et Madrid, mais compterait aussi sur la sympathie de millions de travailleurs et de paysans en Amérique latine, mais aussi en Europe, qui subissent les conséquences de la crise du système capitaliste.
Les médias capitalistes ont raison sur un point : ce qui est en jeu au Venezuela, c’est la lutte entre deux systèmes sociaux opposés – d’une part le capitalisme (qui a prouvé sa faillite à des millions de personnes), et d’autre part le socialisme, c’est-à-dire la propriété collective des moyens de production et la planification démocratique de l’économie.
Il est temps d’aller de l’avant !
Socialisme ou barbarie !
Vive la révolution vénézuélienne !
Vive la révolution socialiste !
[1] De « caudillo », seigneur ou aventurier à la tête d’une armée personnelle dans l’Espagne féodale. Mot repris en Amérique latine à l’époque de l’indépendance (1811-1825) pour désigner ceux qui utilisaient leur clientèle pour conquérir le pouvoir, par la violence ou plus rarement par voie électorale, puis à nouveau en Espagne pour désigner le général Franco.