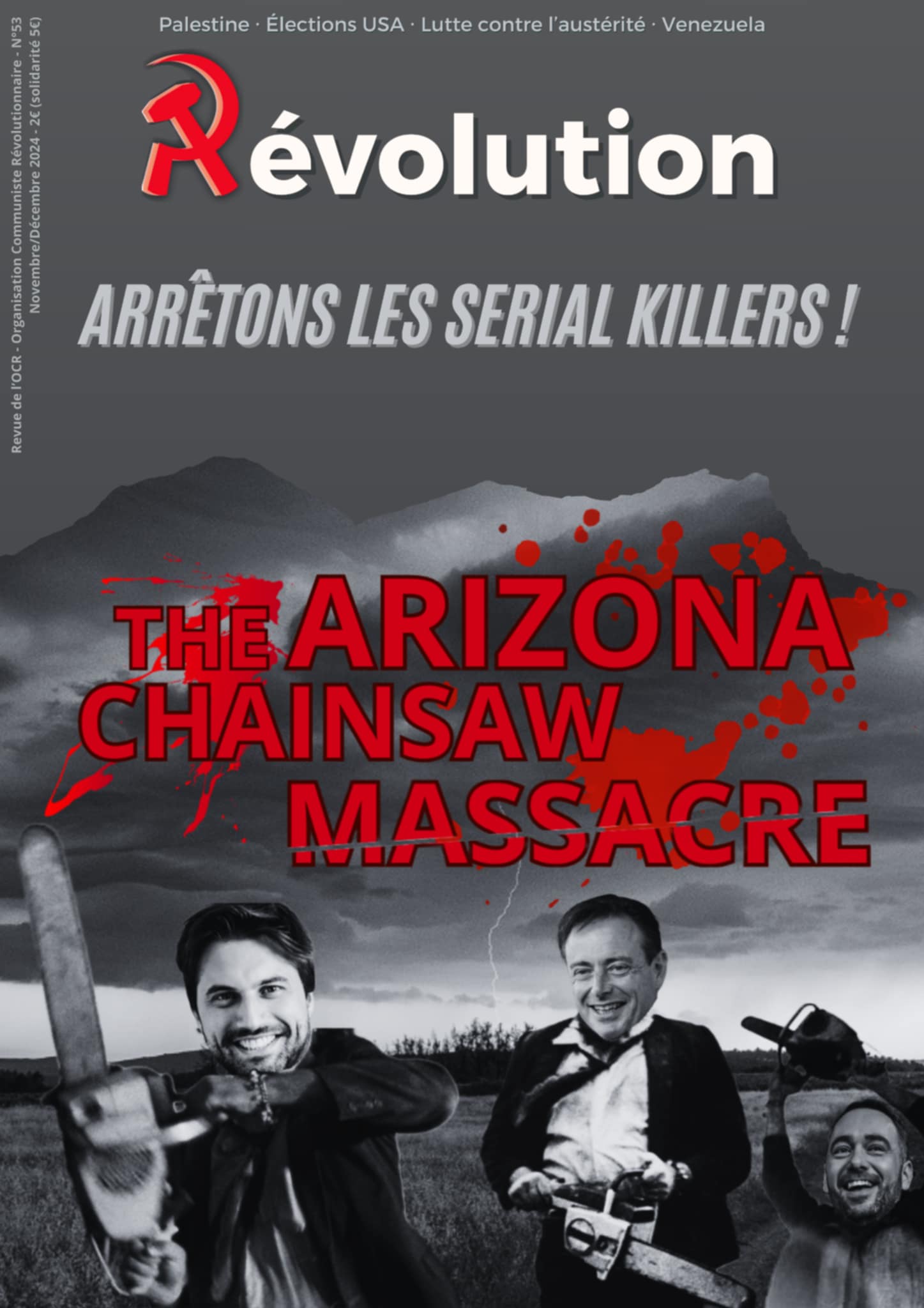L'Amérique Latine.
Les économies d’un certain nombre de pays d’Amérique du Sud (dont le Brésil, le Chili, le Pérou, la Bolivie, l’Equateur et la Colombie), qui tiraient profit de leurs exportations de matières premières, de marchandises et de sources d’énergie vers la Chine, souffrent des répercussions du ralentissement de l’économie chinoise. Dans la prochaine période, les conséquences politiques et sociales en seront profondes, comme nous avons déjà pu le voir avec les grands mouvements sociaux contre la hausse des prix des tickets de transport au Brésil.
Après une période d’intensification de la lutte de classe dans toute l’Amérique latine (notamment au Venezuela, en Bolivie et en Equateur), avec le renversement de gouvernements de droite par des soulèvements de masse, l’élection de présidents qui ont pris des mesures contraires aux intérêts impérialistes, des soulèvements régionaux, etc., la vague révolutionnaire sur ce continent semblait marquer une pause. Il y a une sorte d’impasse dans la lutte des classes : aucune des parties n’a été en mesure de remporter une victoire décisive.
Des tentatives de coup d’Etat ont été vaincues par les masses au Venezuela (à plusieurs occasions), en Equateur et en Bolivie. Les forces de la réaction et l’impérialisme n’ont pas été capables d’infliger une défaite décisive à chacun de ces mouvements, à l’exception des coups d’Etat au Paraguay et au Honduras, qui néanmoins n’ont pas mis fin au mouvement révolutionnaire dans ces pays.
En Colombie, le début des négociations de paix entre le gouvernement et les FARC – qui montrent l’incapacité de la guérilla à gagner la guerre – a ouvert la voie au développement de la lutte des classes selon des lignes classiques. Le nouveau président Santos a connu une chute de popularité (de 46 % à 21 % entre juin et août 2013) après une série de grèves dans la production de café, chez les salariés du système judiciaire et les étudiants. Plus récemment, la grève agraire nationale a envoyé le gouvernement dans les cordes. La classe dirigeante colombienne a tenté de « normaliser » ses méthodes de gouvernement (après s’être appuyé sur les paramilitaires sous Uribe). Mais cela s’est retourné contre elle en provoquant une vague de luttes.
Avec le retour au pouvoir du PRI, la classe dirigeante mexicaine a réussi à s’appuyer sur un gouvernement relativement fort, ce qui lui a permis de mener à bien les mesures prévues depuis des années. Même avant que Peña Nieto prête serment, ils avaient déjà approuvé la réforme du travail. Celle-ci a éliminé une série de conquêtes gagnées à l’époque de la révolution mexicaine. Cela faciliter l’exploitation de la classe ouvrière.
Une autre étape clé a été la contre-réforme de l’énergie, qui ouvre la porte aux compagnies multinationales pour investir dans les secteurs de l’énergie et du pétrole. La nationalisation du pétrole par le gouvernement de Lazaro Cardenas, en 1938, signifiait que pendant des décennies le Mexique avait une relative stabilité économique et sociale. C’est terminé. Avant la réforme de l’énergie, la compagnie pétrolière Pemex contribuait au budget de l’Etat à hauteur de 40 %. Désormais, une grande partie de ces ressources seront détournées dans les poches de capitalistes privés. Cela conduira à un déficit budgétaire qui sera combattu par des augmentations d’impôts et des coupes dans les dépenses sociales.
Le déclin du capitalisme mexicain est marqué par l’augmentation du chômage et de la misère, le développement de l’économie informelle et l’aggravation de la décomposition sociale. Ceci est très clairement exprimé dans le développement du trafic de drogue et la guerre qui en résulte – et frappe les masses de plein fouet. Les contre-réformes du gouvernement marquent un tournant. Elles vont conduire à une aggravation des conditions de vie du peuple mexicain, dans les années à venir.
Les directions des syndicats et de Morena, avec leur vision électorale réformiste, ont agi comme un frein qui a empêché une riposte unie fondée sur les méthodes de l’action révolutionnaire de masse. Cependant, il y a une ambiance de colère grandissante. Cela s’est traduit par la formation de Morena, par des luttes syndicales militantes – comme celles des enseignants et des travailleurs de l’électricité –, par l’entrée dans le mouvement d’une nouvelle génération de jeunes radicalisés et par le développement de nombreux groupes d’auto-défense et de polices communautaires.
Dans l’Etat de Guerrero, il y a eu des mobilisations de masse armées, et dans le Michoacan, des municipalités sont dans un état de guerre civile. Bien que ce processus soit plein de contradictions, ce sont les symptômes de l’énorme pression que le capitalisme mexicain en décomposition exerce sur les masses – qui commencent à tirer des conclusions révolutionnaires. Le gouvernement de Peña Nieto va poursuivre sa politique d’attaques et de contre-réformes, qui préparent une vaste riposte des travailleurs.
Toutefois, en raison de l’absence du facteur subjectif – une direction révolutionnaire claire –, les masses d’Amérique latine n’ont pas pu prendre le pouvoir entre leurs mains et renverser le capitalisme. Cela a conduit à une impasse et à un équilibre temporaire et instable entre les classes, une situation qui a perduré grâce au boom économique. La récession mondiale qui a commencé en 2007-2008 a seulement partiellement affecté l’Amérique du Sud, qui a rebondi grâce à ses exportations en Chine, affamée de ressources et matières premières. Mais cela touche maintenant à sa fin. On peut le voir de façon très frappante à travers les événements au Brésil.
Le Brésil
Au cours de la dernière période (jusqu’en 2011), le Brésil a bénéficié de taux de croissance élevés, principalement en raison de ses exportations vers la Chine. Cela a permis aux capitalistes de concéder augmentations de salaires pour faire face à des pénuries de main-d’œuvre ou des grèves. Les salaires en reals ont augmenté en moyenne de 3,5 % entre 2002 et 2013. Mais l’augmentation en dollars a été encore plus élevée (le real était surévalué). 95 % des négociations salariales ont donné lieu à des augmentations plus élevées que l’inflation.
Mais tout ceci est terminé. Le fort ralentissement de l’économie en 2011 (+2,7 %) et 2012 (+0,9 %) a soudainement fait surgir une frustration généralisée, qui a culminé dans le mouvement de masse de juin 2013. Les niveaux relativement faibles de l’investissement par les capitalistes signifient que la hausse des salaires n’a pas été compensée par une augmentation de la productivité. Depuis 2003, le coût du travail au Brésil a doublé ; en dollars, il a même triplé.
Les faibles niveaux d’investissement ont entraîné une forte baisse de la productivité par rapport aux autres grandes économies. Le boom des exportations vers la Chine a masqué pendant un temps la position catastrophique du Brésil. Dans un dossier consacré au Brésil, en septembre dernier, The Economist souligne que ce pays se dirige vers une période de crise et d’intensification de la lutte des classes. L’inflation, qui approche les 6 %, fait baisser le niveau de vie des masses et stimule les revendications économiques de la classe ouvrière. Ce fait explique la volonté d’une partie de la bourgeoisie brésilienne de se débarrasser du PT. Ils ne font pas confiance au PT pour mener les attaques nécessaires. Une autre partie de la bourgeoisie est terrifiée à l’idée d’affronter une amplification de lutte des classes sans l’aide des dirigeants réformistes du PT.
Le mouvement contre l’augmentation du prix des transports en commun, qui s’est propagé rapidement à l’ensemble du pays, reflétait le mécontentement général qui s’était accumulé dans la société. Il représente l’arrivée au Brésil de la vague révolutionnaire des pays arabes et de l’Europe du Sud. Bien que le mouvement fût sans direction et comprenait inévitablement de nombreux éléments confus, il a représenté un tournant important. Il a été suivi par une série de journées d’action nationales du mouvement syndical et par une grande mobilisation autour de la grève des enseignants. Dilma Roussef ne bénéficiera certainement pas de la longue période d’expansion économique qui avait garanti la stabilité du gouvernement de Lula. Cela va créer des conditions exceptionnelles pour les marxistes brésiliens, dans la prochaine période.
Le Venezuela
Au Venezuela, la courte victoire de Maduro aux élections présidentielles d’avril 2013, après la mort de Chavez, fut un sérieux avertissement pour le mouvement bolivarien. Toutefois, la tentative de l’oligarchie d’utiliser le résultat serré pour renverser Maduro s’est retournée contre elle. Une fois de plus, les masses sont sorties dans les rues et ont balayé les provocations de la droite par une mobilisation révolutionnaire.
Désormais, le facteur clé est l’érosion de la base sociale de soutien à la révolution, du fait de la détérioration générale de l’économie. Celle-ci découle de la tentative du gouvernement de réguler l’économie capitaliste, du sabotage délibéré de la classe dirigeante et de la grève d’investissement de la part des capitalistes. La rareté des produits de base se combine à une inflation galopante qui atteint désormais 50 %. Cette situation ne peut pas durer très longtemps. Soit la révolution prend des mesures décisives contre le système capitaliste, soit le chaos économique créera les conditions d’un retour au pouvoir de la bourgeoisie, qui tentera d’écraser la révolution.
Après son élection, le gouvernement Maduro a attaqué l’opposition sur le terrain politique, tout en cherchant un accord avec les capitalistes sur le terrain économique. Des concessions ont été proposées au secteur privé en matière d’accès aux devises fortes et de la libéralisation du contrôle des prix. L’idée de créer des « zones économiques spéciales », comme la Chine, a été avancée. C’était une politique utopique, qui ne pouvait résoudre quoi que ce soit. Toute concession faite à la classe dirigeante ne fera que saper la base sociale de la révolution, sans résoudre un seul des problèmes économiques fondamentaux.
Lors de la campagne des municipales de décembre 2013, le gouvernement a changé de cap, portant des coups aux capitalistes. Cela ne sortait pas de la logique de réguler le capitalisme, mais ces attaques ont été très populaires auprès de la classe ouvrière. Elles ont permis de raviver l’enthousiasme révolutionnaire de la base. Ce sont les mesures contre la spéculation et les prix trop élevés qui ont garanti la victoire aux élections municipales.
Même si l’oligarchie réussissait à revenir au pouvoir, ce ne serait pas pour autant la fin de la révolution. Cela pourrait avoir comme effet salutaire de radicaliser le mouvement bolivarien, comme lors les « deux années noires » de la révolution espagnole (à partir d’octobre 1934), qui ne furent que le prélude d’une bataille décisive entre les classes. Aucun dirigeant du mouvement bolivarien n’a l’autorité de Chavez. Par conséquent, les masses critiquent beaucoup plus ouvertement et sévèrement la direction, les bureaucrates et les réformistes.
La tâche principale reste la construction d’une direction révolutionnaire ayant des racines dans l’avant-garde de la classe ouvrière, d’une direction capable d’orienter l’extraordinaire énergie révolutionnaire des masses vers la conquête du pouvoir et l’abolition du capitalisme.
Les relations internationales
Lénine a parlé une fois de « matériaux combustibles dans la politique mondiale ». Il y a quantité de ces matériaux combustibles, aujourd’hui. Les actions agressives des puissances impérialistes peuvent donner lieu à une opposition interne et agir comme un facteur supplémentaire de radicalisation. L’humeur révolutionnaire peut découler non seulement de facteurs économiques, mais aussi de guerres, d’actes terroristes, de catastrophes naturelles ou d’événements sur la scène mondiale. Nous l’avons déjà vu par le passé avec la guerre du Vietnam ; la même chose peut se reproduire.
Les révélations de Wikileaks et de Snowden ont dévoilé les véritables motivations, opinions et intérêts de l’impérialisme américain, faisant tomber le masque de la diplomatie pour révéler l’horrible visage de l’égoïsme et du cynisme. Cela a également révélé l’incapacité des Etats-Unis à protéger les secrets des autres régimes. L’espionnage de ses propres alliés par les Etats-Unis est désormais public. La véritable nature de la diplomatie bourgeoise est enfin révélée à l’opinion publique mondiale. Ces révélations ont rendu un service important à la classe ouvrière internationale.
La chute de l’URSS, il y a 20 ans, a conduit à un changement majeur dans les relations internationales. Les Etats-Unis sont devenus la seule superpuissance mondiale. Or, du pouvoir colossal découle une colossale arrogance, comme l’a montré la « Doctrine de Bush ». L’impérialisme américain proclama son droit d’intervenir dans n’importe quel pays, de destituer des gouvernements et de dicter sa volonté partout. Mais vingt ans plus tard, cette folie des grandeurs a du plomb dans l’aile.
L’émergence de la Chine comme puissance économique et militaire a fondamentalement modifié le rapport de forces en Asie et dans le Pacifique. L’élite dirigeante chinoise a l’ambition d’affirmer son rôle politique et militaire, conformément à l’accroissement de son pouvoir économique. En conséquence, elle entre de plus en plus en conflit avec d’autres pays de cette région importante, à commencer par le Japon. Le conflit entre la Chine et le Japon sur certaines îles en est une manifestation. Washington observe ce phénomène avec une inquiétude grandissante. L’impérialisme américain a toujours considéré le Pacifique comme un élément central dans sa stratégie globale. L’émergence de la Chine présente donc une menace directe contre ses intérêts, ce qui peut conduire à l’avenir à de sérieux conflits.
La Russie joue un rôle plus indépendant dans les relations internationales que par le passé. Après avoir subi une humiliation en Yougoslavie et en Irak (deux anciennes zones d’influence russes), la Russie n’est plus disposée à accepter les prétentions de l’impérialisme américain à l’échelle mondiale. On a pu le voir lors de son intervention en Géorgie, que les Etats-Unis tentaient de l’attirer dans leur orbite. La Russie a utilisé sa puissance militaire, en 2008, pour faire plier la Géorgie et l’empêcher de rejoindre l’OTAN. En Syrie, Moscou a tracé une autre ligne rouge que les Américains n’ont pas osé franchir.
Néanmoins, ce n’est pas grâce à la force de la Russie que les Etats-Unis reculent, mais surtout à cause de la paralysie et de relative faiblesse de l’impérialisme américain. Au cours des 10 dernières années, les impérialistes américains se sont comportés comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. En conséquence, ils n’ont presque plus d’alliés fiables. L’invasion de l’Irak a été un désastre. L’intention de Bush était de montrer la puissance de l’Amérique. Mais cette aventure a mal tourné, déstabilisant encore plus la région, qui était déjà très instable. En détruisant l’armée irakienne, il a semé le chaos et a renforcé le pouvoir à l’Iran dans la région.
Tout cela a provoqué un changement radical dans l’opinion publique aux Etats-Unis. Après les échecs manifestes en Irak et en Afghanistan, le peuple américain est fatigué par les aventures militaires à l’étranger. Une ambiance rappelant l’ancien isolationnisme américain commence à refaire surface au Congrès et dans la population. En conséquence, Obama n’a pas pu donner suite à son intention déclarée de bombarder la Syrie. Dans un discours pathétique où il se contredisait à chaque phrase, il a dit que les Etats-Unis ne pouvaient plus faire ce qu’ils voulaient dans le monde.
Le Moyen-Orient est désormais archi-instable. La politique grossière et à courte vue de l’impérialisme américain a exacerbé le phénomène. Le développement de l’influence iranienne dans la région a dérouté l’Arabie Saoudite. Riyad a dû se résigner à l’idée que Téhéran a maintenant une influence prépondérante sur de grandes parties de l’Irak. Le chaos en Irak a donné lieu à un conflit sanglant entre sunnites et chiites (attentats et massacres terroristes quotidiens). En Arabie Saoudite, la famille royale craint que le pouvoir leur échappe. Ces craintes ont été renforcées par le soulèvement de masse au Bahreïn en 2011.
Au Moyen-Orient, nous voyons les limites de la puissance américaine. L’impuissance manifeste de l’impérialisme américain a permis à ses alliés du Moyen-Orient de suivre d’abord leurs propres intérêts, dans une mesure beaucoup plus importante que par le passé. Dans plusieurs cas, cela a conduit à un conflit d’intérêts et à une attitude ouvertement défiante envers les Etats-Unis. On l’a vu avec la promesse des Saoudiens de compenser n’importe quelle baisse de l’aide financière américaine à l’armée égyptienne. Les Saoudiens ont été contrariés par la chute de Moubarak en Egypte, qui était un allié fiable. Washington a offensé les forces armées égyptiennes en réduisant l’aide militaire, après le renversement de Morsi.
La clique dirigeante qatarie a versé 8 milliards de dollars à l’Egypte. Elle a été le principal bailleur de fonds du gouvernement Morsi dans le Golfe. Ils pariaient que le vide laissé par les autocraties arabes serait comblé par les islamistes, et ils espéraient les exploiter afin de renforcer la position du Qatar dans la région.
Le Qatar s’est brûlé les doigts en Libye, puis en Syrie, et a également perdu des milliards de dollars en Egypte. Cet argent devait servir à prendre un avantage politique, mais ils ont parié sur le mauvais cheval. Les Emirats Arabes Unis et les Saoudiens interviendront pour garder l’économie égyptienne à flot. Tout cela ressemble aux guerres entre « familles » mafieuses rivales. Et c’est bien ce que sont toutes ces familles royales : des mafieux du pétrole.
La Syrie
Ce qui avait commencé comme un soulèvement populaire contre le régime baasiste, en Syrie, a dégénéré en une guerre civile sectaire. Les cliques dirigeantes saoudienne et qatarie sont intervenues pour écraser les éléments révolutionnaires et détourner la lutte sur la voie du sectarisme religieux.
Washington voulait se baser sur les éléments bourgeois « démocratiques » de la soi-disant Armée Syrienne Libre (ASL), mais son plan a été complètement déjoué par les Saoudiens et les Qataris, qui ont armé et apporté leur soutien aux milices djihadistes. Cependant, les Saoudiens et les Qataris soutiennent des tendances différentes parmi les milices syriennes. Les Saoudiens penchent en faveur des éléments salafistes pour tenter de saper la prédominance, sur le terrain, de Jabhat al-Nusra et d’Al-Qaïda.
Basée en Turquie, la Coalition Nationale (CN) a été fondée en novembre 2012 et est reconnue par plus d’une centaine de pays comme la représentation « légitime » de l’opposition syrienne. Les Etats-Unis et l’UE voudraient s’appuyer sur les éléments bourgeois « modérés » de l’opposition. Mais ils font face à un problème insurmontable. La CN a été publiquement rejetée par 11 milices islamistes – dont certaines font officiellement partie de l’ASL. Ces milices ont déclaré qu’elles refusaient de reconnaître la CN.
Il est bien connu que la plupart des combats sont menés par des milices djihadistes et qu’elles ne sont pas prêtes à se soumettre à la CN. En conséquence, il y a une violente hostilité entre les différents groupes de l’opposition, qui se fractionne. Tirant profit de la faiblesse du pouvoir central, les Kurdes sont aujourd’hui virtuellement indépendants au Nord-Est, ce qui signifie qu’il existe désormais deux Etats kurdes plus ou moins indépendants dans la région. Cela rajoute à l’instabilité de la région et encourage les aspirations séparatistes des Kurdes en Turquie et en Iran.
Les éléments réactionnaires islamistes ont désormais le contrôle total de la rébellion armée. Il y a un conflit ouvert entre les djihadistes et l’ASL – et entre les djihadistes et les Kurdes. De plus, un certain nombre de milices se battant aux côtés du gouvernement échappent au contrôle d’Assad. La Syrie prend la même direction catastrophique que l’Irak ou l’Afghanistan, avec des chefs qui s’emparent localement du pouvoir. Le pays se désintègre sous nos yeux. En Syrie, désormais, les deux côtés sont contre-révolutionnaires.
Les deux camps se sont affrontés jusqu’à parvenir à une impasse. Mais l’intervention du Hezbollah et des Iraniens, en été 2013, a changé le rapport de forces en faveur du gouvernement. Les Américains cherchaient une excuse pour intervenir en Syrie pour corriger la situation. Mais la faiblesse de l’impérialisme américain s’est illustrée lorsqu’Obama n’a pas été en mesure d’obtenir un vote du Congrès pour bombarder la Syrie. Par conséquent, ses plans ont été complètement déjoués par les Russes, qui ont pris l’initiative diplomatique en s’appuyant sur une remarque à l’improviste de John Kerry, selon laquelle la Syrie pouvait éviter une attaque à condition de renoncer à ses armes chimiques.
La question des armes chimiques illustre l’écœurante hypocrisie des impérialistes. Les Etats-Unis détiennent les stocks d’armes chimiques les plus importants au monde. Ils y ont eu ont largement recours au Vietnam (« agent orange » et napalm). Plus récemment, ils ont utilisé des bombes au phosphore blanc lors du bombardement de Falloujah, avec des conséquences terribles pour la population. Pendant la guerre entre l’Iran et l’Irak, ils n’avaient aucune objection à ce que Saddam Hussein utilise des armes chimiques contre les soldats iraniens.
Il est évident que la question des armes chimiques a été conçue comme un prétexte pour attaquer la Syrie. Les forces gouvernementales, aidées par l’Iran et le Hezbollah, infligeaient de lourdes défaites aux rebelles. L’intention de Washington était d’aider les rebelles en frappant les forces armées syriennes. Le but n’était pas de permettre aux rebelles de remporter la victoire, mais de restaurer un certain équilibre entre les deux camps, afin d’ouvrir un espace pour des manœuvres diplomatiques. Les intérêts du peuple syrien – et les considérations humanitaires – étaient bien loin des préoccupations des impérialistes.
Cette manœuvre a été empêchée par l’offre du régime syrien (soufflée par Moscou) de remettre l’intégralité de son arsenal chimique. Cela n’avait aucune conséquence concrète sur les capacités militaires du régime syrien, qui utilisait des armes classiques très efficaces. Après avoir ainsi neutralisé les Américains sur la question des armes chimiques, Assad a lancé une offensive majeure contre les rebelles, leur infligeant de lourdes pertes. Cependant, il est difficile de dire si l’un des deux camps a assez de force pour remporter une victoire militaire décisive.
Les Russes et les Américains manœuvrent avec les puissances en place, dans la région, afin d’organiser une sorte de « conférence de paix » à Genève. Mais même si cette conférence parvient à se tenir, ce qui en ressortira ne servira certainement pas les intérêts du peuple syrien. Les Saoudiens et les Qataris soutiennent les forces de la réaction djihadiste. Les Américains veulent contrôler la région et faire obstacle à l’influence iranienne croissante. Les Russes veulent conserver leur mainmise sur la Syrie, leur allié traditionnel. Jusqu’à présent, les Russes ont soutenu Assad, mais ils seraient disposés à le sacrifier, à condition que leurs intérêts en Syrie soient protégés. Après la débâcle en Irak, les Américains et les Russes – et leurs alliés européens « démocratiques » – sont d’accord sur un point : l’Etat syrien doit être maintenu, dans l’intérêt de « la loi » et de « l’ordre ».
L’impasse militaire est l’occasion, pour les puissances extérieures, d’intensifier leur recherche d’une « solution négociée ». Le dégel partiel des relations entre Washington et Téhéran pourrait ouvrir la voie à la participation de l’Iran à la conférence de paix de Genève. Damas et Téhéran ont accueilli cette perspective avec jubilation, mais cela a rendu furieux Israël et l’Arabie Saoudite.
Ce que le peuple syrien pense de tout ça n’est pas connu. On ne l’a pas invité à Genève, et aucune puissance impliquée ne s’intéresse à son opinion. La seule issue dans ce bourbier en Syrie est la victoire de la révolution socialiste dans un pays clé de la région, ce qui modifierait radicalement l’équilibre des forces entre les classes. Le futur de la Syrie dépend désormais des événements se déroulant au-delà de ses frontières, c’est-à-dire des développements révolutionnaires en Turquie, en Iran et surtout en Egypte.
La révolution égyptienne
La magnifique révolution arabe, qui n’est pas encore terminée, a déchainé le pouvoir des millions de personnes, ce que la presse bourgeoise appelle « la rue arabe ». Ce fut un tournant de l’histoire mondiale. Les événements au Moyen-Orient auront de profonds effets tant sur le plan économique que politique. L’Egypte est un pays clé dans le monde arabe. Ce qui s’y passe a toujours des répercussions dans le monde arabe et dans toute la région. Avec le soulèvement de masse qui a renversé Morsi et les Frères Musulmans, la révolution est entrée dans une nouvelle étape.
Le mouvement révolutionnaire des masses qui a renversé Morsi a fait sortir 17 millions de personnes dans les rues d’Egypte. Il n’y a aucun précédent historique d’un mouvement d’une telle ampleur. Le pouvoir était entre les mains des masses en juin 2013, mais elles n’en avaient pas conscience et personne n’était là pour le leur expliquer. Le problème central est simple : les masses étaient assez puissantes pour renverser le gouvernement, mais insuffisamment organisées et conscientes pour prendre le pouvoir, qu’elles avaient déjà entre leurs mains. En conséquence, elles ont manqué cette opportunité et les généraux de l’armée ont pu intervenir pour combler le vide.
Les agissements de l’armée furent à peu près analogues à ceux de Napoléon lors des événements du 5 octobre 1795, quand il dispersa les foules royalistes dans les rues de Paris avec une « volée de mitraille ». Ensuite, comme aujourd’hui, les réactionnaires ont organisé un mouvement dans les rues, qui, s’ils avaient réussi, aurait signifié la victoire de la contre-révolution. En Egypte, les masses ont montré leur soutien enthousiaste à la répression des Frères Musulmans, qu’elles considèrent à juste titre comme les forces de la réaction. Mais cette analogie historique a ses limites. Napoléon a réussi uniquement parce que les masses se sont épuisées. En Egypte, au contraire, la révolution a toujours des réserves considérables, qui s’affirment à chaque étape décisive.
La force de la révolution s’est vue à la faiblesse des Frères Musulmans, qui furent incapables d’organiser une riposte efficace à la défaite de Morsi. Ils n’ont organisé de grandes manifestations qu’au Caire et à Alexandrie ; et seulement dans les quartiers des classes moyennes et des plus riches. Partout ailleurs, ils ont rencontré l’opposition acharnée des masses révolutionnaires, qui les ont refoulés dans un quartier après l’autre. Finalement, ils ont été facilement dispersés et écrasés par l’armée.
En l’absence d’un véritable parti révolutionnaire marxiste, les chefs de l’armée ont pu manœuvrer, de façon bonapartiste, en s’appuyant d’abord sur les masses pour porter des coups aux Frères Musulmans, puis, le lendemain, en arrêtant les dirigeants syndicaux pour briser les grèves.
La révolution est une grande école pour les masses, qui ne peuvent apprendre que par l’expérience. La deuxième révolution s’est déroulée à un niveau bien plus élevé que la première. Les mots d’ordre naïfs tels que « Nous sommes tous Egyptiens » avaient disparu ; à la place, il y avait une volonté révolutionnaire ferme et intransigeante. En très peu de temps, la révolution a réalisé ce qui avait pris 18 jours en 2011. Mais le transfert pouvoir au Conseil Suprême des Forces Armées (CSFA) signifiait rendre le pouvoir à la même vieille classe dirigeante, quoiqu’une fraction différente de celle représentée par Morsi. Cela signifie que les masses devront passer par une autre dure leçon.
Al-Sisi est un contre-révolutionnaire, tout comme l’était le bonapartiste Kerensky, en Russie, après la révolution de février. Mais il est plus intelligent que Morsi. La nature contre-révolutionnaire de Morsi était évidente, mais le rôle d’Al-Sisi n’est pas encore clair aux yeux des masses, qui le voient comme leur allié. Elles considèrent la répression des Frères Musulmans par l’armée comme un acte révolutionnaire. C’est pourquoi elles étaient disposées à donner du temps à Al-Sisi. Mais la patience des masses ne durera pas éternellement. Le gouvernement Biblawi, nommé par Al-Sisi, est déjà très impopulaire.
Après les élections parlementaires et présidentielles, la critique du gouvernement va s’accroître et les contradictions entre la révolution et les nouveaux dirigeants deviendront toujours plus évidentes. Ce qu’il faut retenir, c’est que la crise économique a causé un chômage de masse et une pauvreté colossale. Les problèmes de l’inflation et du chômage n’ont toujours pas été résolus. Si Al-Sisi se présente aux prochaines élections, il pourrait être élu avec une grande majorité de voix. Mais une fois au pouvoir, il sera chargé de donner aux travailleurs, aux paysans et aux chômeurs ce qu’ils attendent : un travail, du pain et un toit. Mais sur la base du capitalisme, c’est impossible. Cela préparera le terrain à une nouvelle et orageuse période de soulèvements révolutionnaires.
De nouvelles couches de la population entrent dans la lutte en permanence. Les éléments les plus anciens et fatigués – y compris parfois ceux qui ont joué un rôle important dans les premières étapes – auront tendance à abandonner la lutte, déçus et désorientés par les événements qu’ils n’ont pas vu venir et qu’ils ne comprennent pas. Ils se plaignent constamment du soi-disant « faible niveau » des masses. Mais ce sont eux qui commettent le crime le plus grave, en confondant la révolution et la contre-révolution.
Les égarés « de gauche » qui font écho à la propagande de la bourgeoisie et des impérialistes en qualifiant de « coup d’Etat » le magnifique mouvement de masse qui a renversé Morsi, n’ont rien compris. Le mouvement de juin dernier était la deuxième révolution égyptienne. Les masses, qui ont renversé le régime détesté des réactionnaires Frères Musulmans, ont pris conscience de leur propre puissance collective, ce qui servira de base à une nouvelle offensive révolutionnaire, dans la période à venir. Nous devons tourner le dos aux anciens éléments démoralisés et nous orienter vers la jeunesse, vers la nouvelle génération de combattants qui représente l’avenir révolutionnaire.
L’Iran
L’élection de Rouhani marquait le début d’un changement dans la situation iranienne. Les élections étaient un signe clair que le régime ne pouvait plus continuer sur sa précédente lancée. Les mouvements de masse de 2009 ont été réprimés violemment. Puis le régime a renforcé la pression intérieure et supprimé des droits démocratiques. La crise du régime s’est reflétée dans le conflit ouvert entre Ahmadinejad et Khamenei. L’économie était dans une crise profonde et énormément aggravée par les sanctions imposées par les Etats-Unis et l’UE. Le chômage, qui était déjà élevé, a atteint des records. L’effondrement du Rial a fait croître l’inflation jusqu’à presque 100 %. L’industrie, la production et le commerce étaient pratiquement à l’arrêt.
Des millions de travailleurs étaient confrontés à l’explosion des prix – et à des salaires qui, soit avaient baissé, soit n’étaient pas payés pendant plusieurs mois. Cette situation ne fut pas moins désastreuse pour la classe moyenne. Des familles habituées à une vie relativement stable ont été ruinées du jour au lendemain, leurs épargnes ayant été dévaluées et leurs commerces poussés à la faillite.
Les élections présidentielles étaient supposées avoir été planifiées, sans controverse possible. Mais durant la campagne, les différents candidats, qui avaient été soigneusement sélectionnés, se sont violemment attaqués. La fracture ouverte dans la classe dirigeante à permis aux masses de forcer le passage sur la scène politique.
Les meetings de la campagne d’Hassan Rouhani ont agi comme un point focal de la mobilisation. L’intervention des masses a bouleversé tous les plans de la clique dirigeante. Les Mullahs ont dû changer de cap. Rouhani représente une aile du régime qui favorable à des réformes d’en haut pour prévenir une révolution. En conséquence, le régime fut forcé de prendre quelques mesures limitées pour relâcher la pression, spécialement celle qui pesait sur la jeunesse et les classes moyennes. C’est la raison pour laquelle il y a en ce moment de grandes illusions envers Rouhani. Mais avec l’assouplissement du régime les questions démocratiques, les questions d’ordre économique vont passer au premier plan.
Le régime recherche un accord avec les Américains dans le but d’ouvrir leur marché, mais aussi de gagner quelques concessions, spécialement pour leur faible infrastructure pétrolière. Un tel accord, s’il est conclu, ne changera pas la situation générale des masses. La seule manière, pour la bourgeoisie iranienne, de sortir de sa crise, c’est d’augmenter l’exploitation des travailleurs iraniens. Mais cela ne fera que jeter de l’huile sur le feu. Par ailleurs, tout relâchement de la pression ne fera qu’alimenter l’auto-organisation des travailleurs et des jeunes – et préparera le terrain à de grandes explosions révolutionnaires, à l’avenir.
Cette « ouverture » fournit de nouvelles opportunités pour l’opposition et la gauche. Des journaux d’opposition (et même de gauche) ont commencé à apparaitre. Peu à peu, les forces de l’opposition commencent à ré-émerger. La jeunesse est ouverte aux idées socialistes et révolutionnaires. Il est vrai qu’il y a des illusions à l’égard de Rouhani, mais celles-ci ne survivront pas longtemps à l’expérience. Les masses devront passer par l’école de la démocratie bourgeoise afin de tirer les conclusions nécessaires – et ils les tireront.